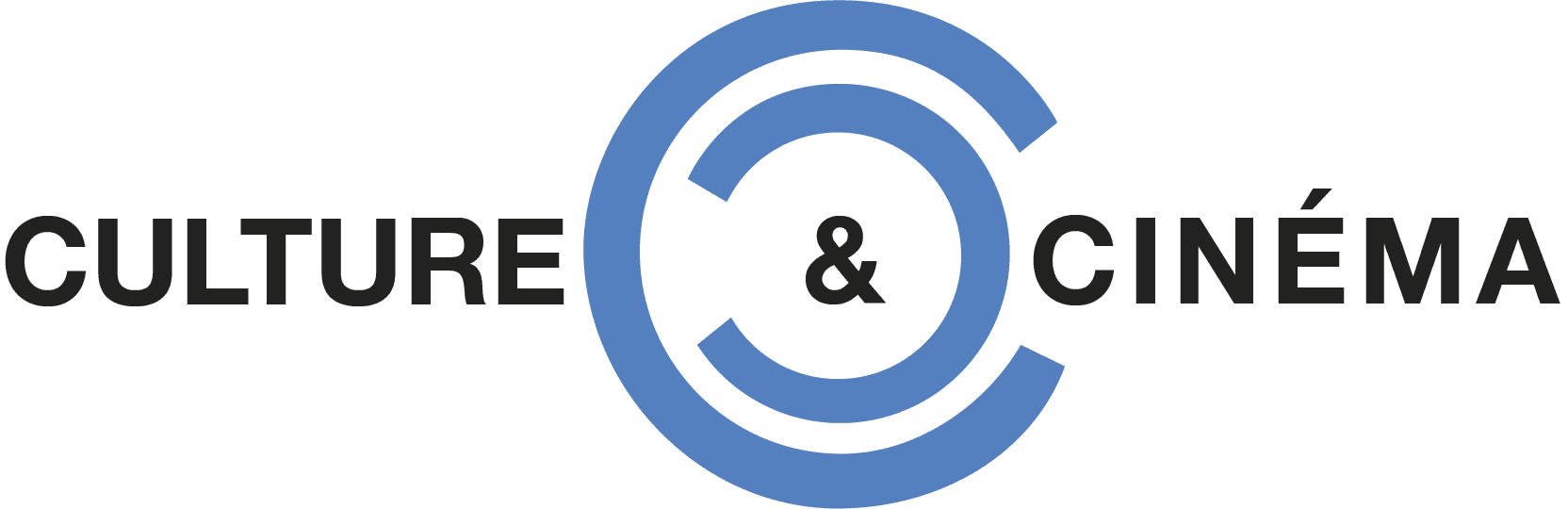L’ampleur émotionnelle déployée par le magistral The Rider prend paradoxalement source dans son dispositif minimaliste : un ton doux et patient, une narration élimée, un portrait intime. Surtout un portrait : le nouveau film de Chloé Zhao (trois ans après le très réussi Les Chansons que mes frères m’ont apprises) est d’abord le récit d’une irruption, celle d’un acteur dont les premiers pas sur grand écran sont déjà inoubliables. Brady Jandreau – dans un rôle très proche de sa propre vie – est insaisissable : cowboy blessé dans sa chair après une chute lors d’un rodéo (il porte, au début du film, une large plaie recousue qui le défigure, le crâne estropié), il est une gueule cassée, une tête folle si puissante que la fébrilité de son corps et de son esprit, la retenue de son jeu et son regard fuyant ne suggère jamais une quelconque faiblesse. Au contraire, il est un cheval fou, rempli d’orgueil et de violence que son physique ruiné ne peut lui permettre d’exprimer. Il emprunte au règne animal son instinctivité : on sent, derrière l’épuisement du corps, un caractère indomptable, une présence qui ne peut se conformer au cadre imposé par la caméra que ce soit dans ses gestes, ses attentions, ses obsessions. Et pourtant, cette détresse ne semble être tournée que vers une bonté inaltérable, un sens de l’écoute et de l’entraide, une sensibilité supérieure. La grandeur de la réalisatrice réside dans son refus obstiné de domination d’un créateur sur sa créature, d’en faire une bête de foire malléable et extravagante. Elle s’efface et laisse s’épanouir toute sa profondeur.
L’histoire fatiguée
La douceur et la simplicité de la mise en scène de Zhao trouvent leur raison d’être dans ce territoire crépusculaire et apaisé : faite d’éclats impressionnistes, proche de la captation documentaire – renforcée par l’écriture de personnages calqué sur la réalité de ceux qui les incarnent – et nourrie par une intimité qui n’est jamais intrusive, elle filme Brady et ses proches comme membres à part entière d’une harmonie, témoins d’un retour à l’état de nature où toutes les frontières (si cruciales dans la définition du western et de l’histoire de l’Amérique) se brouillent. D’origine Sioux-Lakota, les personnages de The Rider ont le visage pâle et une vie de cowboys. Les hommes et les chevaux, véritables alter egos, se partagent l’espace de façon équitable et avec évidence, incarnant aussi bien des êtres complémentaires et amicaux que la menace principale à la survie de l’autre. Tout porte à croire que ce monde en déshérence est imprégné d’un syncrétisme magique, qui emprunte autant aux chamans et aux totems que l’on aperçoit au fond d’un plan qu’à la croyance dans le rodéo, culture populaire élevée au rang de religion. Au centre, Brady Blackburn est un demi-dieu déchu : ancienne star – il est arrêté par de jeunes fans dans un supermarché pour prendre une photo – il ne peut plus pratiquer sa passion sur ordre médical. Son don se déplace : de cavalier hors pair, il devient dresseur et c’est grâce à la minutie et la tendresse des gestes qu’il prodigue que les plus rugueux des animaux se calment et prennent confiance. Au-delà de l’aspect très chorégraphique que prennent les séquences consacrées à ce dressage, Zhao sonde une sorte de langage inconnu et incertain.
Se dévoile alors peu à peu le cœur de The Rider : la transmission, qu’elle soit dressage, rééducation ou héritage, imprègne toutes les dimensions du long-métrage. La puissance du film ne peut se départir d’un autre personnage qui, depuis sa première apparition, hante chaque image comme un cauchemar : Lane, le meilleur ami de Brady, lui aussi victime d’un accident de rodéo et dont le destin ne lui a pas accordé la même seconde chance en le laissant dans un état végétatif, à peine capable de gémir. Par des gestes mimétiques à ceux qu’il utilise pour débourrer les animaux, le jeune cowboy s’évertue à recréer les sensations de la piste pour extirper son camarade de la monotonie de son enfermement mental. La sensibilité de la réalisatrice fait des miracles : là où la séquence avait tout pour redoubler de mièvrerie un peu obscène, elle y saisit une candeur authentique, une affection immédiate et terrorisée qui en décuple l’émotion. De miroirs en miroirs, chaque relation entre personnages est dépendante des autres. L’amitié fraternelle et la culpabilité d’être valide qui fonde le regard de Brady sur Lane renvoie à la pureté de sa complicité avec Lily, sa sœur atteinte d’autisme mais douée d’une vivacité des plus vitalistes. Ils sont les deux anges gardiens, l’un spectre de la mort, l’autre pure énergie.
Là est la force du cinéma de Chloé Zhao : montrer la tristesse du monde avec une pudeur telle qu’il ne peut en surgir que de la grâce et de la lumière. Comme dans Les Chansons que mes frères m’ont apprises, elle place sa caméra avec une rigueur qui la défend de toute approche paternaliste : en restant constamment à hauteur de la croyance de ses personnages, la réalisatrice s’installe dans leur rythme et magnifie leurs possibles. L’humilité qui se dégage de cette méticulosité emplit chaque plan d’un lyrisme immanent qui imprègne la terre et les hommes et ne cherche qu’à exploser dans des séquences lumineuses et poignantes, dans un geste de pure sublimation musicale. Cette acuité et cet humanisme généreux ne cherchent jamais à « rendre leur dignité » à ces pauvres âmes, marginales et éreintées, comme s’il s’agissait d’une faveur accordée d’en haut. Au contraire, Zhao ne fait que capter leur grandeur endormie et promet, discrètement, d’en être le témoin.