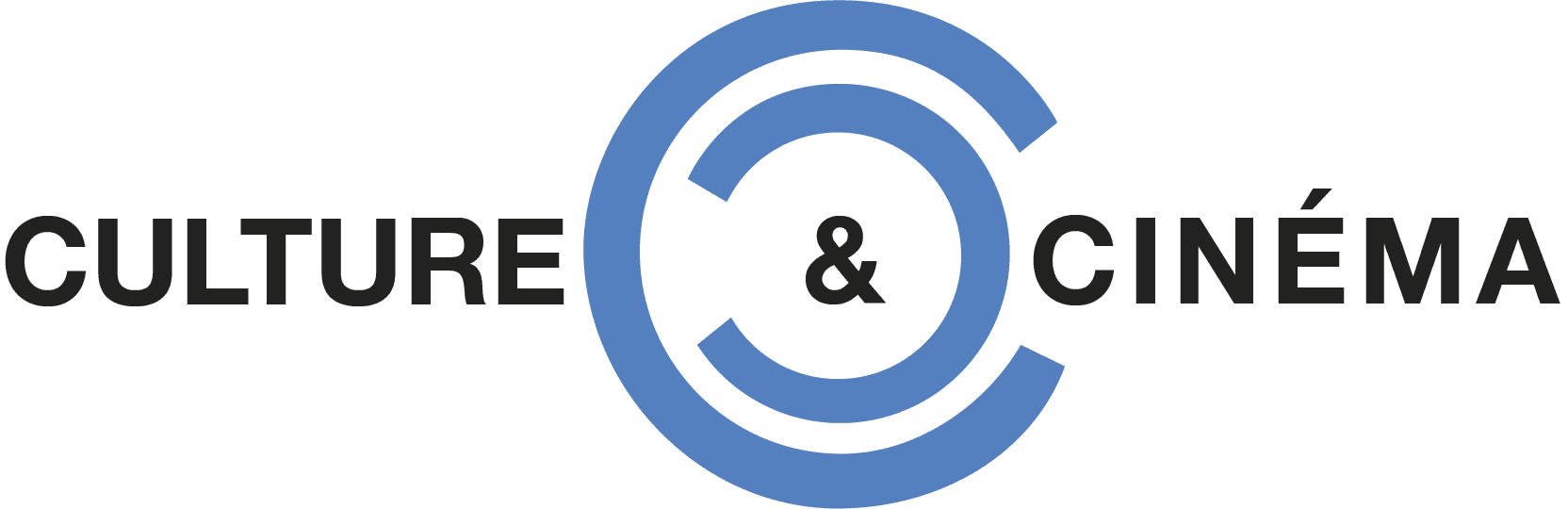Mathieu Macheret
Journaliste au Monde
Dans une scène fameuse du Cirque de Charlie Chaplin (1928), Charlot est lâché à son insu sur une corde de funambule, à vingt pieds au-dessus du vide, devant le public d’un chapiteau, alors qu’une bande de singes l’assaille, lui croque le nez, lui dégrafe le pantalon, compromettant dangereusement son équilibre. Un zeste de frayeur exhausse le rire : à ce moment-là, on se dit qu’il est humainement impossible d’en mener moins large, et le cinéma nous aide à vivre, car il nous montre que nos problèmes ne seront jamais aussi aigus que ceux du pauvre vagabond sur l’écran.
Cinquante ans plus tard, dans Sorcerer de William Friedkin, une scène épique retrouvait le même type de frayeur, mais sans le rire : quatre types perdus dans la jungle s’éreintent à faire passer deux camions chargés de nitroglycérine sur un pont branlant et délabré, alors qu’une tempête leur crache ses rafales au visage et que les flots hurlants d’un fleuve en crue menacent de les engloutir. Cette fois, si le cinéma nous aide toujours à vivre, ce n’est plus sur le dos d’une victime universelle, mais par ce constat d’une lucidité terrible que l’homme face à lui-même n’a aucune prise sur la fureur des circonstances, surtout lorsqu’elles se liguent contre lui.
On peut voir Sorcerer en salles depuis le 15 juillet, en copie restaurée. Sorti en juin 1977 aux Etats-Unis, en novembre 1978 en France sous le titre Le Convoi de la peur, c’est un véritable parangon de film maudit, moins pour son invisibilité – une série d’éditions vidéo lui a valu un statut de film culte – que pour sa légende, celle d’un tournage infernal, sanctionné par un four en salles qui annonçait, en cette fin des années 1970, un changement d’ère à Hollywood.
A l’origine, William Friedkin, chien fou issu du documentaire télévisé (il est né en 1935), venait d’enchaîner coup sur coup French Connection en 1971 (qui ressortira le 19 août) et L’Exorciste (1973), deux succès considérables qui lui avaient ouvert les portes des studios. C’est en discutant avec son scénariste Walon Green – celui de La Horde sauvage de Sam Peckinpah (1969) – que son nouveau sujet se précise : « Nous avions de longues conversations sur l’exploitation des ouvriers d’Amérique latine par les grandes compagnies pétrolières et fruitières, raconte-t-il, ce qu’on considérait comme de l’esclavage pur et simple, dans la mesure où les grèves étaient punies par des exécutions. Walon a tout de suite vu le rapport avec Le Salaire de la peur, le chef-d’œuvre de Henri-Georges Clouzot : “Tout est dedans !”, m’a-t-il dit. Nous avons donc décidé d’en acquérir les droits, détenus par Georges Arnaud, l’auteur du roman. »
A mille lieues de Clouzot
Ainsi, Friedkin reprend l’idée de base, celle de réunir des fugitifs dans un trou à rat d’Amérique du Sud pour les contraindre à convoyer une cargaison d’explosifs sur 200 miles de routes impraticables, tout en se défendant d’avoir voulu faire un remake : « J’ai repris cette idée, mais avec de nouveaux personnages, de nouvelles situations, de nouveaux dialogues. C’est ce que j’ai expliqué à Clouzot, juste avant de tourner le film : je n’avais aucune intention de rivaliser, de le copier ou de surfer sur la renommée du titre. Ça n’aurait eu aucun sens de “refaire” Le Salaire de la peur. D’ailleurs, la découverte de Gabriel García Márquez et de son “réalisme magique” eut une plus grande influence sur moi que le roman de Georges Arnaud. »
Et de fait, par son approche sèche et nerveuse (les premières scènes se déroulent sans la moindre parole), Sorcerer se tient à mille lieues de Clouzot et de sa psychologie. A commencer par ce choix fort de montrer le passé des personnages – un tueur à gages mexicain (Francisco Rabal), un terroriste palestinien (Amadou), un homme d’affaires français convaincu de fraude (Bruno Crémer) et une petite frappe du New Jersey (Roy Scheider) – en quatre séquences énigmatiques aux quatre coins du monde. En juxtaposant ainsi les raisons de leur cavale, le récit prenait la forme d’une implacable démonstration mathématique : le sujet ne résidait plus, comme chez Clouzot, dans les rapports contradictoires qui s’installent entre les convoyeurs, mais s’élevait jusqu’à l’abstraction : « Le vrai sujet du film, c’est la mécanique du destin, affirme Friedkin, ce sur quoi nous n’avons aucun contrôle. »
Les choses se compliquent dès la préproduction, par la défection en série des plus grosses têtes de la distribution : Steve McQueen ne veut pas quitter les Etats-Unis et sa femme Ali McGraw, Marcello Mastroianni est requis par ses devoirs de père, leur défection entraînant celle de Lino Ventura. « J’ai longtemps regretté de ne pas avoir obtenu Steve McQueen, reconnaît Friedkin, mais plus maintenant. Le choix de Roy Scheider, bien que second, s’est avéré plus fort, car il ressemblait plus à l’homme de tous les jours, et l’on peut dire la même chose de ses partenaires, qui apportent plus de matière à l’histoire. »
Le tournage de la partie sud-américaine, entre le Mexique et la région de La Altagracia en République dominicaine, vire au cauchemar, avec l’assaut d’un ouragan qui détruit l’ensemble du décor, les révoltes des populations locales, un Friedkin survolté qui vire ses techniciens à tour de bras et des autorités malveillantes qui tentent de le faire chanter : « Le tournage était physiquement difficile, extrêmement dangereux pour les membres de l’équipe, dont beaucoup ont été blessés ou ont contracté des maladies, la gangrène, des infections, et j’en suis moi-même revenu avec la malaria. » Le pire reste la célèbre scène du pont (dix minutes de tension extrême), dont les balancements spectaculaires jettent plusieurs camions à l’eau : « Ce n’est que par la grâce de Dieu que personne ne fut tué, se souvient-il. Et j’étais pleinement conscient du danger à l’époque. Mais je n’ai jamais perdu le contrôle. Je me raccrochais toujours à la vision du film que j’avais en entier dans ma tête. C’est pourquoi je continue à l’aimer, malgré toutes ces catastrophes : c’est celui qui s’approche au plus près de ma vision des choses. »
Grand film sur la propagation du Mal
Aujourd’hui, Sorcerer frappe encore par son incroyable densité narrative, ce réalisme solide teinté de fantastique (les apparitions de statuettes païennes, les nappes électroniques du groupe allemand Tangerine Dream) qui infuse toutes les strates de la fiction. Selon Friedkin, « les figurants qui apparaissent dans le film ne sont autres que les gens du village où nous tournions, vaquant à leurs occupations. Je n’ai fait qu’y plonger mes personnages ». De même, la fabrication du film se nourrissait des expériences de proches que Friedkin mêlait au tournage, comme un certain Marvin, dit « La Torche », « un incendiaire professionnel qui mettait le feu aux commerces moribonds à New York pour les propriétaires qui voulaient toucher les assurances », venu rendre plus crédible l’explosion d’un tronc de baobab barrant la route aux protagonistes ; ou encore le cambrioleur Jerry Murphy, « qui en savait long sur le braquage des églises et apparaît dans la séquence du New Jersey, accompagné de deux ex-activistes de l’IRA qui, de leur côté, avaient fait péter quelques bureaux de poste ». Un âge où les récits hollywoodiens étaient encore largement ancrés dans une réalité de terrain que les cinéastes avaient pour fonction de défricher : « C’étaient des copains, ils me racontaient tout, et ils n’ont fait que ce qu’ils connaissaient ! »
A l’arrivée, Friedkin signait là son chef-d’œuvre, un grand film sur la propagation du Mal, mais où le démon de L’Exorciste serait cette fois remplacé par la loi inflexible qui lie les causes aux conséquences, conduisant implacablement ses personnages à l’abîme. Que celui-ci ait subi un tel revers commercial, cela ne s’explique pour le cinéaste que par la sortie concomitante de Star Wars, la fantasmagorie de George Lucas qui recueillit massivement les suffrages des spectateurs : « J’ai bien senti à l’époque que le “zeitgeist” avait changé. Sorcerer est à l’opposé de Star Wars. L’un vend de l’espoir, de l’optimisme, des héros et des méchants bien définis, et à la fin les gentils gagnent. Dans Sorcerer, personne ne gagne : ce n’est pas un film sur la Force, mais sur les forces qui nous gouvernent. »