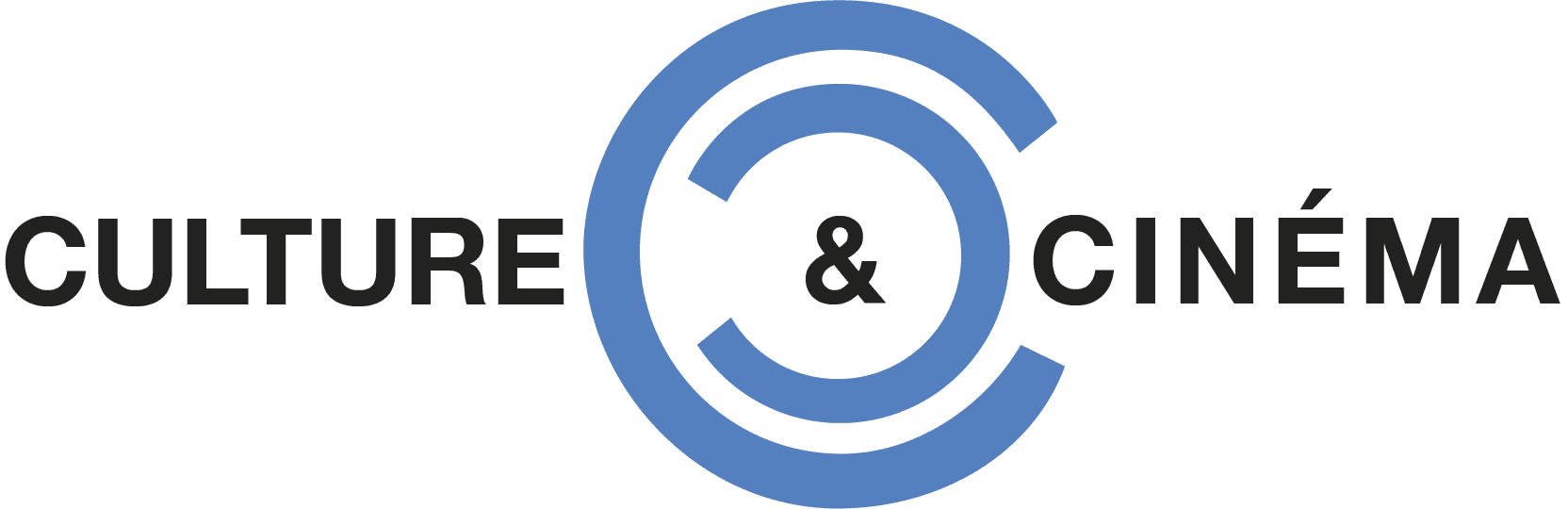L’outsider américain à la carrière chaotique mais traversée de fulgurances est l’objet cet automne de plusieurs publications et voit deux de ses chefs-d’œuvre ressortir en DVD et sur grand écran.
«Un jour, j’ai demandé à Orson Welles de comparer John Ford et Howard Hawks et il m’a répondu ceci : « Hawks, c’est de la grande prose, Ford, c’est de la poésie. » Un cinéaste fordien serait pour moi, un cinéaste doté d’une sensibilité élégiaque, tandis que Hawks a un style et un rapport au monde plus directs. Je pense que je suis tombé quelque part entre les deux.» Bien sûr, on pourrait sourire de l’imperceptible forfanterie de l’auteur de ces lignes que rapporte Jean-Baptiste Thoret dans le beau livre d’entretiens qu’il vient de lui consacrer – le Cinéma comme élégie, conversation avec Peter Bogdanovich (GM Editions-Carlotta Films). De cette façon un peu crâne de se glisser, mine de rien, entre deux figures tutélaires du cinéma hollywoodien, et même trois si l’on compte Welles auquel Bogdanovich fut parfois comparé à ses débuts pour la maîtrise de son style et la fulgurance d’une carrière qui s’annonçait prometteuse, mais qui sera minée au début des années 80 par l’assassinat de sa jeune compagne, la playmate Dorothy Stratten, dont il relate les circonstances dans un récit, la Mise à mort de la Licorne enfin traduit et publié par GM Editions-Carlotta Films.
Etoile filante
Mais plutôt que de s’arrêter à cette infime arrogance – un trait de caractère qui lui fut souvent reproché à Hollywood -, notons que ces propos soulignent (en même temps que son allégeance à un certain classicisme) la dualité d’un cinéma écartelé entre le vif et la perte de l’innocence, entre la vitesse et la nostalgie contemplative, le mouvement et le désir buissonnier d’en moduler le rythme, jusqu’à atteindre une liberté folle dans l’art très renoirien d’arrimer le récit à ses personnages, et de le laisser flotter au gré du flux comme un bouchon de liège – art qui touche à la perfection dans sa virevoltante comédie romantique Et tout le monde riait (1981) ou encore dans Saint Jack (1979), languide chef-d’œuvre méconnu avec l’immense Ben Gazzara en mac cool et débonnaire exilé à Singapour, qu’une réédition concoctée par Carlotta Films permet enfin de redécouvrir sur grand écran et dans un superbe coffret Bluray.
Pour ceux qui ne connaissent Peter Bogdanovich que sous les traits du psy de Lorraine Bracco qu’il incarna dans la série les Soprano – dont il réalisa lui-même un épisode en 2004 -, et pour les autres qui peinent à identifier clairement sa filmographie en dents de scie, dont injustement on ne retient souvent que la toute première partie et son succès oscarisé The Last Picture Show (1971), chronique désenchantée d’une jeunesse sans avenir dans le Texas endormi des années 50, la riche actualité dont Bogdanovich fait l’objet cet automne arrive à point nommé pour battre en brèche les raccourcis dont il est souvent l’objet.
Le premier consiste à ne percevoir en ce cinéaste, né en 1939 à Kingston (Etat de New York) dans une famille d’origine serbe, qu’une étoile filante du Nouvel Hollywood (mouvement dont il ne s’est jamais réclamé, mais dont il sera à son corps défendant l’une des figures phares), qui aurait été rattrapée par un académisme un peu rigide. Si le cinéma de Bogdanovich est emprunt de «petites bulles de nostalgie», Thoret rappelle avec justesse dans sa préface qu’il n’est nullement incompatible avec un regard en prise sur le monde. Et si cinéphilie compulsive il y a, elle s’apparente dans ses films à un modèle épistémique, pris en charge par la mise en scène, sans jamais en surligner le trait. Cet amalgame singulier, qui rattache toujours la citation filmique à sa nécessité dans le récit (dont elle n’est jamais une illustration un peu cuistre mais un vrai ressort dramatique), aura préservé le cinéma de Bogdanovich d’un formalisme trop ostentatoire, celui-là même qu’il reproche aux tenants de la modernité européenne, tel Antonioni avec lequel il se montre particulièrement critique. «Son cinéma est très italien, intellectuel, prétentieux et lent. Les films américains sont par nature rapides. L’Amérique va vite. C’est donc contre la nature des Américains que de vouloir faire ce type de film, avec ce rythme, ce rapport aux choses, aux idées.» Et d’ajouter : «Je crois que dans le cinéma américain, classique surtout, tout ce qui vous rappelle que vous êtes en train de regarder un film est banni, ou atténué. L’idée étant de permettre au spectateur de s’oublier en tant que spectateur. Or il y a un certain effet de distance, ou de distanciation dans les films étrangers. Une forme d’autoconscience.»
Résistance
Pour autant, le cinéma de Bogdanovich sera, dès le premier film, la Cible (Targets, 1968), qu’il réalise au sein de l’écurie de Roger Corman, traversé par ce double mouvement, cette scission existentielle entre le regard et l’action, le cinéma et la réalité. Le film lui-même est morcelé en deux lignes narratives qui finissent par se rejoindre dans un finale virtuose. Soit le dernier tour de piste d’une star vieillissante de cinéma d’épouvante, Byron Orlok (Boris Karloff) et la trajectoire meurtrière d’un jeune Américain lisse, métamorphosé en sniper fou tirant à vue sur les spectateurs d’un drive-in où Orlok était venu présenter son nouveau film. Hanté, dans sa forme, par l’assassinat de Kennedy et par l’irruption, via les faits divers, d’une violence arbitraire, Targets rejoint, par des façons détournées, les coups de canif que la jeune génération portait à l’Amérique des aînés (les effets traumatiques de la guerre sur les vétérans du Vietnam, la vente libre d’armes à feu, etc..). Mais ce discours critique, c’est en cinéaste que l’articule Bogdanovich, aidé de Samuel Fuller qui lui souffla quelques idées. Outre le finale, qui offre à Orlok/Karloff l’occasion d’un ultime acte de bravoure en marchant droit sur le forcené qui, parce qu’il confond l’acteur et son double sur l’écran, finit par s’effondrer, comme terrassé par la puissance des images, Bogdanovich avait aussi livré quelques scènes auparavant une charge subreptice contre la télévision (rivale principale du cinéma qui précipita la chute des grands studios) : notamment en usant d’une esthétique télévisuelle pour traiter des scènes du jeune homme dans son foyer – cadrage fixe de la famille à table, reprenant les codes des sitcoms. L’univers confiné et étouffant de la famille modèle rendu par l’écriture cathodique étant en somme désigné comme le complice tacite d’un système qui engendre des monstres ordinaires.
A l’opposé, le cinéma demeure le lieu sinon d’une rédemption, du moins d’une forme de résistance et d’une certaine pureté, où ce qui se passe sur l’écran interagit avec les vies de ceux qui le regardent. C’est ainsi que l’on peut aussi lire The Last Picture Show – dont Carlotta offre une somptueuse director’s cut en Blu-ray. Cette chronique adolescente, faisant émerger sur les cendres d’un western fordien anachronique les codes des futurs teen movies indie, avec ce noir et blanc diaphane, ces langueurs mélancoliques et une approche crue de la sexualité, est encerclée par deux films ouvrant et clôturant le récit : en ouverture, le Père de la mariée de Minnelli, que les jeunes gens découvrent dans un cinéma de quartier – le rêve sur celluloïd donnant aux baisers échangés dans la salle obscure un peu du romantisme qui fait défaut à leurs flirts sans éclat. Et à la fin, la Rivière rouge de Hawks, projeté en dernière séance avant que le cinéma ne ferme définitivement, comme une promesse à jamais abolie, laissant les jeunes gens orphelins, livrés à l’avenir sans espoir qui semble se profiler pour eux.
Contre-pied
On peut encore s’amuser à recenser dans les films de Bogdanovich les influences et les citations des cinéastes aimés : l’Impossible Monsieur Bébé croisant Bugs Bunny, Buster Keaton et le chaos joyeux de The Party dans What’s Up Doc (1972), les Raisins de la colère de Ford dans la Barbe à papa (1973), ou encore le style Cassavetes dans Saint Jack, dont le héros emprunte le sourire et la démarche de son acteur fétiche, Ben Gazzara. Dans ce film, Bogdanovich a fait de son sujet (la liberté, et le prix à payer) la matière même de son film. Calant la trame du récit aux déambulations de Gazzara dans les quartiers chauds et populaires de Singapour, jamais l’écriture d’un film ne semble avoir été aussi déliée et affranchie des contraintes scénaristiques. Préférant la litote à la surcharge, l’ellipse à l’explicite, Bogdanovich, qui écrivait les scènes au fur et à mesure avec Gazzara, prend systématiquement le contre-pied des clichés propres au genre (le thriller exotique), amplifiant des moments creux, ou au contraire évidant les scènes qui étaient supposées être des climax, s’ingéniant ainsi à déjouer les attentes du spectateur pour lui laisser le soin de comprendre à sa guise (ou pas). «Il y a une formidable réflexion que Howard Hawks m’a faite un jour […] : « Tu sais, Peter, il y a certaines séquences que les spectateurs attendent, et lorsque tu ne les leur donnes pas, ils sont si contents… »»
Nathalie Dray
Peter Bogdanovich invité d’honneur du festival Lumière à Lyon du 13 au 21 octobre.
A voir : The Last Picture Show (Carlotta Films), Saint Jack (Carlotta Films, et en salles).
A lire : Le Cinéma comme élégie, conversations avec Peter Bogdanovich de Jean-Baptiste Thoret (GM Editions-Carlotta Films),
La Mise à mort de la Licorne de Peter Bogdanovich (GM Editions-Carlotta Films), Les Maîtres d’Hollywood : recueil d’entretiens de Peter Bogdanovich (avec les grands cinéastes hollywoodiens) en deux tomes ( Capricci).
Par Nathalie Dray Libération— 12 octobre 2018