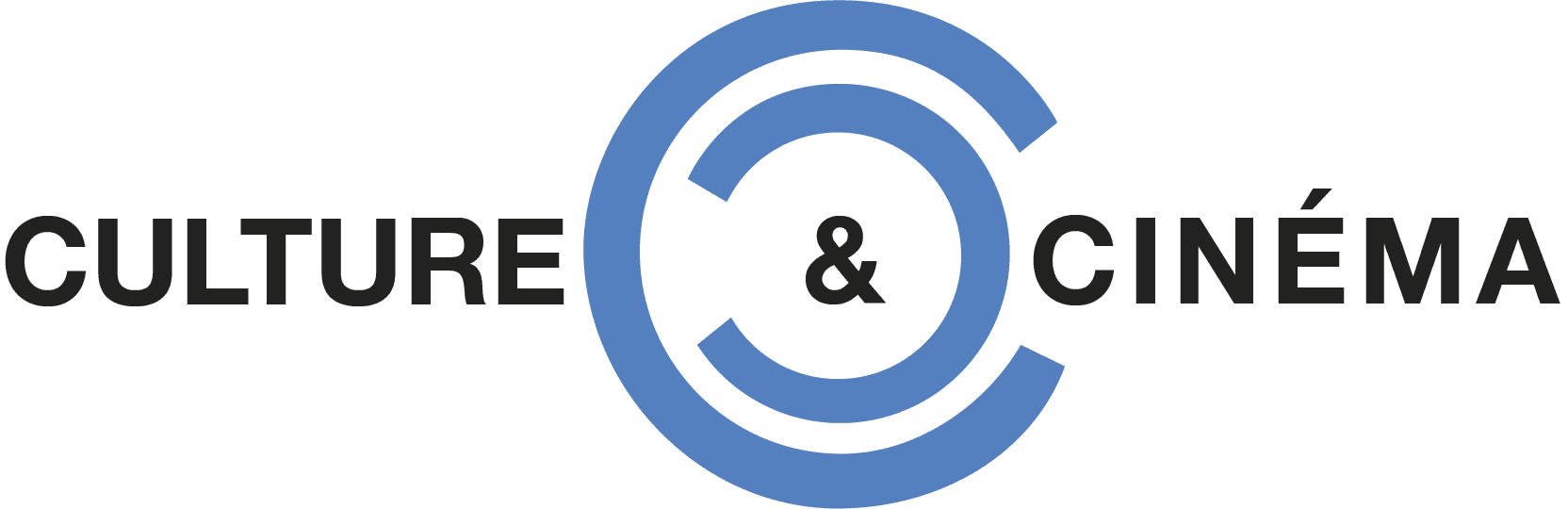Persona est un film qui a « sauvé la vie » de Bergman. Le titre premier du film, Cinématographe, résonne comme le testament d’un cinéaste, alors que cette œuvre va consacrer la renaissance de son auteur. Bergman imagine les premières images de son film alors qu’il délire, cloué sur un lit d’hôpital, atteint d’une double pneumonie. Refusant tout contact avec l’extérieur, le cinéaste se mure dans le silence et se laisse aller à ses dérives mentales. Les corps de mourants passent devant lui comme dans un songe, deux infirmières discutent et se montrent leurs mains, leur image se fondent et elles ne font plus qu’une seule et même personne, des photos de journaux de Liv Ullman et Bibi Andersson frappent Bergman par l’étrange effet de lumière qui éclaire leurs visages… Persona est né. De ces visions, le cinéaste tire en deux semaines un scénario, quitte son lit, et une semaine plus tard démarre le tournage à Stockholm. Cette urgence, ce besoin de créer, irriguent chaque minute du film. Naissent alors une tension, un désir brûlant de cinéma, une passion vorace qui donne à Persona la force et, pourrait-on presque dire, la naïveté d’un premier film.
L’ouverture est fragmentée, stupéfiante, images éparses qui nous plongent d’emblée dans l’univers du film et de son créateur : un burlesque muet, avec diable fourchu et squelette (Le Septième sceau ?), une mygale (Bergman imagine souvent dans ses rêves Dieu sous la forme d’une araignée), un mouton qu’on égorge, son œil, ses viscères qui se répandent, des clous enfoncés dans une main (Les Communiants ?). Puis un mur, la neige sur une forêt, une grille, et l’on pénètre dans l’hôpital. Bergman poursuit sur une série de portraits de défunts : la bouche d’une vieille dame, des visages, des mains, un enfant allongé sous un linceul. Un des visages est filmé tête en bas, comme si de nouveau nous observions le film depuis la lampe de projection. Après un cut imperceptible, les yeux de la morte se sont ouverts. Bergman, en ne filmant pas en continu la « résurrection », en usant d’un effet de montage, marque le passage d’un monde à un autre. Persona est une histoire de frontières poreuses, frontières entre deux femmes, entre deux folies, entre le monde de la fiction et la réalité, entre différents niveaux de représentation. Ce simple cut est l’aboutissement d’une série de plans qui nous font pénétrer dans l’espace-temps du film. Tout d’abord le spectateur est placé au niveau du projecteur. Celui-ci déroule un dessin animé, puis un film muet, objets purement cinématographiques, images des premiers temps d’un médium balbutiant. Les plans sur les mourants nous font un instant croire à une tentative de représentation de la réalité, mais le cut et la renaissance nous font de nouveau pénétrer dans un espace purement fictionnel. C’est l’enfant qui ouvre les yeux, c’est la musique qui s’élance, hypnotique, et nous fait entrer dans Persona. L’enfant se place face caméra, nous regarde, avance sa main et touche l’écran, notre écran, dans ce qui semble être de prime abord une tentative de contact avec nous spectateurs. La perspective s’inverse et nous nous retrouvons dos à l’enfant. Sa main caresse la surface lisse sur laquelle évolue le visage d’une femme. Par le double mouvement du cut et du changement de point de vue, Bergman nous a fait pénétrer dans le film. Nous rejoignons alors Elisabet Vogler dans ce monde de représentation dont elle est prisonnière et d’où elle tente de s’échapper. Nous sommes dorénavant aux côtés des créations de Bergman, nous voyons les artifices qui préexistent au film, nous sommes des personnages de fiction.
L’usage que Bergman fait de la bande-son participe pleinement à la création d’un univers mental et fantasmatique. Des contrepoints sonores viennent brouiller notre perception (un goutte-à-goutte obsédant sur la séquence d’ouverture) et s’associent à la musique de Lars Johan Werle, abstraite et expérimentale, pour façonner une ambiance inquiétante et glissante. L’omniprésence des voix hors champ – Bergman filmant par exemple Liv Ullman alors que le docteur tient son discours, ou lorsque Bibi Andersson s’épanche sur son histoire – conforte l’immersion du récit dans la psyché de son personnage principal. La place prépondérante que Bergman accorde au son se retrouve dans la minutie avec laquelle il compose l’atmosphère sonore de son film. Il va jusqu’à postsynchroniser Bibi Andersson dans la scène où elle parle de ses expériences érotiques, afin que ses intonations et son timbre coïncident parfaitement avec les expressions de son visage.
Expérimentations sonores, expérimentations visuelles, Bergman multiplie les figures « impures ». Il utilise des zooms et des faux raccords, brisant même la sacro-sainte règle des 180°. Avec Nykvist, il surexpose, utilise de violents contrejours comme dans Monika. Il fait avancer les ombres, noie ses personnages dans la nuit. Le visage de Liv Ullman s’y engouffrant petit à petit est à ce titre magnifique. Alors que ses contours s’estompent, la lueur de ses yeux continue de percer l’obscurité et bientôt il n’y a plus de traits, juste deux petits points blancs qui brillent dans les ténèbres. Ces pupilles qui luttent contre la nuit, c’est la peur d’Elisabet d’être absorbée par le néant, c’est le sentiment de sentir son corps s’évaporer, disparaître. La place du regard est au centre de Persona. C’est l’œil, celui d’un mouton que l’on égorge, les gros plans de capillaires sanguins. C’est l’image du film qui devient floue comme notre vision au sortir du sommeil. C’est les regards échangés entre l’enfant et la projection de sa mère, regards solitaires ne parvenant pas à se croiser. C’est à la fin du film la dernière confrontation entre Elisabet et Alma, scène montée deux fois de suite, une première fois en filmant le visage d’Elisabet qui reçoit les paroles d’Alma, la seconde fois en filmant l’infirmière. Elisabet et Alma vivent la même scène mais elles n’ont pas le même rapport au monde, ne vivent pas la même expérience, ne coexistent pas. Il n’y a pas d’échange, leurs regards ne coïncident pas. Et lorsque Bergman termine la séquence en créant un visage hybride à partir de deux gros plans de ses actrices, point de fusion du film, le résultat est profondément perturbant, le décalage entre les deux personnages étant encore plus sensible alors qu’ils ne font plus qu’un. Cette séquence filmée en simple champ contre-champ n’aurait pu exprimer cette sensation, et Bergman trouve la formule exacte pour concentrer les différents mouvements à l’œuvre dans son film.
Ingmar Bergman nous parle directement, viscéralement, de souffrance, de trahison, de jalousie, mais aussi de désir et d’amour fou. On retrouve dans Persona les relations troubles et complexes qui unissaient Ingrid Thulin et Gunnel Lindblom dans Le Silence. Un couple, c’est du vampirisme, de la domination, des tensions et des rapports de force changeants et évolutifs. Alma, l’infirmière, est douce et attentionnée ; elle est le salut, l’apaisement. Du moins en façade, sur le papier, dans le contrat. Pour combler le silence d’Elisabet Vogler, Alma parle, rit, déroule sa vie, puis ses angoisses, ses fantasmes. Le flot ininterrompu des mots vient bientôt submerger les quelques réticences d’Alma à se livrer complètement. Elle est emportée par ce déluge de paroles et livre ses expériences les plus intimes à cette figure silencieuse et attentive qui lui fait face. Elisabet Vogler n’en peut plus de porter des masques, que ce soit ceux de ses rôles ou ceux qu’elle porte en société. Elle n’en peut plus de mentir, et décide donc de se taire, de se fermer au monde. « Rêver vainement d’exister. Ne pas avoir l’air, être réellement (…) Un abîme sépare ce qu’on est pour les autres et pour soi-même », c’est selon le docteur la prise de conscience qui paralyse soudainement Elisabet alors qu’elle est sur scène. « [Tu désires] être mise à nu, découpée en morceaux » lui dit-elle, reprenant la confession de l’acteur mourant Johan Spiegel face à Vogler dans Le Visage. Ce n’est bien sûr pas un hasard si Elisabet porte le même patronyme que le héros du Visage. Comme lui, elle s’enfonce dans le mutisme, seul échappatoire qu’elle entrevoit à ses tourments. Le masque figé qu’Elisabet affiche est cependant un autre rôle qu’elle se donne : « Personne ne se demande si tu es vraie ou fausse (…) il n’y a qu’au théâtre que ces question comptent » poursuit le médecin, retournant la problématique du rapport entre fiction et réalité qui a amené Elisabet à se couper du monde. Pour Bergman le cinéma, le théâtre, l’artifice de l’art, sont plus réels que la vie même. Mais les acteurs souffrent de la dichotomie qui se crée entre le monde de la représentation et la réalité tangible des choses. Elisabet et Johan Vogler souffrent bien des mêmes maux. Mais la barrière qu’ils érigent, ce silence par lequel ils se coupent du monde est, comme le souligne le docteur, une « cachette [qui] n’est pas étanche. La vie s’infiltre partout. »
Bergman, lorsqu’il filme la rencontre entre la doctoresse et sa patiente, filme longtemps le seul visage d’Elisabet, donnant l’impression que la voix de la praticienne est un produit de l’esprit de l’actrice. Elle pourrait être une voix intérieure, elle est du moins le déclencheur de l’histoire entre Elisabet et Alma en envoyant les deux femmes à Fårö. Comme dans A travers le miroir (et plus tard L’Heure du loup, Une passion…), les personnages du film vont se trouver circonscrits aux limites de cette île de la Baltique, territoire mental où la raison s’échappe, où la folie peut à tout instant contaminer chaque chose. Un espace à la réalité mouvante qui épouse les circonvolutions des rêves et des fantasmes. Un monde-cerveau, comme on dit à propos des oeuvres de Kubrick. Un monde replié sur lui-même, cerné par la mer, une émanation de la psyché d’Elisabet Vogler et des barrières qu’elle s’est construites.
Elisabet désirerait ne plus vivre que par son corps. Ce corps qu’Alma décrit détail après détail : « Ton visage est bouffi, ta bouche vilaine, une ride barre ton front, tu as une cicatrice au cou. » Ce corps physique qui est le seul lien tangible au monde. Persona nous parle de l’attrait pour l’autre, du désir de s’en rapprocher, de s’enfouir en lui. L’enfant caresse le visage de sa mère projeté sur un écran géant, deux visages se confondent et ne font plus qu’un. Bergman nous parle de l’irrépressible besoin, du désir ardent, de ne faire qu’un avec l’être aimé et de l’impossibilité de cette fusion. Lorsque les deux visages se complètent, lorsque Bergman semble nous montrer la possibilité du rapprochement des êtres, le visage recréé est asynchrone, il ne « fonctionne » pas, il nous met mal à l’aise. Être au monde, être par rapport à l’autre, voilà les courants souterrains de l’œuvre de Bergman. Voilà des questions essentielles que le cinéma s’est si peu appropriées alors qu’il a les plus beaux outils pour les exprimer.
Bergman convoque Jung de manière affichée, la persona représentant dans ses théories le masque social. En donnant comme titre à son film ce terme évocateur de la pensée du psychanalyste, Bergman joue sur le même niveau de représentation qu’en affichant les artifices du cinéma. Il lui semble inutile de cacher artificiellement ces influences et préfère, d’entrée de jeu, les mettre en exergue de son film. C’est peut-être une manière pour le cinéaste de couper l’herbe sous le pied du critique qui voudrait faire une lecture psychanalytique de son film, manière également de donner des clés de compréhension à chaque spectateur un tant soit peu curieux. Ici pas de métaphore, de clin d’œil adressé à un public averti. Pour essayer d’être aussi honnête que Bergman, et pour éviter au lecteur une recherche dans Wikipedia, reprenons telle quelle la définition de la persona qui y est proposée : « La part de la personnalité qui organise le rapport de l’individu à la société, la façon dont chacun doit plus ou moins se couler dans un personnage socialement prédéfini afin de tenir son rôle social (…) Le moi peut facilement s’identifier à la persona, conduisant l’individu à se prendre pour celui qu’il est aux yeux des autres et à ne plus savoir qui il est réellement. » On voit que Bergman illustre au pied de la lettre, et non sans humour, les théories de Carl Jung. Le titre du film renvoie également aux masques que portaient les acteurs de la Rome antique. Ceux-ci personnifiaient le rôle et permettaient à l’acteur de faire porter sa voix haut dans les gradins. Dans le film, Elisabet Vogler en perdant son masque, perd aussi sa voix.
L’actrice se condamne au silence, se met à l’écart du monde. Souvent les personnages de Bergman s’imposent le mutisme (La Honte, Le Visage, Le Silence). Face à cette figure silencieuse, on ne peut plus que regarder pour essayer de comprendre. C’est le sens de la scène originelle, où devant l’écran de cinéma l’enfant contemple le visage de sa mère, tentant d’en percer le secret. Il caresse ce visage, mais celui-ci n’est qu’une surface plane, sans relief. Tous les autres sens ayant disparu, il ne reste plus que le regard. Comme on l’a vu, Bergman joue sur la place du spectateur, son investissement par rapport au film, soulignés par les nombreux regards qui parsèment l’œuvre (et que l’on retrouve dans L’Heure du loup, Monika, L’Oeil du diable…). Mais Bergman nous montre surtout les artifices qui sont en jeu dans notre quotidien, tout ce que l’on voit et que l’on pense comprendre alors qu’il n’en est rien. Notre rapport au monde, encore et toujours, thème primordial de l’œuvre de Bergman, celui des Communiants, cœur palpitant de Persona. Bergman nous parle ici de ce rapport à travers les tourments de l’artiste, de l’acteur auquel le cinéaste a toujours prêté toute son attention et son empathie et qui lui permet d’évoquer au plus profond la frontière entre création artistique et réalité. Vogler, le magnétiseur du Visage, exprimait la douleur des acteurs, des artistes, la douleur de voir le monde réel glisser sous leurs pieds, la douleur de se mouvoir sur les terres instables de la recréation du monde par l’art. Elisabet souffre des mêmes affects. A force de porter un masque, une persona, elle ressent le besoin de se raccrocher au réel. Les images d’actualité qui la tétanisent et l’effrayent, sont un moyen de renouer avec la douleur du monde, cette douleur pour laquelle le pasteur des Communiants ne parvenait plus à avoir d’empathie. Au début du film, Elisabet regarde terrorisée la télé. Un contrechamp nous fait découvrir des images d’actualité, images insoutenables d’un homme qui s’immole. Ces images sont circonscrites au cadre de la télévision mais un cut vient effacer cette frontière physique et les actualités envahissent alors la totalité de l’écran. La réalité s’est invitée dans la fiction, a repris ses droits. Elisabet est parvenue un instant à quitter la sphère de la représentation du monde pour un instant renouer avec la réalité. Plus tard c’est la célèbre photo d’un enfant juif arrêté, les bras en l’air sous la menace de soldats allemands, qu’elle scrute inlassablement. Elle passe de visages en visages afin d’essayer de reconstituer la chair de ce drame, d’essayer de comprendre ce qui s’est passé.