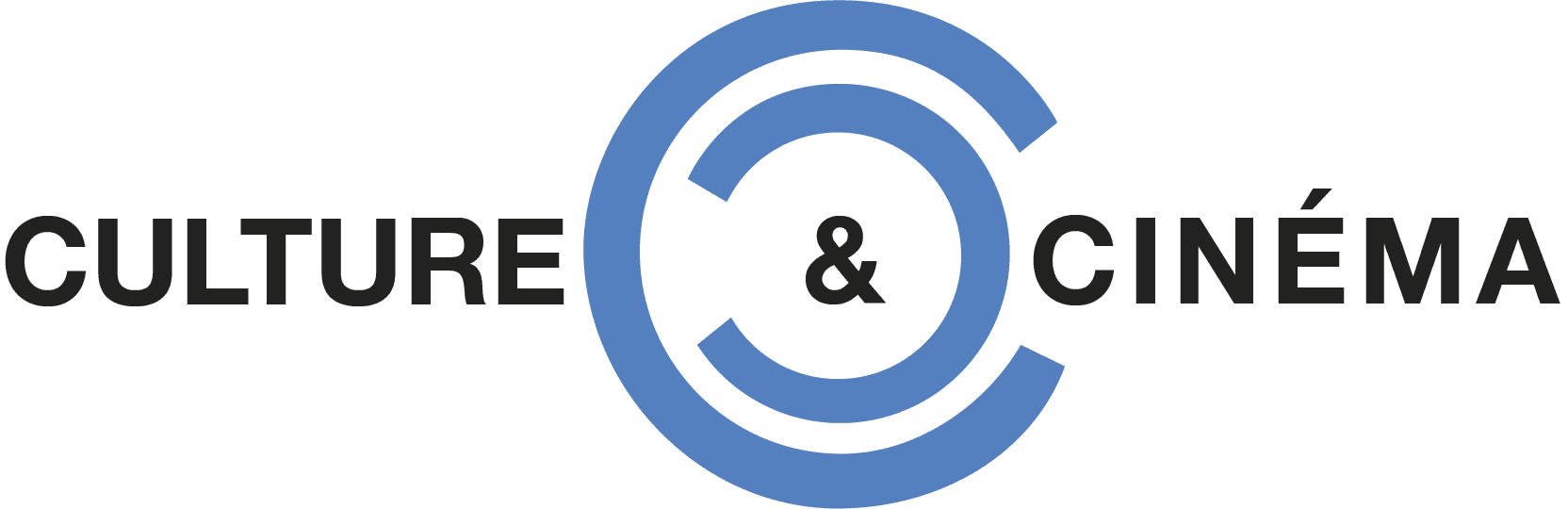Le cinéaste turc raconte à «Libération» la genèse de son nouveau long métrage et sa méthode de travail, mélange de dialogues très écrits et d’une mise en scène totalement improvisée.
C’est une chaude journée de juin à la veille de l’élection présidentielle en Turquie, et Nuri Bilge Ceylan, 59 ans, tête de boxeur cerclée d’une barbe de trois jours, est de passage à Paris. Il parle d’une voix posée, un demi-sourire au bord des lèvres, toujours avec pudeur, ne souhaitant ni s’étendre sur la politique ni sur sa famille – même s’il confiera qu’il a deux fils de 5 et 14 ans : «Je m’y suis mis tard.» Lorsqu’il sort son smartphone, c’est pour noter l’orthographe de noms qu’il ignore, comme celui de Jean Eustache : il n’a jamais entendu parler de la Maman et la Putain.
Le Poirier sauvage est le premier film que vous consacrez à un personnage jeune, englué dans un mal-être de son âge. Pourquoi avoir eu envie de raconter cette histoire ?
J’ai commencé par vouloir faire un film sur son père. Lequel m’était inspiré par un instituteur que je connaissais, marié à l’une de mes parentes éloignées. Je l’avais rencontré dans le village où j’ai passé mon enfance, il avait un esprit très vivant, curieux, mais j’ai compris qu’il n’était pas respecté par son entourage. J’ai voulu en savoir plus, peut-être car certains aspects de sa personnalité me rappelaient mon père. Je suis allé voir son fils, également instituteur, et lui ai demandé de coucher par écrit des souvenirs d’enfance. Je pensais qu’il ne me prendrait pas au sérieux. Mais trois mois plus tard, il m’a envoyé sa réponse par mail, un texte de 80 pages…
Qu’est-ce qui vous a donné envie d’en faire un film ?
C’était un texte très honnête, avec des détails très beaux, qui m’ont touché. Son auteur est un grand lecteur, sa réponse était incroyablement ciselée. J’ai abandonné le projet sur lequel je travaillais et appelé ce jeune homme, Akin Aksu, auprès de moi à Istanbul. Nous avons travaillé sur le scénario à trois : lui, ma femme et moi. Je voulais depuis longtemps faire un film sur les jeunes, sur la jeunesse, c’était l’occasion. Et c’était aussi le moyen pour moi d’insérer mes propres pensées sur un thème qui m’est cher, celui d’un jeune provincial qui ressent, avec le sentiment de culpabilité qui l’accompagne, qu’il est différent des autres. Et faire aussi le portrait du monde qui l’entoure, et qui recueille ses confessions.
Le film est composé de nombreuses scènes de longs dialogues, comme l’était déjà Winter Sleep, mais qui donnent ici une matière particulièrement fluide.
Comment installer ça ?
A dire vrai, je ne sais pas ! (rires) Au départ j’étais désespéré, me demandant comment tout ça allait être écrit. Puis, petit à petit, les éléments se sont imbriqués. Pendant le tournage, beaucoup de choses ont changé, et à nouveau au montage. Je remets tout en cause tout le temps. Mais à chaque étape, une chose m’importe avant tout, le dosage des sentiments. Jusqu’à quel point ceux-ci doivent-ils être visibles ? Je crois que c’est là un des rôles les plus importants d’un réalisateur : doser les sentiments. A chaque moment, je prends une décision par rapport à ça. C’est pour cela qu’au cours du tournage je n’ai pas de certitudes, mais tourne plusieurs séquences, plusieurs plans, avec des sensibilités plus ou moins appuyées.
Mais les très longs plans-séquences, vous les aviez prévus dès le début ?
Non, au départ, je ne prends aucune décision. J’utilise beaucoup d’alternatives pour pouvoir décider au montage. Car à ce stade, vous êtes condamné aux images que vous avez en mains, vous ne pouvez pas, comme un romancier, changer un mot et en insérer un nouveau.
Les dialogues sont en revanche très écrits…
Oui, tout est écrit à l’avance. Une toute petite part est laissée à l’improvisation. Cela a influencé le casting. J’ai essayé de ne retenir que ceux qui étaient capables d’apprendre par cœur des pans de dialogue énormes, mais aussi de les intérioriser, pour ne pas donner l’impression de les réciter.
Des professionnels ou des amateurs ?
Fifty-fifty. Le rôle principal n’est pas un professionnel, il ne vient pas du théâtre mais du stand-up, c’est son premier film. On le voit dans chacune des scènes, et lors du casting, c’est le seul à m’avoir donné l’impression qu’il pouvait relever ce défi. Il ne ressemblait pas à ce que j’envisageais, je voulais quelqu’un de plus maigre… Mais j’ai vu qu’il était capable de soulever cette charge. Le jeune imam est un amateur aussi : c’est Akin, mon coscénariste.
Le film est un drame, mais souvent très drôle dans sa manière de regarder son héros…
Oui. A l’âge que j’ai, il m’arrive désormais de trouver comiques énormément de situations. Dans le film, je crois que ces situations naissent du fait qu’un jeune, pour pouvoir exister, essaie d’extérioriser, d’une manière un peu amateure, tout ce qu’il a en lui. C’est également ce que j’ai vécu moi-même étant jeune, enfin jusqu’à un certain point. Les relations humaines sont à la base comme ça : pour gagner la lutte, l’homme déverse tout ce qu’il a en lui.
Vous avez grandi dans cette région, non loin de Troie, et l’on voit dans le film une réplique du cheval de bois. Quelle résonance a ce site pour vous ?
Pour les habitants de la région, lorsque j’étais enfant, Troie n’était pas un sujet. Mais pour moi si, car mon père était un passionné d’histoire et nous emmenait souvent sur le site. Ce qui m’a marqué, c’est surtout ce qu’en a raconté Heinrich Schliemann [archéologue allemand amateur, découvreur des sites de Troie et de Mycènes, ndlr] dans ses livres. Mon père était capable de raconter cette chronique comme si c’était un conte…
Ce n’est pas la première fois que vous mettez en scène un écrivain. Avez-vous songé à en devenir un ?
(Il sourit.) Oui, effectivement. Mais cela me semble plus difficile. J’ai une approche plus naturelle du monde visuel. Dans ma jeunesse, j’ai exercé la photographie, mais j’ai aussi écrit quelques nouvelles, des poèmes. Je lis énormément, et évidemment, j’adore la littérature. Peut-être même plus que le cinéma.
Hormis les grands Russes, qui lisez-vous ?
Camus (pause). Un grand nombre d’écrivains pourraient me venir à l’esprit. Mais classiques plus que contemporains
Ce qui filtre du contemporain turc dans le film, ces 300 000 instituteurs en attente de postes, semble absurde et inquiétant. Avez-vous voulu brosser un portrait du pays ?
Oui, en filigrane. Cela m’avait étonné la première fois que l’on m’avait parlé de ces 300 000 postes… Des gens qui rêvent de devenir professeurs de littérature et se retrouvent dans l’obligation, après trois ou cinq ans d’attente infructueuse, de devenir policiers. Cela m’avait paru réellement au-delà de l’étrange. Il s’agit quand même de mondes totalement contraires…
Vous avez souvent dit ne pas vous intéresser à la politique. Suivez-vous néanmoins ces élections ?
Oui, bien sûr (sourires).
Avez-vous des espoirs particuliers ?
Bien sûr (rires).
Mais vous n’avez pas envie de parler ce que vous espérez…
It’s obvious ! [«vous pouvez deviner ce que je souhaite»]. Disons qu’en Turquie, il y a actuellement une très grande polarisation, qui s’est accélérée après les événements du parc Gezi [mouvement protestataire de 2013]. C’est comme si l’on avait coupé en deux la Turquie avec un grand couteau. Et ces élections constituent en quelque sorte la rencontre, la manifestation la plus importante de cette polarisation manifeste.
Elisabeth Franck-Dumas Libération.