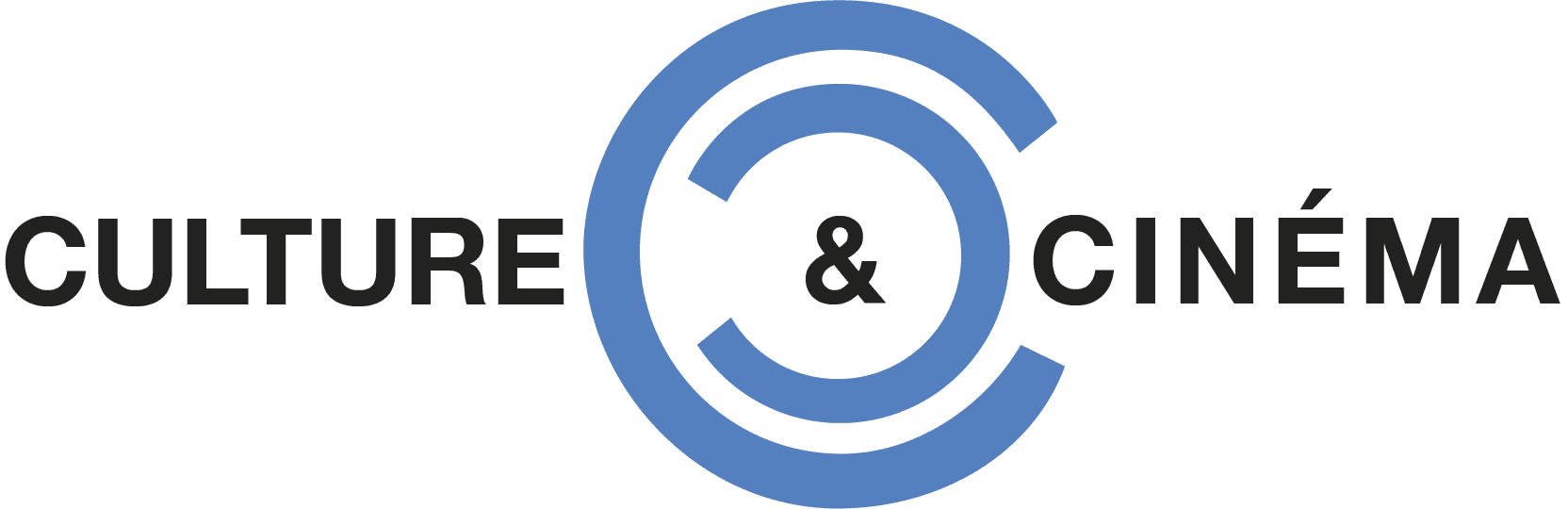Cette année, est l’occasion de célébrer un cinéaste japonais trop peu connu : Mikio Naruse. Après la sortie de la monographie que lui a consacrée Jean Narboni, L’occasion de se pencher sur l’univers d’un cinéaste passionnant…
Petite mise au clair
Commençons par répéter ce que tout le monde semble dire afin de présenter ce cinéaste : il est le quatrième grand du cinéma classique japonais, injustement oublié à un moment où les trois autres, qui sont Mizoguchi, Ozu et Kurosawa , sont encore et toujours d’actualité, que cela soit sous la forme de rétrospectives, d’inédits, de reprises ou d’éditions DVD. Mais parce qu’il est peu connu, on peut dire sans exagération, et sans cacher par ailleurs la profonde admiration que nous portons à ce cinéaste, que 2006 sera bel et bien l’année Naruse, marquée par la publication d’un coffret quatre DVD regroupant trois des films les plus fameux du réalisateur japonais, ainsi qu’une rétrospective de l’intégralité de son œuvre qui aura lieu à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Mais c’est bien Jean Narboni qui, en publiant une monographie entièrement consacrée à Naruse il y a quelques mois, a ouvert les festivités. Critique fameux mais trop peu productif – et dont on espère un jour voir publier un recueil de ses textes – Jean Narboni, en choisissant de s’axer uniquement sur Naruse, faisait un geste fort, en affirmant de façon concrète que ce cinéaste, dont on évoque le nom seulement du bout des lèvres, était tout simplement l’un des plus grands cinéastes au monde.
Brièvement, on peut considérer que la place mineure, comparée aux cinéastes japonais évoqués plus haut, accordée aujourd’hui à Mikio Naruse s’explique par au moins une raison principale : la radicalité du style, c’est-à-dire de la mise en scène. Le style de Naruse est à première vue moins impressionnant que celui d’un Kurosawa, virtuose, baroque et épique, que celui d’un Ozu, minimaliste et radical, ou enfin d’un Mizoguchi, épuré et musical. Il est certain qu’un plan de Naruse est à première vue moins frappant qu’un plan de ses confrères. À ce titre, un de ses assistants, dans l’un des bonus DVD, raconte que la vision des rushs tournés dans la journée était toujours inquiétante car, face à la simplicité de ces plans, plusieurs membres de l’équipe se demandaient si cela suffirait, s’il y avait assez de matière visuelle pour que des gens payent leur billet et se rendent dans une salle. Mais c’est au montage que tout prenait forme et que le génie de la mise en scène de Naruse éclatait au grand jour. Comme cela, l’air de rien, tous ces plans qui à l’origine ne payaient pas de mine s’enchaînaient parfaitement, s’imposant comme l’évidence même.
Mais à voir et revoir plusieurs des films de Naruse, on peut aussi tout simplement se dire que ce cinéaste est inclassable et étrange. Que cherche à nous dire Naruse à travers ses films ? Quel est son point de vue ? Y a-t-il une dénonciation, un parti pris clair exprimé ? On peut bien évidemment en douter. Naruse semble tout simplement faire un constat de ce qui est, de ce qui se passe, sans jamais aller véritablement ouvrir une porte de sortie. Naruse n’est pas un cinéaste politique. Il n’analyse les problèmes sociaux à travers des causes et des conséquences dont l’étude serait censée fournir l’esquisse d’une solution. Naruse n’est pas, comme le dit Audie E. Bock, un humaniste : « Aucun humanisme dans ce cinéma, car Naruse n’attribue pas la souffrance humaine à des causes externes ; aucun idéalisme non plus. »
La souffrance humaine qui se déploie dans une proportion impressionnante dans les films de Naruse n’aurait donc en partie pour origine que ce que l’on appelle la vie. La force de son cinéma est qu’il nous renvoie à ce qui est impalpable et invisible, à l’éternelle souffrance, l’éternelle peine considérée comme le lot de tout homme quel qu’il soit. Naruse nous laisse bouche bée face à ce constat. Comme il le dit lui-même : « Depuis mon plus jeune âge, j’ai compris que le monde dans lequel nous vivons nous trahit. »
Les hautes trahisons
La trahison induit un avant et un après : c’est la rupture entre ce qui a été et ce qui est aujourd’hui, entre le monde tel qu’il était et le monde tel qu’il est. C’est un ordre des choses, un espoir à jamais brisé et souillé. Naruse fait généralement débuter son récit à un moment où « le mal est fait », pour reprendre une expression que Jean Narboni utilisait à propos de Maurice Pialat. Dès le début d’un film de Naruse, la cause est entendue : tout a été perdu, et ce bien avant que nous découvrons ces personnages. À ce titre, le début de Nuages flottants, sorti en 1955, est révélateur, puisqu’il s’agit d’images d’actualités de rapatriés japonais en 1945, après la défaite. Ces images attestent d’une cassure fondamentale entre deux Japon, entre deux sociétés, et induit donc que tout ce qui a été fait, dit ou mis au point antérieurement, a aujourd’hui volé en éclat, qu’il s’agit de repartir à zéro en faisant table rase de ses anciens rêves. L’erreur fondamentale que font ses personnages, ce qui fait l’aspect tragique de leurs histoires, est que ces hommes et ces femmes que nous voyons ne veulent pas renoncer à ce qui existait avant. Ils s’accrochent désespérément à la moindre parcelle de survivance, essayant de raviver la flamme qui jadis illuminait leur vie. Nuages flottants, considéré comme le chef d’œuvre de Naruse, est révélateur de cette attitude. Ce film nous raconte l’histoire d’un homme et d’une femme qui, en poste dans le sud asiatique pendant la guerre, se sont aimés. Après la défaite, la jeune femme retrouve celui qui était son amant et qu’elle avait perdu de vue. Mais celui-ci est retourné vivre avec sa femme et ne peut plus la quitter. Ce synopsis de base n’évoluera pas deux heures durant. Ces deux amants, bien qu’étant amoureux l’un de l’autre, ne peuvent ni vivre l’un sans l’autre, ni vivre ensemble. Ce qui était beau, clair et limpide à leur rencontre s’est considérablement compliqué. Quelque chose a été rompue définitivement. Le couple ne peut envisager l’avenir, et se traîne dans un présent pesant en ne cessant d’évoquer un passé qui n’est plus.
Ce qui a été brisé ne peut être uni à nouveau. Il apparaît impossible de rassembler les morceaux, de continuer à vivre malgré les affronts. Jamais il n’y aura, dans ce cinéma, de renaissance. Les personnages ont beau dire qu’ils se pardonnent, ont beau vouloir recommencer à zéro, rien n’y fait. La rupture, la trahison, c’est quelque chose de poisseux qui vous colle à la peau, dont on ne peut se débarrasser ; une névrose obsessionnelle à laquelle on revient encore et toujours. C’est un radotage perpétuel qui fait de nous des monstres remplis de rancunes.
Les temps ont changé et le vent a tourné. Certains ont négocié ce virage sans y laisser trop de plumes. D’autres n’ont absolument rien vu venir, ne peuvent que constater l’ampleur des dégâts et tente alors désespérément de maintenir un on ne sait quoi, en usant de moyens qui se révèlent être totalement pathétiques. Dans Nuages d’été, Wasuke souhaite que ses fils ou, dans le pire des cas, sa famille, gardent les terres que lui a léguées son père. Il se sent investi par une mission qui est le but de sa vie, à savoir transmettre ce qui lui a été transmis. Ce personnage est d’une certaine façon le garant tradition. Mais la vie, les évolutions de la société et des mœurs en ont décidé autrement. La faiblesse fondamentale qui est la sienne et, disons le franchement, sa bêtise, ne lui donnent pas les moyens de lutter contre ces évolutions qui font voler en éclat la vision archaïque du monde qui est la sienne. Mais, Naruse oblige, ce personnage a de multiples facettes, et il serait illusoire de tenter d’émettre un jugement à son encontre. Tour à tour bourreau et victime, il se situe dans un entre-deux, tiraillé entre les devoirs qu’il croit être les siens et la réalité qui va dans un sens autre. Impossible de ne pas le haïr en voyant son attitude face à la branche féminine de la famille, mais impossible aussi de ne pas être bouleversé en le voyant réaliser que son fils va bien quitter la maison pour aller étudier à la ville. Ce personnage pensait avoir toutes les cartes en main pour réussir sa vie et transmettre ce qu’il avait, c’est-à-dire assurer la survivance de sa famille et de son rang. Mais entre-temps, la vie a fait son œuvre…
Pour qu’il y ait trahison, il faut qu’il y ait trahison de quelque chose, d’une règle, une base solide. Ce qui est frappant dans un film comme Nuages d’été, c’est que la vie, ses évolutions et ses accidents, vont à l’encontre de la survivance du rite. Le rite, conçu pour être au centre de la vie du citoyen, conçu pour organiser la vie de la cité, est ce qui tente de maintenir un semblant de passé dans le présent. Le rite fait comme si la trahison n’existait pas. Il se doit de prolonger malgré tout. Wasuke voudrait marier son fils dans les règles, en suivant la tradition, tout en sachant pertinemment qu’il n’en a pas les moyens. Il doit alors emprunter de l’argent, se livrer à des manigances plutôt lamentables afin de pouvoir organiser une cérémonie digne de ce nom. Autour du rite, c’est-à-dire de ce qui se répète, c’est l’éclatement, la division. Le rite n’est qu’une façade d’union. Dans Frère et sœur, les plans magnifiques de la fête des morts font suite à la querelle d’une extrême violence survenue entre le frère et la sœur. À la désunion s’oppose l’union, à ce qui perdure s’oppose ce qui vient de se briser.
La trahison intervient à partir du moment où un individu a décidé de vivre la vie qu’il entend et de ne pas se soumettre à l’ordre que l’on souhaite lui imposer, fut-il ancestral. Dans Frère et sœur, Mon décide quitter la campagne et sa famille afin de gagner sa vie à la ville. Naïve et idéaliste, elle passe de désillusion en désillusion, et revient au foyer enceinte d’un jeune étudiant dont elle n’a plus de nouvelles. Battue par son frère, elle retourne à Tokyo, avorte et, afin de gagner sa vie, devient prostituée. Le frère et la sœur qui ne cessent de se battre sont en fait tous les deux victimes de ce que la vie a fait à leurs espérances, de ce qu’ils voulaient. La sœur, cherchant autre chose que la vie morne et ennuyeuse de la campagne ou encore un mariage d’intérêt, est passée de catastrophes en catastrophes et se considère dorénavant avilie à jamais. Malgré son jeune âge, elle pense que sa vie est un échec, et que les hommes, ceux en qui elle avait mis le plus d’espoir, ceux dont elle attendait la félicité, se sont révélés être les pires créatures qui soient. Le frère, de son côté, s’estime trahi par cette sœur qu’il a adorée durant toute son enfance. La petite fille qu’il a protégée, choyée est devenue une femme qui a choisi d’être indépendante. Mais parce qu’elle vit cette existence et qu’elle est alors montrée du doigt, le frère, parce qu’il est faible et prisonnier des idées étriquées de la pensée rurale japonaise, rejette sa sœur, ne veut plus entendre parler d’elle. Au fond, il considère, en agissant comme elle l’a fait, qu’elle a trahi le petit garçon et la petite fille qu’ils étaient. Ce qu’il aurait souhaité, c’est garder la petite fille qu’elle était près de lui toute sa vie. Mais la vie en a décidé autrement.
C’est d’espérances trahies dont il est aussi question dans Le Repas. Dès le début, la femme au foyer qu’est Michiyo fait part en voix off de la profonde déception qui est la sienne. Son mariage est d’une monotonie désespérante et le quotidien n’offre rien de grandiose. Rien de ce qu’elle avait espéré n’a pu avoir lieu. Elle est comme prisonnière. Elle reproche à son mari le peu de communication qu’ils ont. Elle est déçue. L’arrivée de sa jeune nièce vient alors bouleverser le couple. Cette jeune nièce, vive, pétillante et légèrement irritante, est à l’opposée de ce qu’est Michiyo aujourd’hui. Cette jeune fille symbolise ce qu’était Michiyo avant la déception qui est la sienne. Elle n’a pas encore été trahie par la vie, a des espoirs à la fois lumineux et stupides.
Mais à la différence de Voyage en Italie, c’est-à-dire d’un catholicisme à la Rossellini, il n’y a chez Naruse, comme nous l’avons déjà dit, aucune renaissance possible, c’est-à-dire aucun véritable happy-end, fut-il dans les larmes et dans le chaos. La fin de ce film laisse songeur car, bien que le couple se remette ensemble après une courte période de séparation, on ne voit pas en quoi l’avenir serait différent du passé. Ce que nous dit cette femme, c’est que la vie, pour elle, consistera à accepter cet état de fait et donc,de façon sous-entendue, à se contenter de cette vie qui la désespère. Ce couple ne va pas repartir sur des bases nouvelles. Alors qu’ils sont dans le train qui les ramènent chez eux, le mari de Michiyo dort. Assise à côté de lui, elle en profite pour déchirer et jeter par la fenêtre la lettre qu’elle lui avait écrite durant cette période de séparation afin de s’expliquer. Alors qu’il s’éveille légèrement, elle souhaite lui dire de vive voix ce qui était contenu dans la lettre. Mais son mari préfère se reposer et se rendort. Cette fin, malgré ce que la femme va ensuite nous dire, sonne comme le triomphe du refoulé. Ce qu’elle trahit à ce moment là, c’est elle-même, ses idéaux et ce qu’elle espérait. Selon une idée de morale de soumission à cet homme qui travaille et endure la vie, elle accepte ce qu’elle ne pouvait au début du film supporter.
La trahison, cela peut être ce moment où ce que l’on avait espéré de l’autre ne se réalise pas. Mais l’attente de l’autre est quelque chose d’ambigu. Attend-on ce que l’autre a promis ou bien est-ce l’idée de l’autre qui n’est qu’un fantasme ? En fondant des espérances sur autrui, l’individu est aveuglé par sa recherche d’idéal. Il projette alors sur untel ses propres fantasmes sans tenir compte de la réalité. Ce ne sont alors pas forcément les autres qui ne sont pas à la hauteur, mais plutôt la constatation que le réel est différent de celui que nos cerveaux enfantins avaient espéré. D’où, chez Naruse, cette absence d’humanisme, que nous évoquions plus haut, c’est-à-dire le refus de voir dans les causes extérieures les responsables d’une situation, et le refus de prendre parti pour tel ou tel personnage, tel ou tel mode de vie. Il n’y a chez lui aucune promesse de libération. L’air de rien, discrètement, sur la pointe des pieds, à travers des moyens minimes, Naruse nous peint un monde d’une portée dramatique intense.
Florian Guignandon Critikat Nov 2006