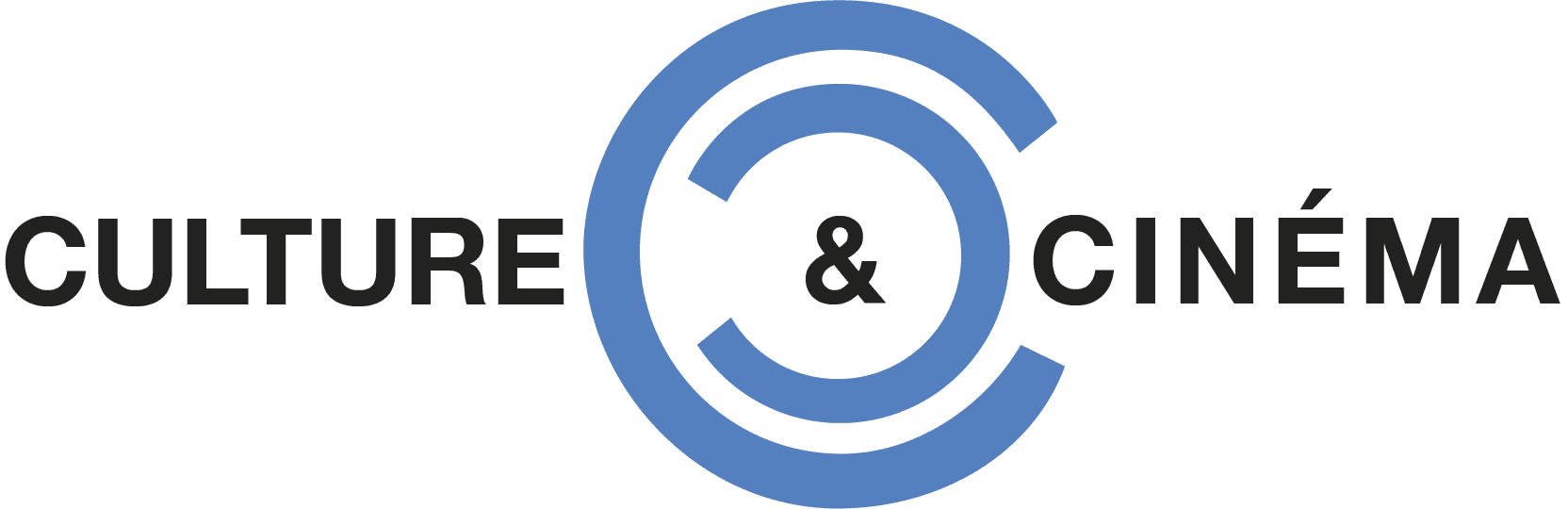Le prolifique réalisateur s’est éteint jeudi à 106 ans. Il laisse une filmographie vertigineuse, empreinte de splendides méditations.
En 1990, au moment de la sortie de Non ou la vaine gloire de commander,Manoel de Oliveira est déjà qualifié de «jeune vieux cinéaste lusitanien». Il a déjà 82 ans, mais il est encore au seuil d’une filmographie qui va compter encore plus d’une vingtaine de longs métrages. Le grand cinéaste portugais, intimidant aussi bien par sa longévité (106 ans) que son altière stature intellectuelle, était semblable à une sorte d’anomalie esthético-temporelle.
Un pied dans ce XIXe siècle romantique qu’il n’a cessé de citer via la figure tutélaire du romancier Camilo Castelo Branco − adapté(Amour de perdition) puis représenté (le Jour du désespoir) −,ancré dans le modernisme avec la radicalité de ses choix de mise en scène et la spécificité de sa direction d’acteur − «avec ces sautes de regards qui créent de véritables faux raccords à l’intérieur du plan et qui font que l’espace se désoriente et se réoriente perpétuellement», selon l’expression du critique Emmanuel Burdeau.
Par Clément Ghys etClémentine Gallot Libération. 2 O4.15.
va Oliveira !
DISPARITION
Le réalisateur portugais est mort, jeudi, à 106 ans, dans sa maison de Porto. Doyen des cinéastes, il avait commencé à l’époque du muet.
La nouvelle de la mort de Manoel de Oliveira, jeudi, à 106 ans (et demi !) n’a a priori rien d’une surprise, et pourtant, plus qu’aucune autre disparition d’un immense cinéaste aimé, celle-ci donne le vertige, tant la longévité, la productivité et l’ahurissante fringance des dernières apparitions du Portugais centenaire avaient travaillé au long cours à semer en nos esprits l’idée de son immortalité. Par-delà le public de cinémathèque, plus personne ou presque ne voyait ses films au Portugal, ce qui n’empêchait pas ces dernières années les infos de relayer dans les plus menus détails les fréquentes hospitalisations du totémique monument – quant au gouvernement portugais, il a décidé jeudi de deux jours de deuil national en son hommage.
Vertiges. Vivant, Oliveira et sa monumentale filmographie altière (une soixantaine de films courts et longs) façonnée surtout sur le tard et comme depuis un au-delà du temps, nourrissaient déjà quelques vertiges. Si l’on songe par exemple que ce cinéaste, dont l’œuvre récente n’évoque que lenteurs et langueurs infinies à ceux qui méconnaissent les prodiges romanesques de ses chefs-d’œuvre (Amour de perdition, Francisca, Val Abraham, la Lettre…) ou son humour de statue matoise, a prêté corps au futurisme ivre de vitesse des années 30, à travers notamment une brève carrière de champion automobile.
Qu’il s’est entiché très jeune du cinéma, art alors à peine plus vieux que lui, notamment par identification en direct au burlesque pionnier et dandy de Max Linder, mort, lui, en 1925. Qu’il a peut-être lu à leur parution, ou tout du moins qu’il l’aurait pu, les œuvres de Fernando Pessoa et les derniers volumes de la Recherche du temps perdu de Proust. Qu’il fit l’acteur dans le premier film sonore et musical portugais, en 1932. Que sa filmographie survole neuf décennies de sa première réalisation, au temps du muet finissant (le court documentaire Douro, travail fluvial en 1931), à hier ou presque (sa dernière œuvre, O Velho do Restelo, une divagation autour de la figure de Don Quichotte, était présentée en septembre dernier à la Mostra de Venise). Qu’aux journalistes plus ou moins verts qui venaient le rencontrer en sa demeure de Porto et quérir sa vénérable parole de pythie hors du temps, il aimait raconter, entre autres facéties et paradoxes temporels saisissants, comment son propre père lui avait confié avoir assisté à l’inauguration de la tour Eiffel, alors encore inachevée.
S’il se trouva une personne pour ne pas le soupçonner d’être immortel – à force de ridicule, les critiques ont appris à cesser de parler de son dernier film en date comme d’un possible testament il y a au moins une vingtaine d’années -, c’était lui-même. Au début des années 80, Oliveira est l’auteur septuagénaire d’une filmographie longtemps contrariée par le climat de la dictature salazariste et la santé erratique de l’industrie du cinéma portugais. Une œuvre éparsément disséminée sur près d’un demi-siècle, composée surtout de documentaires et d’une demi-douzaine de longs métrages de fiction seulement – le premier, Aniki Bobo, date de 1942, le deuxième, réalisé vingt ans plus tard, s’assimila aux vagues vertes du Novo Cinema, incarnées par de jeunes gens en âge d’être ses fils.
Paradoxe. Si l’on considère qu’il lui restait encore à en réaliser une trentaine, cela fait de lui presque un cinéaste novice, tout à son initiation lorsqu’il s’offre alors le luxe de réaliser un testament filmé, la Visite, ouMémoires et confessions. Un film qui ne sera projeté qu’une fois, à la Cinémathèque portugaise et devant quelques dizaines de spectateurs choisis (dont beaucoup sont morts avant lui), tourné avec sa femme Maria Isabel, de dix ans sa cadette, en leur maison sur le point d’être vendue pour cause de faillite. Un film qui attise depuis trois décennies curiosités et spéculations, demeuré dans un coffre lisboète et jamais vu depuis, envisagé par son auteur en testament et pourtant, encore une œuvre de jeunesse.
Ce beau paradoxe synthétise quelque chose de l’aporie magnifique à l’œuvre dans les films réalisés depuis, presque au rythme d’un par an, à la fois traversés par un romantisme très XIXe et nourris d’une radicalité politique et esthétique héritée de la post-modernité, souvent articulés à la palpitation de grands textes littéraires (le Soulier de satin de Claudel, Madame Bovaryde Flaubert, la Princesse de Clèves de Madame de Lafayette, les Lusiades de Camões, Amour de perdition de Camilo Castelo Branco, le Principe de l’incertitude d’Agustina Bessa-Luís…), ou à d’autres films que les siens (Belle toujours, quarante ans après Belle de jour de Buñuel), à l’autobiographie (Porto de mon enfance), voire à d’intimes terreurs (celle de l’épuisement dans le Principe de l’incertitude, celle d’être spectateur de la mort des siens dans Je rentre à la maison, son plus important succès en France).
Une filmographie jugée intimidante par la durée de ses segments, son proliférant feuilleté de souvenirs et de culture, ses penchants utopiques, son altière stature intellectuelle et politique, ou la difficulté à situer l’époque depuis laquelle elle nous parlait si crûment de la nôtre – jusque dans le dernier long métrage que l’on aura vu de lui, Gebo et l’ombre, pièce conclusive d’une œuvre toujours sauvée du pourrissement mélancolique et de la tentation du crépuscule par un perpétuel ressourcement de sa croyance en les souveraines puissances de l’illusion et de l’imaginaire.
JULIEN GESTER 2 AVRIL 2015 Libération.
Concernant Manoel de Oliveira, les récentes chroniques nécrologiques rappellent comme il se doit la longévité surprenante de sa carrière, qui aurait recouvert près « d’un siècle de cinéma ». Ce n’est pas tout à fait exact cependant. La vie du plus grand des réalisateurs portugais est l’un de ces miracles qui parsèment l’Histoire du cinéma. Révélé au monde avec Aniki Bobo en 1942, qui préfigure l’arrivée du néo-réalisme italien, Oliveira est contraint de mettre entre parenthèses son activité de réalisateur pour cause de régime fasciste qui annihile toute possibilité d’industrie cinématographique au Portugal. Issu de la bourgeoisie catholique de Porto, il reprend l’affaire familiale, s’autorisant çà et là quelques courts-métrages et documentaires auto-produits et modestes, signes d’une vocation artistique jamais oubliée mais qui ne pourra pleinement reprendre que bien plus tard après la fin de Salazar, dans les années 1970. C’est en cela que le parcours d’Oliveira est unique : il n’est pas un vétéran qui a pu prolonger sa carrière sur une durée exceptionnellement longue, mais un réalisateur débutant frustré à qui la providence a offert une seconde chance tardive, chance qu’il a saisie et honorée à bras le corps, pouvant enfin se décharger d’une rétention créative contenue depuis trois décennies.Manoel de Oliveira – Singularité d’un cinéaste
À quoi aurait ressemblé l’œuvre du réalisateur s’il avait pu la poursuivre dans la continuité d’Aniki Bobo ? Impossible de le savoir, mais il est fort probable que la force de son cinéma s’y serait exprimée autrement et peut-être épuisée plus rapidement. Cas singulier dans l’histoire du cinéma, à 70 ans passés Oliveira était un « jeune » cinéaste qui a pu, dès lors, exercer son métier pendant 35 ans. Sans doute l’idée pesante que tout cela pouvait lui être ôté à nouveau, que cette nouvelle vie puisse s’arrêter abruptement, a guidé sa façon de faire des films, abordant chacun d’entre eux à la fois comme le premier et le dernier. On retrouve là la mentalité de l’artisan : orfèvre et éternel apprenti, dévoué à son ouvrage mais jamais réfractaire à la découverte et la nouveauté. Rares sont les cinéastes dont le travail n’a pas été racorni par des années de méthode et de professionnalisation (choses qui arrivent de plus en plus tôt de nos jours). Pour Oliveira, c’est son goût du voyage qui l’a préservé : il a exploré le cinéma comme on explore un pays, en le visitant, en l’observant de près, de loin, en y passant, en s’y arrêtant, en tentant de comprendre son histoire sans jamais se l’approprier, toujours en retrait mais sans effacer sa présence. C’est pourquoi ses expérimentations ne sont jamais racoleuses, et ses audaces formelles jamais prétentieuses, ce sont les possibilités du cinéma qui l’intéressent, pas son domptage.
Voyager, c’est aussi relier un point A à un point B. De part et d’autre des films d’Oliveira, se trouvent des pôles qui exercent chacun leur tour leur attraction magnétique. D’où une oscillation constante qui parcourt tout son œuvre, qui trace le lien entre le désir et la passion (Francisca), l’amour et la frustration (Amour de Perdition), les sentiments bourgeois et la représentation sociale (Singularités d’une jeune fille blonde), le théâtre et le cinéma (Mon Cas), le cinéma et la parole (Je rentre à la maison), la langue et le monde (Un film parlé), le monde et le Portugal (Voyage au début du monde), le Portugal et son Histoire (Non, ou la vaine gloire de commander), lui-même et Buñuel (Belle toujours), etc. Cette oscillation est sans fin, dans le sens où le lien se fait sans conclusion, sans morale, sans but puisque le cinéma d’Oliveira n’est régi que par un seul principe, celui de l’incertitude, cette étrangeté qui chamboule tout repère pour le spectateur et toute facilité pour le réalisateur. Et de l’incertitude vient l’indéfinissable, ce qui rend ses films souvent difficiles à cerner, et son cinéma peu aimable, puisqu’il ne livre aucune clé, ne conforte jamais le public dans ses croyances, prend toujours le cinéphile à revers (combien de fois lui a-t-on reproché sottement de faire du théâtre filmé ?). Comme tout grand artiste reconnu, Manoel de Oliveira était respecté, et peut-être même admiré, mais peu aimé (voire méprisé), ses films étaient accueillis avec froideur, distance et incompréhension (puisque ils ne sont pas là pour être « compris », mais seulement entendus). On n’aime que ce qui est rassurant. Son cinéma ne l’était pas. Pas du tout même. Et avec les années, les films de ce réalisateur qui a été hanté par l’étreinte de la mort plus longtemps que tout autre, sont devenus de plus en plus inquiétants, teintés de l’angoisse propre à ceux qui savent qu’ils vivent en sursis, et qu’il n’y a pas d’apaisement possible avant la mort.
L’angoisse, on la retrouve dans l’idée obsessionnelle de rémanence, cet instant imprécis où l’immatériel s’offre à la perception mais n’existe déjà plus – ce qui pourrait être une définition du cinéma. C’est cette persistance à être là sans l’être, ce lien indicible entre paraître et disparaître, entre la vie et la mort, qu’a tenté de filmer Oliveira, peuplant son œuvre de personnages fantomatiques et de spectres. C’est ce qui a ancré son cinéma dans le présent, même après le passage au XXIe siècle, et après que lui-même ait passé le cap des cent ans, survivant jusqu’à une époque à laquelle il n’appartenait plus (mais vers laquelle il tisse un lien), tel un fantôme. Et c’est pourquoi il n’a pas été dépassé par son temps, au contraire, car à des questions désuètes (propres au romanesque portugais), il a répondu de la plus moderne des façons, par des enjeux de cinéma inédits et indifférents aux codes esthétiques en vigueur. Il n’est pas un auteur, dans le sens où on l’entend actuellement (une personnalité qui se constitue sur le dos du film) mais un cinéaste, soit un artiste dont chacun des films a été une proposition de ce qu’aurait pu et pourrait encore être le cinéma [1]. Un homme totalement libre en somme. Des cinéastes, aujourd’hui, il n’en reste plus beaucoup ; l’un des plus importants s’est éteint le 2 avril dernier. Mais son œuvre subsiste par la rémanence en s’inscrivant dans la constellation cinématographique, tel un astre à part qui s’est consumé selon ses propres lois physiques. En l’observant dorénavant briller du feu de son extinction, on ne pensera pas que le cinéma était meilleur avant. Mais on songera à quoi il aurait pu ressembler aujourd’hui…
Notes
[1] C’est à ça que l’on reconnaît l’indépendance des génies, de Carl Dreyer à Orson Welles (qui aurait eu cent ans cette année, et qui était donc plus jeune que Manoel de Oliveira).
Critikatt.com par Matthieu Santelli. 7 avril 2015