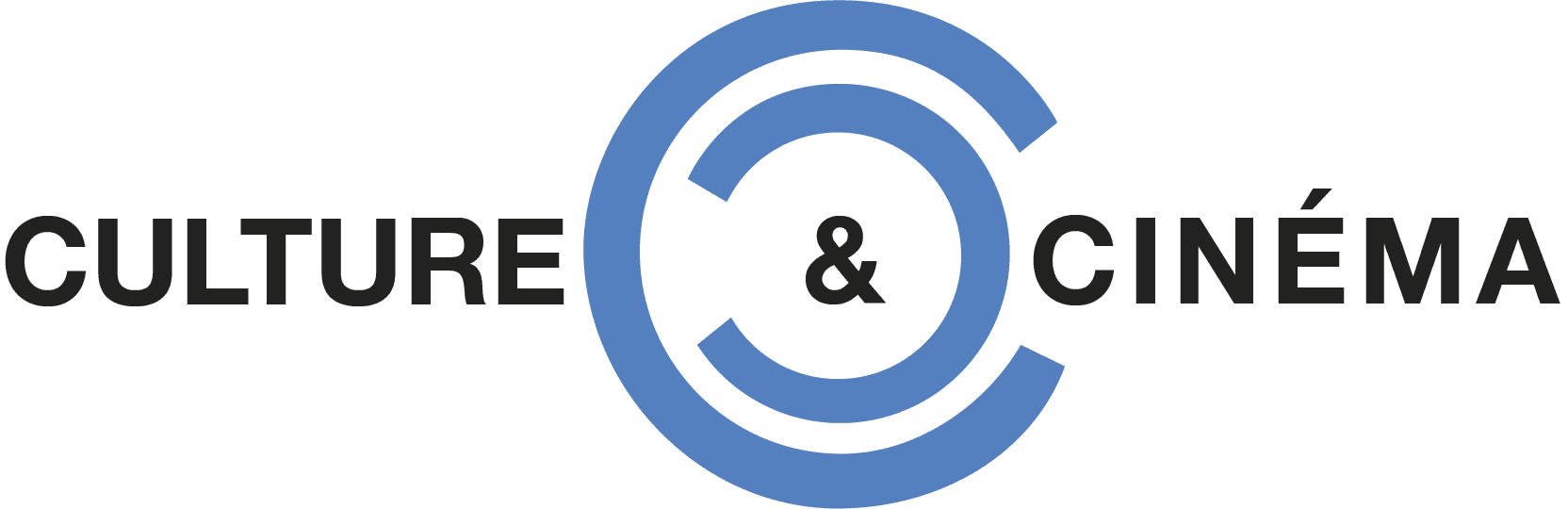Le mouvement érectile irrépressible de la langue de Dita Parlo (ou pourquoi le cinéma convulsif de Jean Vigo gagne toujours à être connu)
Alors que le prix Jean Vigo, l’une des récompenses les plus prestigieuses du cinéma français, va être
remis, le 11 octobre prochain pour la 70e fois, une rétrospective intégrale et restaurée par Gaumont et
distribuée par Malavida de l’œuvre de Vigo, (bien) nommée « L’Étoile filante », nous restitue sa beauté,
sa jeunesse, son élan inentamé, comme au premier jour.
Le Père Jules (Michel Simon), un ancien marin de haute-mer devenu marinier sur une péniche qui circule
sur la Seine, fait visiter son antre, sa “cambuse” à “la patronne” (Dita Parlo), la jeune mariée du patron
(Jean Dasté). Il a accumulé là des souvenirs souvent dérisoires de ses voyages autour de la Terre. La
patronne s’extasie sur un couteau : « C’est un navaja », mâchonne Jules, avant de s’effiler le pouce, pour
montrer combien l’outil est bien aiguisé. Puis il se penche sur sa main et lèche rapidement le mince filet
de sang qui a surgi. Mais la patronne, dans un mouvement irrépressible de la langue, a ouvert sa bouche et
s’apprêtait elle aussi à lécher la plaie.
Combien de temps dure ce plan ? Deux secondes ? Peu importe. Il est d’une rapidité telle qu’on peut ne
pas le voir, y prêter attention, l’oublier aussitôt, voire le refouler, tellement il est violent, évidemment
sexuel. La patronne a réagi à la vue du sang comme un caméléon à la vue d’un moustique, mais le
moustique s’est envolé avant que le caméléon ne sorte son arme. Cette scène se trouve dans L’Atalante, le
seul long métrage et le dernier film que réalise Jean Vigo avant sa mort, en 1934, et son chef-d’œuvre.
Je ne sais pas trop ce qu’est la poésie au cinéma – il faut toujours se méfier du mot poésie, souvent utilisé
à tire-larigot avec des connotations un peu neuneus, alors que la poésie, c’est la forme
même, quintessentielle, comme les quatuors de Beethoven sont le jus pur de son génie. Mais il y a
quelque chose de certain chez Vigo : il filme la réalité et en saisit la beauté au même moment, à l’instant,
comme le suc coloré et sucré qui coule d’un fruit qu’on presse, même quand il apparaît à un endroit où on
ne l’attendait pas. Chez Vigo, il y a toujours une idée par plan, des fulgurances qu’on voit à peine, comme
le mouvement érectile irrépressible de la langue de Dita Parlo.
Des plans de bouche tordue et des ballets de bulles somptueux
Dès son premier film, A propos de Nice (1930), film essentiellement de montage où il oppose la laideur et
la vanité des riches qui se pavanent sur la promenade à la beauté des ruelles des miséreux, Vigo glisse un
scène délicieuse et qui pour le coup ne passe pas du tout inaperçue : une femme élégante assise sur une
chaise, en extérieur qui sans bouger change d’habits puis finit totalement nue ! (Vigo a envie de regarder
sous les jupes des filles et sous les chemises de nuit des garçons, et il le fait, sans hésiter, sans vergogne,
sans procurer le moindre désir honteux au spectateur).
Son deuxième film, La Natation par Jean Taris ou Taris, roi de l’eau (1931), est un court métrage sur le
grand nageur Jean Taris. C’est magnifique : d’un documentaire très didactique sur la natation et sur la
technique de la nage nommée « crawl » – que le cinéaste et le nageur décrivent avec une grande précision
– Vigo tire des plans de bouche tordue sur le côté (pour respirer) et de ballets de bulles absolument
somptueux. Ce n’est pas un réalisateur de France Télévisions qui ferait ça. Ou même
l’horrible Leni Riefenstahl, l’amie d’Hitler, à qui l’on pardonne tout parce qu’elle aurait, dans son film
nazi sur les Jeux olympiques de Berlin de 1936, Les Dieux du stade (1938), posé les codes fondamentaux
du filmage du sport.
Calembredaines et billevesées ! Tout est déjà dans les neuf minutes de Taris, roi de l’eau ! Avec, de
surcroît, de l’humour, et ce dès le générique (la chanson Maman, les p’tits bateaux qui vont sur l’eau).
Un cinéaste des plus influents
Jean Vigo a su très tôt s’entourer des meilleurs : le chef op Boris Kaufman, frère du cinéaste russe Dziga
Vertov, qui remportera des années plus tard, à Hollywood, des Oscars pour son travail sur les plus beaux
films d’Elia Kazan. Maurice Jaubert, avec ses envolées symphoniques, devient son compositeur
inséparable. Le comédien Jean Dasté, qui deviendra par la suite l’un des maîtres d’œuvre de la
décentralisation du théâtre en France, apporte à Zéro de conduite et L’Atalante sa virilité mâtinée de
fantaisie, de fragilité.
Son film le plus célèbre, Zéro de conduite, est souvent cité par d’autres cinéastes : Truffaut ne cache pas
ses emprunts dans Les Quatre Cents Coups, attribue à Delphine Seyrig, dans Baisers volés, le nom de
famille du jeune ado androgyne du film de Vigo : Tabard ; donne trois rôles à Jean Dasté, déjà âgé ;
réutilise des musiques de Jaubert et le place dans la collection de photographies de La Chambe verte, etc.
Le Godard des années 1960 lui doit beaucoup, même et surtout politiquement. Dans Grandeur et
décadence d’un petit commerce de cinéma (1986), téléfilm de Godard diffusé sur TF1, le personnage
principal s’appelle Almereyda (comme le père de Vigo, nous y reviendrons). Même s’il ne le dira jamais,
Bruno Dumont, depuis qu’il donne dans le comique burlesque (P’tit Quinquin), fait souvent du Vigo.
C’est patent dans le heu des acteurs, professionnels ou amateurs.
Dans Zéro de conduite (1932) qui en appelle à la révolte des enfants contre les adultes, Vigo tourne l’une
des scènes les plus célèbres de l’histoire du cinéma. On y voit des enfants défiler au ralenti, drapeau noir
de pirate en tête de cortège, dans le dortoir d’un pensionnat, au milieu des plumes des polochons qui
tombent comme de la neige. Le film est interdit, censuré jusqu’en 1945.
Des exemples de plans fulgurants, « étoiles filantes », on en trouve des dizaines dans le cinéma de
Vigo
D’où lui vient de cette liberté ? Est-elle contrôlée ? Il est toujours difficile, périlleux et présomptueux de
figer la généalogie d’un artiste. On dira pourtant, pour simplifier, que cette liberté lui vient d’abord de son
héritage intellectuel : de son père, Eugène Bonaventure Vigo, plus connu sous son pseudo d’anarchiste,
“Miguel Almereyda” – il s’agirait d’un anagramme de « Y’a la merde » – fut un politicien et homme de
presse célèbre (il était présent au Café du Croissant quand Jean Jaurès y fut assassiné, le 31 juillet 1914).
Même si Jean n’a que 11 ans quand son père meurt (en prison).
Et puis il y a l’époque, ses artistes. Le dadaïsme est passé, le surréalisme l’a dépassé et son groupe vit
alors ses plus belles heures. Dans son activité cinématographique, souvent reniée par les surréalistes, on
trouve la veine arty de René Clair/Francis Picabia (Entr’acte), de Germaine Dulac (La Coquille et le
Clergyman) ou de Jean Cocteau (Le Sang d’un poète), la veine réaliste-onirique Buñuel/Dalí (Un Chien
andalou et L’Âge d’or), reconnue et autorisée par le groupe.
Deux frères, Jacques et Pierre Prévert, sont toujours un peu dans les bons coups. Ils appartiennent plutôt à
la branche prolo-burlesque de la rive gauche (ils vivent dans une sorte de phalanstère situé rue du
Château, derrière la gare Montparnasse), par opposition à la branche rive droite du café Cyrano, à
Montmartre, où ont lieu les réunions « officielles » du groupe surréaliste dirigé par André Breton.
Saisir par l’image la beauté de l’instant où l’inconscient jaillit
Les frères Prévert, avec leur copain du XIIIe arrondissement, Paul Grimault (futur auteur du Roi et
l’Oiseau), traînent toujours un peu partout dans Paris et ses studios de cinéma, entre les câbles des
éclairages à haut voltage. Ils font de la figuration dans les films de Buñuel et dans ceux de Vigo – Pierre
Prévert passera à la réalisation au moment du Front populaire et Jacques commence à écrire des scénarios
pour Marcel Carné, comme tout le monde le sait.
Vigo, sans être membre d’un groupe, mais politiquement engagé, reflète l’atmosphère et l’esprit,
volontairement ou non, de son époque. Sachant en tout cas, comme par instinct, saisir par l’image la
beauté de l’instant où l’inconscient jaillit.
Voilà pourquoi, bientôt cent ans après sa mort, Jean Vigo, malgré une œuvre très courte (en tout 200
minutes), reste un cinéaste majeur, dont l’influence n’est pas tarie.
par Jean-Baptiste Morain – Les inrockuptibles
Publié le 2 octobre 2021