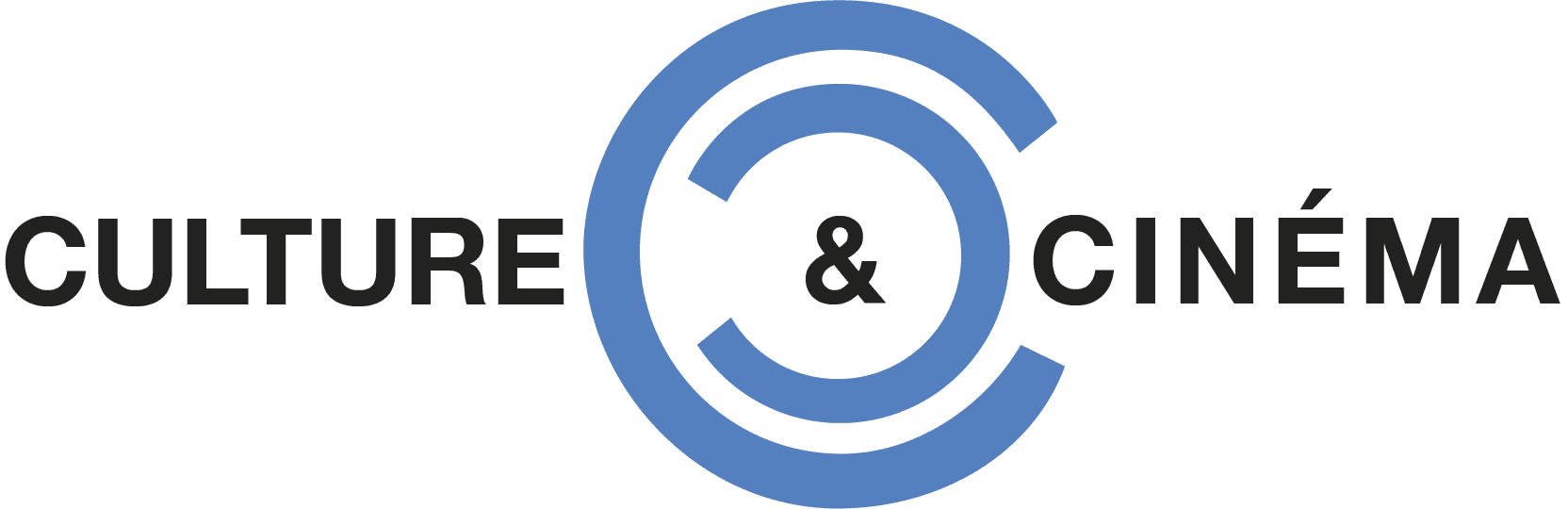L’HISTOIRE
Deuxième moitié du XVIIIème siècle. Au fond des bas-fonds d’Edo se trouve un asile de miséreux tenu par Rokubei (Ganjiro Nakamura) et Osugi (Isuzu Yamada), un couple cupide et malfaisant. Là survit tant bien que mal une poignée de laissés-pour-compte : Sutekichi le voleur (Toshiro Mifune), Tonosama le samouraï déchu (Minoru Chiaki), un ancien acteur de Kabuki devenu alcoolique (Kamatari Fujiwara), Osen la prostituée (Akemi Negish), Unokichi le jeune chien fou, un joueur invétéré, Tomé un rétameur miséreux qui attend que sa femme mourante pousse son dernier soupir… Un jour débarque parmi cette humanité en déréliction Kahei (Bokuzen Hidari), un vieil homme qui se dit bonze. Il va de locataire en locataire, écoutant leurs histoires et leurs peines, essayant de les soulager par des mots réconfortants.
ANALYSE ET CRITIQUE
Vingt-et-un ans après Jean Renoir, Akira Kurosawa adapte avec son co-scénariste attitré Hideo Oguni (douze films ensemble !) Les Bas-fonds de Maxime Gorki, transposant l’action de la pièce dans les bas quartiers d’Edo au XVIIIème siècle. Kurosawa est un grand amateur de littérature russe, et il a déjà eu le loisir d’adapter Dostoïevski en 1951 avec L’Idiot. Si le cadre change et si Oguni et Kurosawa s’offrent une certaine liberté dans l’adaptation, le cinéaste choisit paradoxalement un dispositif très théâtral en filmant tout son film dans deux décors uniques : la chambre commune et la cour de l’asile.
Dès le générique, le ton est donné. On est au fond d’une sorte de fosse, la caméra panote lentement, en faisant le tour complet et semblant chercher une issue qui n’existe pas. Aucun horizon, rien qu’un haut mur, une falaise. Le cadre aspire au ciel et à la lumière mais n’en trouve pas, cet ailleurs étant limité à une bande étroite en haut de l’image. Comme les personnages du film, nous sommes pris au piège de ce lieu maudit, plongés au côté de ces laissés-pour-compte dans un purgatoire dont il semble impossible de s’échapper.
Cette unité de lieux, associée au fait que le cinéaste limite ses mouvements de caméra, donne effectivement une impression de « théâtre filmé » que Kurosawa assume d’ailleurs totalement. Il l’assume même avec humour lorsqu’à un moment Sutekichi jette Rokubei à la porte et que les autres occupants, spectateurs hilares de la scène, applaudissent et clament « fin du premier acte ! » et « quelle belle scène ! » Ce choix de travailler à partir du dispositif théâtral existe dès l’origine du projet, et avant le début du tournage le cinéaste a travaillé avec ses acteurs pendant une quarantaine de jours, leur imposant des répétitions quotidiennes dans les deux décors fabriqués pour le film et leur refusant « tout caprice de stars. » (1) Puis, venu le temps de l’exécution, il met en boîte son film très rapidement, en une poignée de jours. Tout a été minutieusement préparé en amont : chacun connaît ses répliques sur le bout des doigts, maîtrise chaque aspect de son personnage, et les placements des acteurs et de la caméra sont prévus. Au moment du tournage, Kurosawa s’approche ainsi de l’énergie de la représentation théâtrale et réalise son film au plus près de la façon dont il aurait monté ce projet sur les planches.
Ce procédé fait que ces Bas-fonds paraissent souvent empesés, le choix de la théâtralité de la mise en scène créant un filtre entre le spectateur et le film. L’artificialité revendiquée, le manque de naturel empêchent le plein déploiement de cette empathie que l’on devrait ressentir pour les personnages. Et ce d’autant plus que le jeu des comédiens ne convainc pas toujours, ou du moins il se révèle si théâtral et déclamé que l’on peine à croire – voire même par moments à s’intéresser – à certains personnages et à leurs drames.
Le choix de deux lieux uniques renforce par contre le sentiment d’oppression qui s’abat sur les personnages. Le film ne leur laisse aucune chance, ils n’ont nulle échappatoire, condamnés à leur terrible sort. Les quelques fenêtres du dortoir pouilleux donnent sur une cour boueuse et couverte de détritus. Et au-delà de ce trou à rats, on devine au travers des histoires que ramènent du dehors les malheureux locataires, que c’est tout le quartier, voir la ville, qui est en pleine déliquescence. Kurosawa montre qu’il n’y a aucun ailleurs possible. On est à une époque où le système du shogunat provoque de plus en plus de misère et de rancœur. Cette société basée sur les classes est en crise, les paysans et les ouvriers ont de plus en plus de mal à survivre et se retrouvent jetés en masse à la rue, tout comme nombre d’autrefois fiers samouraïs qui, ruinés, deviennent mercenaires ou voleurs. A la fin du siècle, la famine de Temmei durera six ans, faisant des centaines de milliers de morts et provoquant des émeutes du riz à Edo.
Kurosawa ne nous donne aucun contexte historique, mais la déréliction de ces pauvres hères jetés au fond de ce trou raconte en creux l’aveuglement de ce système féodal. Tout ici est laid, corrompu, vil. Les personnages du film sont des damnés, des bannis de la société des hommes. Dès les premières phrases, l’idée qu’ils sont enfer apparaît : « Tu finiras en enfer ! » lance l’acteur, « J’y suis déjà » lui répond le joueur ; plus tard le logeur est comparé au diable et les locataires à ses enfants. Plus le film avance, plus les personnages dépérissent, tendent à disparaître. Leurs visages se flétrissent, leurs corps maigrissent, leurs déplacements se font moins assurés, ils se recroquevillent et finissent par ramper et se terrer comme de la vermine.
On pourrait être gêné par cette noirceur absolue et ce déterminisme ici à l’œuvre. Heureusement, Kurosawa ne se complaît pas dans l’horreur et l’on sent toujours son regard plein d’humanité et de compassion pour ces laissés-pour-compte. Surtout, il met en avant l’humour de la pièce de Gorki, ménageant quelques passages à la limite du burlesque. Il ne s’agit bien sûr en aucun cas de rire des personnages, mais bien de rire avec eux afin de montrer cette force qui malgré tout survit et leur permet de prendre du recul sur leur terrible condition.
La musique permet ainsi quelques douces échappées. Elle est rare mais gagne une force certaine à être interprétée en direct par les acteurs, Kurosawa ne faisant pas appel à de la musique extra-dégiétique. Lorsque musique il y a, ce sont les acteurs qui la jouent, tapant sur des casseroles ou utilisant des hyoshigi, ces petits instruments à percussion utilisés dans le théâtre traditionnel japonais pour annoncer le début d’une pièce. Le film se clôt d’ailleurs sur une sorte de numéro de music-hall où la troupe nous offre un moment drôle et enlevé.
Mais alors qu’ils sont en pleine libation, enivrés et joyeux, l’annonce de la pendaison de l’acteur fige l’assemblée… Jusqu’à ce que le joueur décrète dans un rictus qu’il s’est tué juste pour leur gâcher le plaisir. Une manière de montrer la capacité de dérision de ces hommes et femmes sur qui la fatalité s’est abattue, de célébrer leur force morale, leur capacité à croire en la vie malgré l’adversité. Mais une manière aussi de montrer que l’égoïsme reprend facilement ses droits sur la fraternité et l’entraide. Tout le film et le groupe naviguent entre ces deux pôles – l’entraide d’un côté, l’individualisme forcené et la mesquinerie de l’autre – sans jamais vraiment choisir son camp. Cette indécision provoque en nous un profond sentiment de malaise, cette humanité ne pouvant être comprise d’une unique façon mais bien à travers la coexistence de ces antagonismes.
Et puis il y a le mensonge. Tous mentent, se racontent des histoires, réinventent leur passé, fantasment des futurs possibles, un ailleurs. Kahei est un grand pourvoyeur de mensonges – c’est ce que lui reproche Satekichi – mais ce sont des mensonges doux à entendre, réconfortants, et c’est ce dont ont besoin avant tout les pauvres hères de ces bas-fonds : des histoires pour se sentir vivre, pour espérer, pour rêver.
Malgré un dispositif très artificiel, malgré le fait que l’on ne croit pas à tous les personnages et que l’on ne partage pas intensément leurs drames, Les Bas-fonds parvient malgré tout à nous émouvoir. Le film s’avère, avec Le Château d’araignée qui le précède tout juste, une avancée de Kurosawa vers l’artificialité, l’expérimentation, une veine qu’il ne cessera par la suite d’approfondir, notamment avec Dodeskaden, quasi-relecture de ces Bas-fonds mais sur un mode plus désespéré encore…