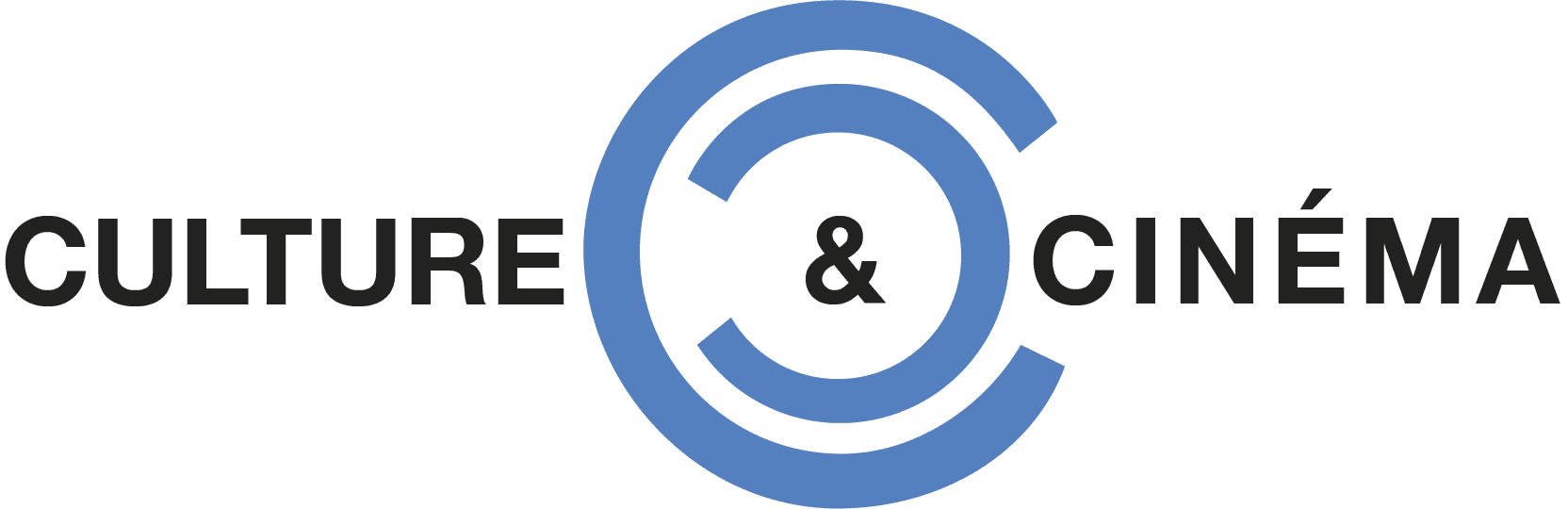« Le Grand Mouvement » : sur les hauteurs de La Paz, un mineur emporté par la foule.
Kiro Russo offre une plongée fascinante dans la cité bolivienne en suivant le parcours d’un ouvrier malade des poumons.
« Le Grand Mouvement », de Kiro Russo, s’ouvre sur un portrait kaléidoscopique de la capitale bolivienne.
Quel est donc ce « grand mouvement » qu’arbore le deuxième long-métrage du Bolivien Kiro Russo, objet fascinant aux contours énigmatiques, qui s’inscrit dans une galaxie d’œuvres sorcières aux côtés de celles du Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul et de l’Argentin Lisandro Alonso ? Ce pourrait être, d’abord, le foisonnement de La Paz, métropole encombrée qui lui sert de cadre, où se déverse chaque jour son lot d’embouteillages, de marchandises et de travailleurs corvéables. Ou alors le grondement de la montagne qui surplombe la ville et fait peser sur elle un climat plombé, où se propagent des forces mystérieuses, telluriques. Toutes les hypothèses restent ouvertes, mais il y a fort à parier que ce mouvement relève plus profondément encore du cinéma en lui-même, cette étrange chimie qui fait naître dans l’esprit de son spectateur toutes sortes de motifs, d’hallucinations, de passages.
Le Grand Mouvement peut se décrire comme une expérience. Il s’ouvre sur une séquence purement descriptive : un portrait kaléidoscopique de la capitale bolivienne où défilent ses façades géométriques, ses murs lépreux, ses miroirs déformants, ses rares perspectives ouvrant parfois sur un axe automobile bouché. Au son d’une symphonie discordante où percent les sirènes et les marteaux-piqueurs, la caméra s’arrête sur les entrelacs de câbles électriques, tout un réseau embrouillé – signe que le sens ne sera pas délivré tout cuit. Plane d’emblée sur le tableau un sentiment oppressant, des proportions inhumaines, et c’est sous le signe d’une contamination obscure que le film s’ouvre à nous.
Fondu stupéfiant
Ce n’est que dans un second temps que la fiction prend le relais. Elder (Julio César Ticona), ouvrier mineur, est venu à pied avec ses compagnons jusqu’à La Paz pour protester et défendre leur droit au travail. Entre deux manifs, lui et deux amis traînent dans les boutiques, accomplissent quelques tâches de manutention sur les marchés, sortent en boîte. Mais Elder est atteint par un mal étrange, qu’aucun médecin ne parvient à diagnostiquer, et donc à nommer. D’où viennent ce souffle court, cette toux sèche, ces suées et ces vertiges ? Parallèlement, se dévoile un autre personnage, mi-clochard mi-sorcier, un dénommé Max qui vit aux abords forestiers de la ville, et y descend parfois, maugréant quelque augure pythique, comme « la ville sera réduite en poussière ». Pas à pas et sans le savoir, Elder et Max cheminent l’un vers l’autre, pour une session d’exorcisme vouée à bouter la maladie hors de l’ouvrier.
Sommet de ce climat nauséeux, anxiogène, la figure du zoom que Kiro Russo manie de main de maître
Des causes de cette maladie, on ne saura rien, en dehors du parallèle évident que le film établit avec la ville, qui elle-même s’étend comme un chancre, semble saturée comme une embolie, s’autodévore comme une métastase. Son climat, ses bruits (formidable espace sonore du film comme une partition « concrète »), sa pression s’infiltrent de tous côtés dans le corps d’Elder comme s’il lui était entièrement perméable. Kiro Russo montre à plusieurs reprises comment ce corps prolétaire est digéré par la ville, croulant sous les sacs de denrées qu’il transporte sur les marchés, sommé d’aller toujours plus vite, payé au lance-pierre, disparaissant enfin dans l’ombre des rues, se faufilant dans des refuges publics pour dormir. Mais pis encore, tout se passe comme si le syndrome qui s’empare d’Elder atteignait aussi le film en lui-même, sujet à de soudaines poussées de fièvre, accessible au délire, comme lors de cette scène nocturne où les personnages exécutent une chorégraphie sur une musique électro façon clip des années 1980.
Sommet de ce climat nauséeux, anxiogène, la figure du zoom que Kiro Russo manie de main de maître, presque à chaque plan, comme pour fouiller du regard les contours poisseux de la ville sur laquelle s’amassent les nuées sombres et finissent par éclater des averses. A l’issue de l’exorcisme d’Elder, qui le laisse inanimé, l’un de ces zooms s’avance vers sa bouche ouverte, cavité où semble vouloir s’engouffrer la caméra. Par un fondu stupéfiant, c’est alors la mine, ses chariots sur rails, ses lueurs éparses, qui surgit comme de l’intérieur du corps. Sans doute ne faut-il pas chercher plus loin le mal du héros : cette malédiction des profondeurs qui, comme dans les Carnets du sous-sol de Dostoïevski, pèse sur toutes les existences caverneuses.
M Macheret Le Monde