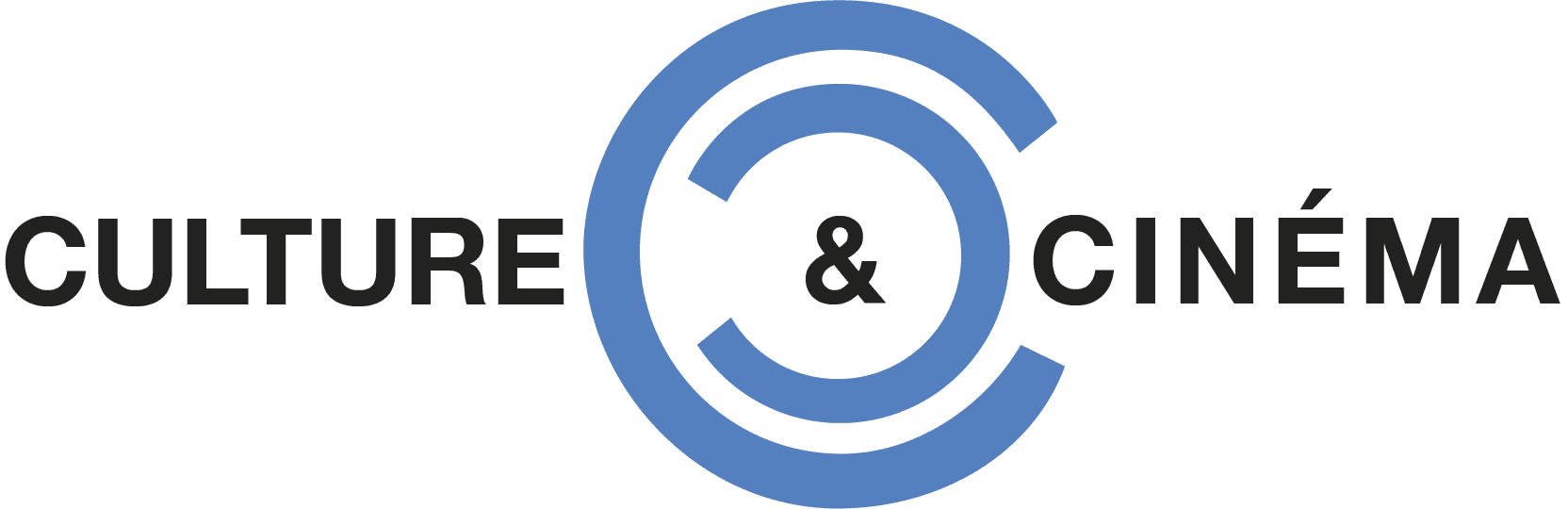La taverne de la Jamaïque
L’HISTOIRE
Cornouailles, début du XIXème siècle. La « Taverne de la Jamaïque » est une petite auberge à la réputation sinistre : une bande de malfrats y a en effet établi son repaire, et mène depuis les lieux de régulières missions pour faire naufrager les bateaux s’approchant trop près des côtes, les piller et ne laisser aucun survivant. Ils sont bien aidés en cela par Sir Humphrey Pengallan, juge de paix ventripotent, qui n’est autre en réalité que leur commanditaire.
ANALYSE ET CRITIQUE
Dans la filmographie d’Alfred Hitchcock, La Taverne de la Jamaïque a tout du film de transition. Réalisé après Jeune et innocent et Une femme disparaît, deux des œuvres quintessentielles de sa période anglaise, le film est une adaptation d’un roman de Daphné du Maurier, que Hitchcock adaptera de nouveau pour son premier film américain, Rebecca, l’année suivante. D’ailleurs, Hitchcock n’a pas encore donné le premier tour de manivelle de cette production britannique (de la compagnie Mayflower, fondée par Erich Pommer et Charles Laughton) qu’il a déjà signé depuis plus d’un mois son contrat d’exclusivité avec David O. Selznick. Pas vraiment rattachable à sa période anglaise, pas encore assimilable à sa période américaine, La Taverne de la Jamaïque est un film atypique dans sa filmographie. Un film de l’entre-deux, pas franchement réussi mais pas complètement raté, qui porte son empreinte autant qu’il semble ne pas totalement lui appartenir…
Si Daphné du Maurier avait attiré l’attention d’Alfred Hitchcock, c’était davantage pour Rebecca que pour ce roman, paru en 1934, que le cinéaste ne voyait pas très bien comment porter à l’écran. Après une première version du dramaturge Clemence Dane, Hitchcock retravaille la structure du récit avec Sidney Gilliat (avec lequel il vient de travailler sur Une femme disparaît) et Joan Harrison, secrétaire d’excellent conseil. Là où le récit de Daphné du Maurier reposait sur plusieurs mystères élucidés très progressivement (la raison des naufrages, l’identité du chef de l’organisation…), Hitchcock, fidèle à sa conception du suspense, décide de tout révéler d’emblée : l’activité criminelle des pillards est ainsi décrite, avec une vraie brutalité, dès la toute première séquence du film. De la même manière, et probablement parce que le rôle est endossé par l’influent comédien-producteur du film, Charles Laughton, le rôle du commanditaire des naufrages est considérablement étoffé, et son lien avec les criminels révélé très tôt. Il faut d’ailleurs noter que, pour ne pas risquer de froisser le marché américain, le personnage quittera durant la préparation du film ses habits littéraires de pasteur pour devenir un juge de paix. Ce faisant, Hitchcock décale la tension du récit, qui ne réside donc pas dans l’accumulation des coups de théâtre mais dans l’atmosphère de duperie et de mensonge qui enveloppe les personnages.
A cet égard, il convient d’insister sur la qualité formelle d’un film dont l’action se déroule quasi-intégralement de nuit ; les contrastes provoqués par la brume ou les contrastes tranchants de la photographie de Bernard Knowles participent grandement à l’atmosphère de l’œuvre, tout comme l’opposition entre les deux lieux principaux de l’action : les lignes verticales de la grande maison cossue de Pengallan s’opposent aux diagonales biscornues de la taverne, bicoque inquiétante qui effraie les cochers comme les chevaux.
Dans cette logique, la séquence la plus hitchcockienne (en tout cas, la plus réjouissante) du film est probablement celle – rappelant, d’une certaine manière, la confrontation entre Hannay et Jordan dans Les 39 marches – où Trehearne confie à Pengallan sa véritable identité, sans se douter qu’il parle alors au chef de l’organisation criminelle qu’il doit démanteler. Se rendant à la taverne, les deux hommes arrêtent Merlyn, et tout l’enjeu de la scène réside alors sur le temps qu’il faudra à Trehearne pour comprendre qu’il s’est fait avoir. Sans cesse repoussée (et le plaisir que semble prendre Hitchcock à faire durer le petit jeu est communicatif), la révélation surviendra dans la libération « houdinesque » de Pengallan, frappant Trehearne d’une stupeur déconfite.
Pour autant, on ne sent pas forcément Alfred Hitchcock totalement concerné par le film, ou en tout cas pas sur la durée entière du long-métrage. Ses films précédents contenaient tous, à leur manière, un morceau de bravoure formel, une friandise pour les yeux qui pouvait prétendre entrer dans le prestigieux musée des séquences d’anthologie de sa filmographie. A l’exception peut-être du plan vertical sur la chute de Trehearne – mais que l’on retrouvera, de façon infiniment plus spectaculaire, et en conclusion d’une séquence d’une autre densité dramatique, dans Cinquième colonne trois ans plus tard – et éventuellement de quelques plans furtifs sur Maureen O’Hara – nous y reviendrons, car il faut y revenir – l’ensemble dégage parfois une vague impression de roue libre : le film est joliment exécuté, et sa direction artistique exemplaire emplit parfois l’écran de bien belles choses, mais on n’y perçoit aucun génie particulier dans la mise en scène…
Les raisons en sont probablement multiples : la plus commune explication consiste à prétendre que Hitchcock avait déjà un peu la tête de l’autre côté de l’Atlantique, et probablement même était-il déjà obnubilé par l’entêtante figure de Rebecca, échappée des pages d’un autre livre. Une autre explication consiste à affirmer que Hitchcock était parfois plus à l’aise avec des productions moins ambitieuses, et que des dispositifs formels plus réduits stimulaient davantage son inventivité créatrice : Le Chant du Danube, importante production en costumes, avait déjà été un calvaire pour lui, alors qu’Une femme disparaît, avec son décor unique, avait été l’occasion d’un réjouissant exercice de style, notamment dans la gestion de l’espace. Ceci étant, Les Amants du Capricorne apporteront une éblouissante contradiction à cette généralité.
La troisième raison, de loin la plus convaincante lorsque l’on voit l’œuvre, est que Hitchcock s’était en partie fait déposséder du film, et qu’il ne s’était pas forcément battu pour récupérer un dû auquel il ne tenait probablement pas tant que cela. Déposséder ? Oui, par Charles Laughton, producteur et comédien, qui ressemble ici à ce point à un ogre, ventru et infatué, qu’il semble souvent avoir littéralement dévoré le film. Son numéro de cabotinage, porté par un maquillage outrancier et des mimiques appuyées, est délibérément excessif, et il pourra faire jubiler autant qu’agacer selon les spectateurs. Quoi qu’il en soit, le comédien phagocyte le film, et contribue à faire de Pengallan sensiblement autre chose que le personnage auquel les scénaristes du film avaient pensé à l’écriture. Sur le papier, Pengallan est un manipulateur, qui utilise les pillards à ses fins, et cherche toujours un moyen de s’en tirer. A l’écran, il est un peu plus complexe et se révèle pour tout dire assez dérangeant, dans la mesure où l’interprétation de Laughton, qui ne lésine ni sur le charme, ni sur la dérision ni sur les changements de ton, contribue à désamorcer certaines tensions tout en faisant naître d’autres inquiétudes : en résulte un personnage un peu insaisissable, aux humeurs sans cesse changeantes et aux accès de violence inattendus. Un psychopathe, au sens le plus pathologique du terme, chez qui la menace la plus effrayante réside dans sa constante imprévisibilité. A un moment, étrange et révélateur, il s’emporte contre son servile domestique, Chadwick, puis immédiatement, commente sa colère, et sans préavis, interroge en souriant le pauvre homme, un peu démuni, à propos de l’un de ses aïeux… Dans le dernier plan du film, le dit Chadwick entend de nouveau la voix claironnante de son maître, comme si la mort de celui-ci ne l’avait pas libéré de sa terrifiante emprise. On attribue à Hitchcock une assertion affirmant, en substance, que la qualité d’un film reposait en grande partie sur la réussite de son méchant… Pengallan n’est probablement pas la plus effrayante des figures du Mal qui parsème la filmographie d’Alfred Hitchcock, mais c’est indéniablement l’une des plus étranges.
Plusieurs exégètes du film ont enfin expliqué sa production singulière, et le relatif désintérêt de Hitchcock pour son œuvre, par l’installation sur le tournage d’une rivalité entre ce dernier et Laughton, d’autant plus intéressante, psychanalytiquement et rétrospectivement parlant, que les deux hommes pouvaient partager une certaine similitude morphologique. En ce sens, les dernières séquences, où un Pengallan halluciné kidnappe Mary et lui promet une vie de princesse soumise à ses côtés, ont inspiré les commentateurs les plus inspirés, qui y virent un témoignage (inconscient) des fantasmes de domination et une manifestation de la frustration notoire de Hitchcock vis-à-vis de la gente féminine… Si on laisse aux interprètes leurs interprétations, il reste peut-être dans ces séquences le plus essentiel : la découverte de Maureen O’Hara. La comédienne était déjà apparue, sous son patronyme de naissance Maureen FitzSimmons et dans des rôles annexes, dans deux films de second rang, mais La Taverne de la Jamaïque représente, à 19 ans à peine, son véritable acte de naissance cinématographique. Ce n’est rien de dire qu’elle y est somptueuse, et les plans les plus marquants du film sont peut-être, tout simplement, ceux où le cadre n’offre rien d’autre que son visage à contempler (soit lors de son arrivée chez Pengallan, soit lorsqu’elle accroche un vêtement enflammé à la balise ; soit lorsque, bâillonnée, elle suit Pengallan dans sa dérive vers la déraison). Une rumeur persistante veut que son engagement n’ait été initialement dû qu’à un Charles Laughton tombé amoureux – lui qui n’était habituellement pas sensible qu’au charme des jeunes filles. La question fondamentale est, en réalité : aurait-il pu en être autrement ? Dans les mois qui suivront, Laughton allait emmener sa protégée aux Etats-Unis pour être, à ses côtés, l’Esmeralda du Quasimodo de William Dieterle. Puis, très vite, elle serait l’inoubliable Angharad de Qu’elle était verte ma vallée. Mais l’histoire pourra retenir que c’est dans une taverne équivoque, perdue quelque part dans les brumes de Cornouailles, qu’une flamboyante actrice est née.
DVDCLASSIK