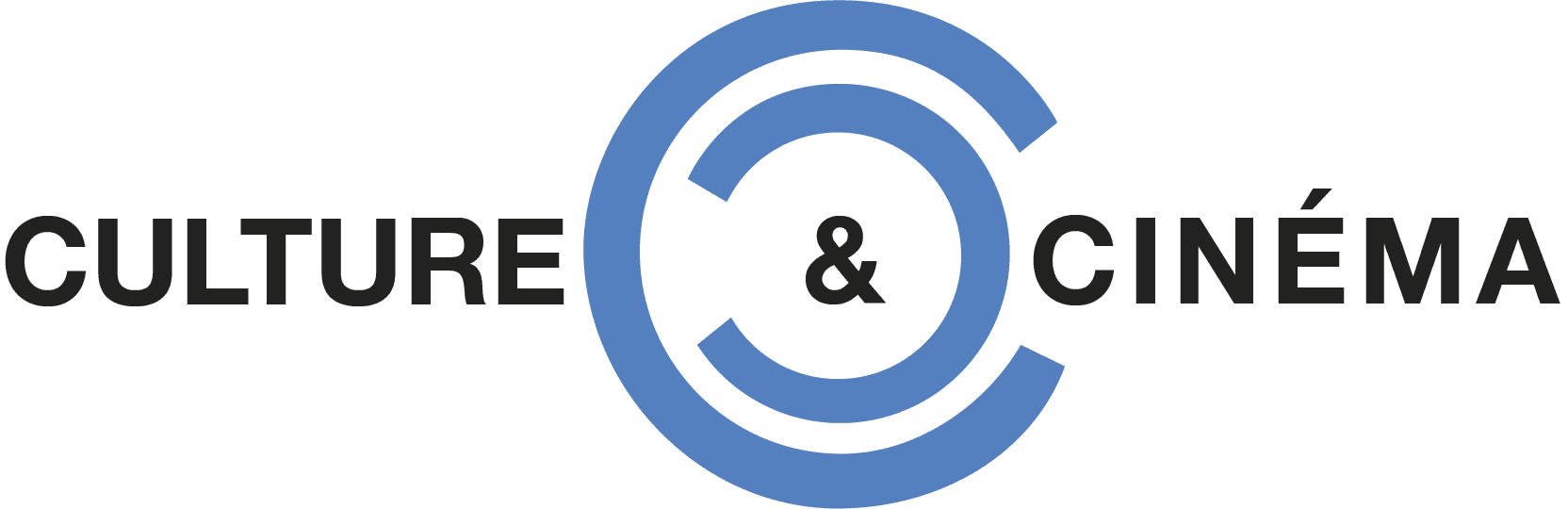Sublime vagabondage en terres argentines, avec Viggo Mortensen en militaire à la recherche de sa fille.
«Pays de merde.» Cette fois, c’est Viggo Mortensen qui le dit, dans le cinquième long métrage du virtuose argentin Lisandro Alonso, l’un des plus beaux films croisés lors du Festival de Cannes 2014. Quant au pays en question, somptueusement filmé, il s’agit de la part la plus désolée du sud de la Pampa et la Patagonie orientale, cette terre verte et cagneuse toute de landes sans contour, de reliefs de roches rondes piqués de colonnes tribales et de rivages peuplés surtout d’otaries. Un paysage qui tint lieu de théâtre, autour de 1880, à la Campagne du désert menée par le général Roca, laquelle visait à étendre le territoire conquis au-delà la province de Buenos Aires et à en repousser par la force les habitants – une opération de conquête aujourd’hui désignée par nombre d’historiens comme un génocide des indigènes, orchestré par la nation argentine naissante.
Colonel. Mais que peut bien faire là Mortensen, par ailleurs producteur du film et cosignataire de sa musique originale avec le guitariste masqué Buckethead ? Dès les superbes tableaux aux teintes franches qui ouvrent le film, parmi les troupes de brutes exterminatrices en uniforme se détache la silhouette d’allure plus distinguée d’un ingénieur militaire danois, Gunnar Dinesen, venu se perdre en ces confins pour on ne sait quelle raison, accompagné de sa fille, jolie poupée blonde d’une quinzaine d’années. Objet des frustes appétits des soldats, celle-ci file en douce une nuit pour vivre au grand air son béguin pour l’un des troufions. Dinesen s’élance alors à ses trousses, cavalier seul égaré en ce désert hostile qui «dévore tout», où règne secrètement, dit-on, un colonel disparu, viré chef de guerre sanguinaire et travesti.
De La Libertad à Liverpool, les premières œuvres de Lisandro Alonso, menaçantes rêveries ethnographiques quasi muettes, avaient cela en commun de poursuivre pleines d’entêtement une logique édictée dès leurs premiers plans, jamais bousculée par le déploiement des films, comme envoûtés par les images qui pouvaient en naître. S’il en perpétue quelques préoccupations majeures (quête familiale en solitaire et entrechoquement d’un individu aux puissances d’un paysage sauvage comme catalyseur de fiction), Jauja, qui marque une nette bascule dans l’œuvre d’Alonso, révise en profondeur cette pente de son cinéma. Par-delà le caractère inédit de sa collaboration avec un acteur professionnel et un scénariste (lire ci-contre), le tracé rectiligne de ses films précédents se mue ici en un pur principe de dérive, au gré duquel film et personnages mutent insensiblement mais sûrement, jusqu’à ce que, lorsque Gunnar Dinesen perd tout espoir, ce soit le récit même qui s’engouffre dans des failles, déraisonne et dégorge songes et mirages.
Hâves. Chaque fois qu’on l’interroge sur ses marottes de spectateur, Alonso se défend d’être trop érudit ou de commettre une œuvre perfusée de cinéphilie. Pourtant, le territoire arpenté ici et sublimé par ses cadres et les lumières du chef op Timo Salminen, fidèle directeur de la photo des films d’Aki Kaurismäki, paraît tissé du cinéma même. Jauja est cette quête d’une prisonnière du désert aux faux airs de western du Sud sauvage qui vire doucement à une avventura hallucinatoire, dans les pas hâves d’un cousin du Kinski d’Aguirre – cet autre diable blond égaré en terres chimériques de cocagne et de perdition d’Amérique latine. On avait sans doute eu tort de voir trop vite en Lisandro Alonso seulement le rejeton au maniérisme inquiet d’un cinéma d’ethnofiction alors même que Jauja est là pour démontrer superbement combien il porte en lui aussi le tempérament d’un Raúl Ruiz ou d’un David Lynch des grands espaces.
JULIEN GESTER 21 AVRIL 2015 Libération.