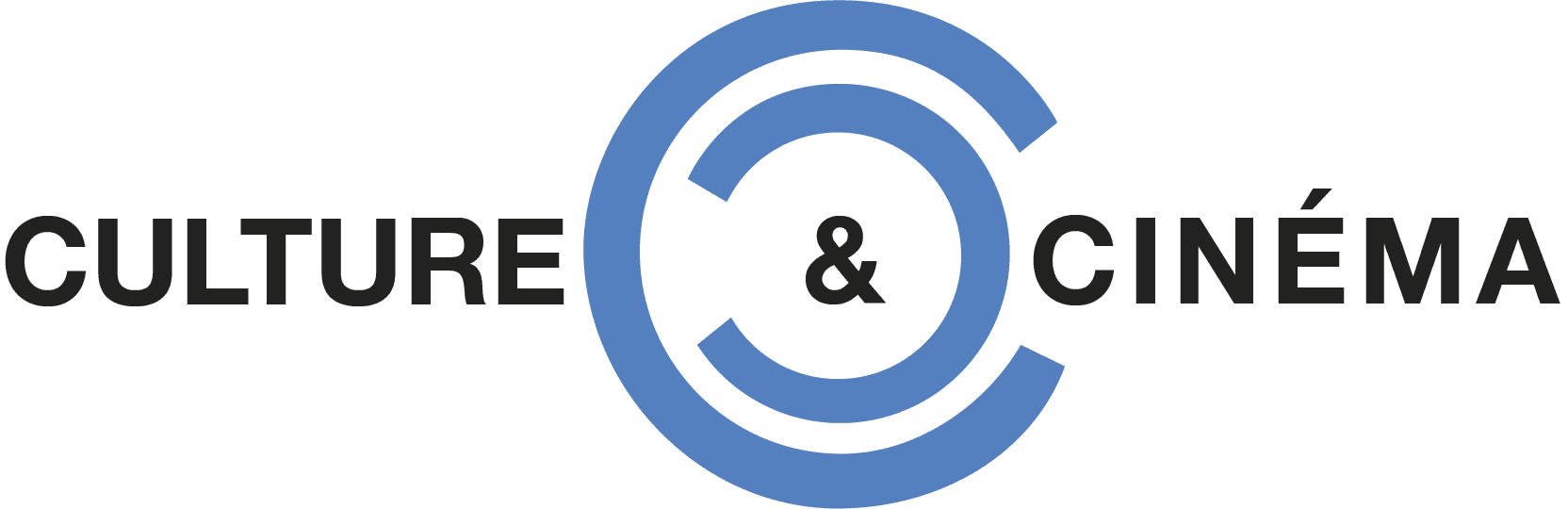L’HISTOIRE
Sa famille était pauvre et honnête, quoique, à dire vrai, un peu plus pauvre qu’honnête. Et chaque fois que son humble maman devait accoucher, elle commettait le larcin qui la faisait emprisonner. C’est donc dans une geôle, comme ses onze frères et sœurs avant lui, qu’est né en 1775 celui que l’histoire allait retenir sous le nom de François Eugène Vidocq. Ce nom, il ne le fera sien que bien plus tard, après l’avoir emprunté à une pierre tombale. Séducteur par tempérament, escroc par hérédité, sa connaissance du crime en faisait le préposé idéal aux fonctions de Chef de la Sûreté. Certes, l’habit ne fait pas le moine, mais par amour le plus fieffé coquin peut parfois se décider à marcher droit… au grand dam de ses anciens compères.
ANALYSE ET CRITIQUE
« Voilà ce qui m’enchante chez Douglas Sirk, ce délirant mélange : moyen-âge et modernisme, sentimentalisme et raffinement, cadrages anodins et Cinémascope endiablé. Tout ça, on le voit bien, il faut en parler comme Aragon des yeux d’Elsa, en délirant beaucoup, un peu passionnément, peu importe, la seule logique dont Douglas Sirk s’embarrasse, c’est le délire. » (Jean-Luc Godard)
Etrange statut, vraiment, que celui de Douglas Sirk. Voilà un homme d’une culture particulièrement éclectique qui n’est aujourd’hui célébré, lorsque la critique daigne lui accorder quelque crédit, que comme l’auteur d’une poignée de mélodrames flamboyants, tous tournés au cours des six dernières années de sa carrière cinématographique pour la firme Universal : Magnificent Obsession (1954), All That Heaven Allows (1955), Written on the Wind (1956), The Tarnished Angels (1957), A Time to Love and a Time to Die (1958) ou Imitation of Life (1959).
Pour une critique malléable et conformiste, véritable mouton de Panurge suivant aveuglément l’avis des maîtres, Douglas Sirk n’est donc aujourd’hui que le dépositaire d’un style de mélodrame qui puiserait son inspiration dans le pire roman de gare, pour parfois en sublimer la substance à force de bariolage moderniste et de sentimentalisme paroxystique. Cette critique oublie de séparer le grain de l’ivraie et de reconnaître la qualité des matériaux littéraires dont certaines de ces œuvres sont adaptées (le Pylône de Faulkner pour La Ronde de l’aube ; le Temps de vivre et le temps de mourir de Remarque pour A Time To Love and a Time To Die) pour ne rien dire de la qualité même de leur adaptation. C’est oublier que Godard, s’il délirait comme il se doit, savait aussi reconnaître en avril 1959 dans cet article pionnier des Cahiers du Cinéma consacré au sublime Le Temps d’aimer et le temps de mourir « qu’il n’avait jamais cru autant à l’Allemagne en guerre qu’en voyant ce film américain tourné en temps de paix » ; c’est oublier surtout l’extraordinaire palette manifestée tout au long de sa carrière par cet artiste omnipotent, homme de théâtre et historien d’art, ouvert à la connaissance de la physique comme à celle de la philosophie ou du droit, qui tâta toujours de la peinture. Et c’est afficher une ignorance méprisante pour le reste d’une œuvre, qui dès premiers grands succès allemands à la UFA (Schlussakkord, Zu neuen Ufern, La Habanera), dont la quête par le cinéphile moderne s’apparente aujourd’hui à celle du Graal, aux films de genre des débuts à la Universal (comédies, chroniques, musicals, western, péplum, aventures historiques) traduit une faculté d’adaptation rare pour un cinéaste européen, en même temps qu’un très singulier et très éclectique talent.
A Scandal in Paris est le troisième film américain de Sirk. Il reste aussi le préféré de son auteur si l’on en croit les propos tenus à James Harvey pour Film comment en 1978. Pour le coup, nous ne saurions lui donner tort ! Il s’agit d’un trésor assemblé en dehors des grands studios et de ce fait longtemps resté inaccessible aux cinéphiles, faute de matériau digne de ce nom. Ce n’est, comme le rappellent Coursodon et Tavernier, qu’après que Sirk a confié à Jon Halliday son attachement à cette œuvre méconnue (in l’ouvrage de référenceConversations avec Douglas Sirk) qu’une véritable restauration fut entreprise en 1973.

Il n’est d’ailleurs peut-être pas de film moins hollywoodien que ce faux biopic d’une étoffe toute ironique, dont les arabesques stylistiques évoquent la facture ophülsienne, l’incessant mouvement en moins, tandis que la verve acidulée, la causticité souriante, renouent avec le meilleur du Guitry des Mémoires d’un tricheur ou du Mirande de Café de Paris. Il faudrait encore citer l’influence diffuse d’un Hans Dreier (le collaborateur de génie de Lubitsch ou Sternberg à la Paramount pour Trouble in Paradise ou The Scarlet Empress par exemple) pour les immenses décors intérieurs, ici – faute de moyens ? – étrangement décharnés. On ne saurait, on le voit, envisager de parentés plus européennes, mais comment pourrait-il en être autrement au vu du générique qui aligne les noms de techniciens et d’artistes du Vieux Continent tous plus prestigieux les uns que les autres ? Nous y retrouvons ainsi, outre Sirk et une distribution très cosmopolite, le producteur Arnold Pressburger qui venait de financer en indépendant deux autres œuvres d’expatriés européens (Hangmen Also Die de Fritz Lang et le délicieux It Happened Tomorrow de notre René Clair national) ; le coauteur (avec Theodor Adorno) d’une étude très appréciée sur la Musique de cinéma, Hanns Eisler (Hangmen Also Die) ; et surtout le génial chef opérateur Eugene Schüfftan, créateur d’une méthode de prise de vue aérienne mythique qui fit merveille dans quatre des films français d’avant guerre de Max Ophüls (notamment pour ces splendeurs visuelles que sont Le Roman de Werther et Sans lendemain), mais aussi chez Siodmak (Menschen am Sonntag ; Mollenard) ou bien évidemment chez Carné (Drôle de drame ; Le Quai des brumes) ; tous sont originaires de l’ancien empire germanique. Ici comme pour tous les films qu’il fut amené à éclairer durant cette période, pour Sirk et Ulmer (Bluebeard ; Strange Illusionnotamment), Schüfftan n’est pas dûment crédité comme chef opérateur mais en qualité de « Production supervisor » après avoir été mentionné au générique de Hitler’s Madman et Summer Storm, les deux premières productions américaines de Sirk, comme « technical director » (sic) en raison de la très stricte réglementation syndicale de la corporation. Mais ne nous y trompons pas : l’obscur Guy Roe n’est que son premier opérateur, et c’est bien le maître qui règle tous les éclairages, sa patte si caractéristique imprégnant d’ailleurs toute l’inquiétante séquence du colporteur sur laquelle nous reviendrons.
Cette réunion de talents n’a rien d’une coïncidence. Le tournant des décennies 1930-1940 marque l’exode vers la terre providentielle des Etats-Unis d’une cohorte d’artistes européens fuyant le régime et les persécutions nazies. Au début de cette vague d’immigration, le mouvement était encore contrôlé par les grands studios. Fritz Lang, Otto Preminger ou Billy Wilder, malgré quelques déboires faisaient sans trop de mal leur nid dans le système des grandes majors. Il n’en sera pas de même au début des années quarante, lorsque l’exode sera plus subi qu’initié par la Mecque du cinéma. Des mouvements d’entraide s’organisent pour permettre aux moins chanceux, privés d’emploi, de subsister sur leur terre d’accueil. Le Free French Movement s’organise autour des grandes figures expatriées du cinéma français : les cinéastes René Clair,Julien Duvivier, Jean Renoir bientôt, les comédiens Charles Boyer ou Jean-Pierre Aumont. Le mouvement philanthropique des immigrés allemands ou austro-hongrois, le European Film Fund, est plus conséquent encore, et plus actif surtout. Présidé par Lubitsch, il se charge d’obtenir les précieux visas pour l’immigration et surtout de faire jouer les connexions adéquates afin de permettre à chacun des immigrés de décrocher un emploi. Lorsque cette intégration n’est pas possible, l’association tâche de contribuer au soutien financier des artistes, chacun de ses membres reversant une quote-part de son salaire hebdomadaire ; ainsi de l’aide portée à Ophüls, sans travail pendant plus de cinq ans. Ce sont des producteurs indépendants de la Powerty Row, souvent immigrés eux-mêmes, tels que Seymour Nebenzal (M), les frères Pressburger, donc, ou Edward Small qui offrent le plus d’opportunités aux nouveaux arrivants qui n’ont pu obtenir un contrat auprès d’une major, d’où la connotation très germanique du générique de A Scandal in Paris.
Sirk, lui, n’a pas à proprement parler bénéficié de ce soutien. Il avait débarqué à New York, après deux années passées sur des productions suisses et néerlandaises, avec la promesse d’un contrat de la Warner afin de réaliser un remake de Paramata bagne de femmes (Zu Neuen Ufern), son plus gros succès à la UFA qui consacra Zarah Leander. Mais pour cause de germanophobie galopante, la promesse sera dénoncée. Pour survivre, Sirk choisit alors de se lancer dans l’élevage de poulets dans la vallée de San Lorenzo, qu’il revend bientôt pour se consacrer à la culture des avocats ! Néanmoins ce sont ses relations allemandes qui lui permettent de rejoindre la Columbia d’Harry Cohn à partir de 1942, dans le cadre d’un contrat de sept ans. Las, si un petit salaire hebdomadaire lui est versé, aucun projet ne lui est confié. Il ne tournera que deux films pour la major, vers la fin de la décennie, (Slightly French et Shockproof). Ses relations allemandes – le monteur Al Joseph notamment – lui permettent de décrocher la réalisation d’un projet à très petit budget consacré à Heydrich, le « protecteur » SS de Bohême-Moravie, que produit Nebenzal. Racheté par la MGM et en partie refilmé, Hitler’s Madman se posera en concurrent aux Bourreaux meurent aussi de Lang et Brecht. Toujours pour Nebenzal, il se lance alors dans l’adaptation de La Partie de chasse de Tchékhov. Summer storm, première de ses trois collaborations successives avec l’incomparable George Sanders, s’avère un film absolument admirable, qui s’il trahit parfois quelque peu l’âme russe n’en demeure pas moins presque l’égal du superbe Lettre d’une inconnue d’Ophüls par la précision de sa construction cyclique introduite par le flash-back et son douloureux portrait d’un séducteur blasé et corrompu glissant lucidement vers une déchéance inexorable.
Sirk a trouvé en Sanders son interprète idéal. Il est d’ailleurs rare de lire autant d’éloges dressés par un metteur en scène à l’endroit d’un de ses interprètes. Quoi qu’il en soit l’ambivalence de Sanders, son intelligence et son flair le séduisent et le stimulent. Lorsque Edward Small lui commandite un projet autour des Mémoires d’un médecin de Dumas Père, c’est en pensant aux qualités propres de Sanders que Sirk imagine son Cagliostro, charlatan partant de rien pour séduire et hypnotiser les cours les plus prestigieuses d’Europe. Aussi, lorsque le projet, Black Magic, lui est retiré pour des raisons obscures (il en avait rédigé un scénario complet) pour être confié à Gregory Ratoff – qui en respecte scrupuleusement le plan de tournage – avec Orson Welles dans le rôle du fameux comte, Sirk choisit tout naturellement de transposer l’esprit de son personnage sur celui de son nouveau scénario, Vidocq, développé avec le brillant écrivain Ellis St. Joseph. Après tout, les fameuses Mémoires du policier, probablement apocryphes, autorisent bien des licences adaptatives…
Certes le Vidocq incarné par Sanders n’est plus un mage charlatan. Mais il n’en est pas moins brillant hypnotiseur et manieur d’illusions. Lui-même est parti de rien, puisque c’est du fond de quelque cachot parisien qu’il accomplit ses débuts dans la vie. La fatalité ayant voulu qu’une tache d’encre le prive de toute ascendance, il doit s’inventer une personnalité. Celle du plus caméléon de tous les gentilshommes ne pouvait que fasciner un aventurier de son espèce. S’étant forgé une personnalité au gré de lectures assidues desMémoires de Giacomo Casanova, il ne lui reste plus qu’à endosser des identités en rapport, au hasard de ses aventures. Pour la police de son rival Richet, quoi qu’il en soit, il restera toujours une ombre insaisissable, « a young, dashing, Casanova like type », qui, à son nez et à sa barbe, séduit les promises avant de les délester de leurs présents de fiançailles en emportant presque leur bénédiction.
Tout est donc d’emprunt chez cet aventurier jouisseur ; l’identité comme les manières et les bon mots. Ceux-ci, quand bien même ils sont toujours détournés avec le meilleur à propos, sont empruntés aux aphorismes d’un Saint-Simon (« nous avons tous assez de force en nous pour supporter les malheurs d’autrui ») ou autres brillants épigrammes d’un Oscar Wilde (« parfois les liens du mariage sont trop lourds pour n’être supportés que par le couple »), et peu importent les anachronismes. Le flair de ce brillant usurpateur justifie sans problème ces petites licences historiques (« élémentaire mon cher Houdon ! « ), qui en outre ajoutent à cette si délicate et indicible ironie.
A Scandal in Paris est au demeurant étranger à tout réalisme, qu’il soit historique, architectural ou même psychologique. Les prisonniers y dissimulent à peine un couteau effilé dans quelque bas troué, lequel couteau servira à découper un gâteau recelant une fragile petite lime, pourtant sésame pour une évasion réussie. Des jeunes filles à demi nues s’égayent et badinent dans une mare aux reflets lactés, sous la menace d’un immense serpent qui n’aurait pas sa place dans nos contrées d’Europe occidentale, dans un tableau animé, improbable mais sublime, que l’on croirait inspiré de quelque esquisse de Gustave Moreau ou de tout autre représentant du courant symboliste. De ce même courant symboliste se réclame également l’étrange carrousel chinois sur lequel Vidocq et Thérèse s’avouent leur amour et où, plus tard, Vidocq – Saint-Georges terrassera son dragon aux yeux globuleux (Akim Tamiroff). Les plus pieuses jeunes femmes s’y éprennent de preux chevaliers sur leurs blancs destriers, mais apprenant que le Saint-Georges fantasmé n’est en réalité qu’un coquin, s’avèrent prêtes à faire table rase des beaux principes distillés par une éducation irréprochable pour rejoindre le bien aimé dans sa vie aventureuse. Quant aux toutes petites filles (la petite Mimi, interprétée par une irrésistible Jo Ann Marlowe dans une performance remarquable d’insolence que n’aurait pas reniée Margaret O’Brien), témoins lucides et amusées de toutes ces manigances, elles sont parées par l’auteur d’une clairvoyance et d’une intuition généralement réservées à leurs aînées (« I knew from the beginning that no man is a saint ! « ).
C’est une farandole surréaliste et enivrante que nous livre Douglas Sirk. L’enivrement, tout spirituel, provient de ces innombrables et très subtils renvois que sait distiller un récit pourtant éclaté, extrêmement généreux en péripéties diverses et picaresques. Interprétée par une Carole Landis en rupture de ban avec la Fox (elle devait d’ailleurs malheureusement se suicider à peine deux ans plus tard), gouailleuse, sensuelle, étourdissante de santé, dont on peine à croire qu’elle a pu végéter dans l’ombre des deux stars si ternes des comédies musicales de la firme que furent Alice Faye ou, pire, Betty Grable, la chanteuse Loretta naît devant nos yeux telle une sublime silhouette derrière le drap de son spectacle et disparaît comme elle était née, tel un songe à peine esquissé derrière son paravent. C’est son mari trompé Richet qui l’abat sous l’emprise d’une folle crise de jalousie, après qu’il a confondu l’ombre d’un mannequin avec son amant, lui qui depuis des années, justement, pourchassait une ombre insaisissable. Ce même Richet qui avait été averti par l’inénarrable Mimi que le mauvais sort ne manquerait pas de le poursuivre, alors qu’il s’était permis d’ouvrir un parapluie en intérieur…

En quelques plans, Sirk vient de signer l’une de ces ruptures de ton étonnantes et impromptues, toujours parfaitement gérées, qui déstabilisent et fascinent tout à la fois. Nous venons de quitter Vidocq et Thérèse sur leur manège à s’avouer leur flamme (magnifique tirade de Sanders : « in her eyes I see myself as I am, in your eyes I see myself as I could be, as I hope to be ») devant une Mimi qui, plus malicieuse que jamais, se voile pudiquement les yeux de sa voilette, quand soudain la photographie de Schüfftan se pare d’ombres nocturnes inquiétantes autour d’une figure de colporteur d’oiseaux grotesque sous son postiche : Richet interprété par Gene Lockhart (Hangmen Also Die), comme à son habitude tour à tour truculent et pathétique, guettant son épouse infidèle en espérant ainsi pouvoir capturer son ennemi intime. La farce, un peu grinçante, s’en mêle tout d’abord lorsque le colporteur, improbable croisement entre Papageno et Jericho (le marchand d’habits des Enfants du Paradis) est brutalement refoulé par un gendarme qui le prend pour un satyre. Puis c’est la vision des ombres à la fenêtre ; la méprise ; la confrontation à l’étage ; les cadrages qui deviennent obliques, les petites notes d’Eisler qui viennent se noyer dans le piaillement des oiseaux de plus en plus affolés ; la tension sourde qui se fait de plus en plus pressante à mesure que Loretta, cinglante et réellement humiliante, fait face à cet époux éperdu avec lequel elle ne partage rien sinon quelques tendances fétichistes (elle pour les chapeaux, lui pour les déguisements et postiches) ; et le meurtre dans un moment d’égarement rendu palpable par l’intensité peu commune dégagée par la mise en scène de Sirk, la frénésie se poursuivant longtemps après le coup de feu, jusqu’à l’arrivée de Vidocq ; il ne reste plus à ce dernier qu’à apaiser son malheureux rival en lui assurant qu’il a déjà mis un terme à la carrière de ce mystérieux malfaiteur, cette ombre insaisissable, ce qui n’est qu’un demi-mensonge. « You’re a great detective, greater than I ever was… » conclut tristement le pauvre Richet. Cette fois l’ironie est pathétique, et les gorges se nouent vraiment.
DVD CLASSIK
Si sur la fin du récit la frivolité laisse place à la gravité la plus franche, puisque l’épisode se poursuit par l’affrontement très symbolique sur le carrousel chinois entre Vidocq et son mauvais génie Emile pour qu’enfin Saint-Georges terrasse le dragon, la palette des humeurs proposée par ce joyau unique est d’une richesse peu commune. Une poésie romantique des plus exquises naît de chacune des cinq rencontres entre Vidocq et Thérèse (angélique Signe Hasso, la délicieuse nurse du Heaven Can Wait de Lubitsch, pourtant alors âgée du double de l’âge requis par son personnage) qu’une vénération absolue réduit chaque fois au mutisme le plus complet et le plus désarmant. La farce la plus assumée s’y manifeste également, au gré des humeurs du couple Loretta – Richet (le piétinement furieux d’un chapeau ; le rire tonitruant et anthologique de la belle découvrant en deux temps la nouvelle identité de son ancien amant ) et y vire parfois au pastiche : c’est alors la pittoresque transmutation de Vidocq en Sherlock Holmes pour « résoudre » l’étrange cas du lys fané. Le récit s’autorise même un détour absolument divin vers la comédie musicale, le temps d’un numéro plein de sous-entendus chanté par une Carole Landis aguicheuse, au cours duquel Sirk, Schüfftan et Emile Kuri (futur directeur artistique de Duel in the sun) se permettent d’explorer tout le potentiel de magie du cinéma de ces années là.
Le reste du métrage c’est une ironie légère, souriante et ludique qui prédomine, merveilleusement servie par un George Sanders délectable dans un emploi cousu de fil blanc pour sa nonchalance désinvolte, son élégance suave et feutrée et son esprit caustique. L’acteur semble s’amuser comme jamais. Il nous ravit de sa gestuelle particulièrement étudiée (chez Sanders l’utilisation du monocle relève des beaux-arts !) et nous fascine par sa diction si sobre et percutante. Chacune des tirades que lui a concoctées Ellis St. Joseph semble ne pouvoir s’exprimer pleinement qu’à travers son phrasé. Il est permis de penser que sa composition est la plus brillante de toute sa carrière, en tout cas en ce qui concerne ses emplois de premiers plans : un chef-d’œuvre tout simplement ! Il retrouvera Sirk une dernière fois l’année suivante pour la moins concluante de leurs trois collaborations successives : un remake fidèle par le découpage mais quelque peu édulcoré dans l’esprit de Pièges, brillant film noir à la française réalisé en 1939 par Robert Siodmak. Sanders y reprendra le rôle tenu à l’origine par Maurice Chevalier tandis que Lucille Ball (malheureusement un miscast), Charles Coburn, Cedric Hardwicke et Boris Karloff y reprendront ceux respectivement tenus par l’inégalable Marie Déa, André Brunot, Pierre Renoir et Erich von Stroheim (1).
Avant de refermer cette analyse, signalons que selon l’allégorie religieuse Saint-Georges ne tue pas le dragon mais le terrasse de sa lance et le soumet. Vidocq lui, d’une lance improvisée, se débarrasse complètement de son mauvais génie Emile. Mais a-t-il éliminé pour autant le dragon qui sommeille en lui ? Allez savoir ! En un ultime pied de nez ironique c’est un petit singe capricieux qui vient brandir le carton de fin final. Un petit singe dénommé…Satan !
(1) Lured (Des filles disparaissent) est également disponible chez l’éditeur Kino dans une édition techniquement irréprochable.