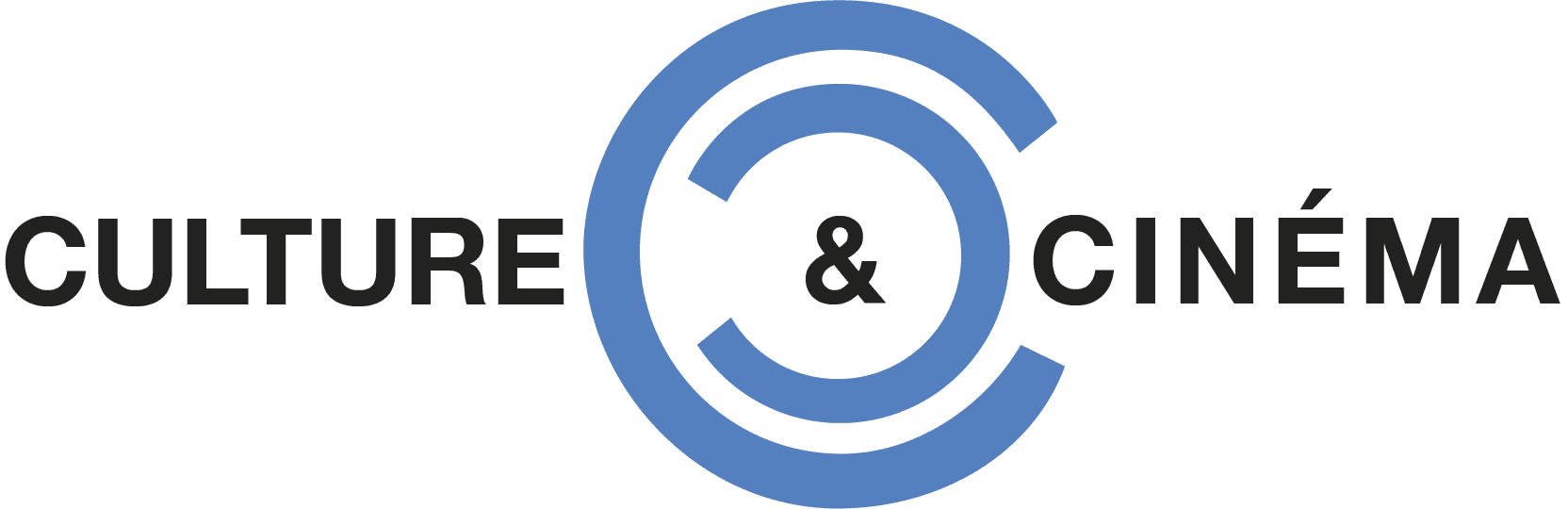Canción sin nombre s’ouvre sur des images d’archives qui installent aussitôt le récit dans un pays au bord de l’implosion. Records d’inflation, contestation de plus en plus radicale du Sentier Lumineux[1] et surenchère répressive d’Alan Garcia, président controversé dont le surnom (« caballo loco », le cheval fou) s’étale sur les murs des villes : le premier film de Melina León reconstitue à l’écran la morosité du Pérou des années 1980, entre coupures de courant, couvre-feu et corruption généralisée. Au cœur de ce désespoir ambiant, la réalisatrice se penche sur une sordide affaire de trafic de nouveau-nés ayant secoué le pays au début de la décennie. Un scandale bien réel, énième symptôme d’un climat politique délétère et symbole d’une population qui a vu son avenir lui être littéralement confisqué.
Dans cette atmosphère pesante, nourrie par l’adoption d’un format 4:3 et d’un noir et blanc mimant le format de la télévision et la couleur des journaux de l’époque, Canción sin nombre nous invite à suivre le parcours d’une de ces femmes que la précarité a entraînées dans le piège d’une « clinique » sans scrupules. Georgina apparaît dans un plan d’ensemble qui embrasse le flanc d’une montagne, dont une minuscule troupe achève la descente, avant de célébrer un rite quechua impliquant danses traditionnelles et feuilles de coca. Quelques instants plus tard, un nouveau plan d’ensemble nous la montre avec Léo, son compagnon, empruntant un cheminement inverse, le long d’une autre montagne qu’il s’agit cette fois de gravir pour rejoindre le marché où le jeune couple vend des patates.
À travers cette succession de mouvements contraires, Melina León pose le cadre dans lequel évoluera son héroïne, à savoir une marginalisation sociale et économique des communautés indigènes qui les maintient toujours « de l’autre côté » d’un obstacle à franchir. En même temps, elle donne le ton de ce qui se révèle peu à peu comme une sorte de pamphlet politique au rythme indolent et à l’esthétique ouateuse – le cadre est bordé d’un halo noir évoquant le cinéma muet –, un récit troué de discrètes ellipses où la mise en scène et le décor, davantage que les dialogues ou les péripéties, expriment l’insoutenable violence à laquelle est exposée Georgina. Aux montagnes des premières scènes se substituent ainsi les innombrables marches que la jeune femme se voit sans cesse contrainte de gravir, qu’il s’agisse des escaliers en colimaçon de la clinique, filmés en contre-plongée pour mieux y enserrer la figure chancelante de Georgina, ou des marches imposantes du tribunal, où les corps paraissent toujours plus frêles à mesure que la caméra révèle l’architecture monumentale qui les surplombe.
Du silence et des ombres
La maîtrise formelle qui caractérise le film confine parfois à une certaine raideur, un souci d’esthétiser chaque plan et de l’organiser selon des considérations géométriques qui tend à brider la charge émotionnelle portée par le scénario. Mais ce que ces choix de mise en scène parviennent malgré tout à rendre tangible, c’est la fragilité du corps au sein d’une société violente et autoritaire. Tout se passe comme si, à travers cette affaire d’enlèvement, la corruption généralisée du système politique débordait sur le corps lui-même, déréglant ses cycles naturels et entamant sa liberté de mouvement. Victime du climat politique, le corps doit lutter pour ne pas se laisser amoindrir, paralyser ou même nier, devenant à son tour un objet politique. C’est sans doute à ce niveau que se situe la beauté de la relation qui se noue entre Georgina et le journaliste qui l’aidera à révéler le scandale : quand la jeune femme fond en larmes au milieu de la salle de rédaction, ce n’est pas un simple échange de regards qui s’établit avec Pedro, mais une forme de reconnaissance mutuelle, soulignée par un gros plan. Une rencontre des corps et des destins qui passe peut-être d’abord par la couleur de peau des deux personnages (tous deux sont d’origine amérindienne), mais aussi, plus largement, par la mise en présence de deux corps entravés (elle doit lutter contre la misère ; il est contraint de cacher son homosexualité).
Car le corps libre, dans Canción sin nombre, est toujours un corps étranger (le voisin cubain de Pedro) ou un corps complice de la violence (Léo, embrigadé par des militants du Sentier Lumineux). Pour résister à l’aliénation ou à l’écrasement, semble nous dire le film, il ne reste plus qu’à se fier aux mots : prendre et recueillir la parole, dans une société qui tente par tous les moyens de l’étouffer. Autour du cri lancé par Georgina dans la salle de rédaction (« On m’a volé ma fille ! »), seul moment du film où la jeune femme semble trouver un véritable interlocuteur, Canción sin nombre est habité par une parole asymétrique, détournée ou empêchée. La discussion qu’entame Pedro avec un juge reste inachevée, alors que le corps de ce dernier disparaît hors-champ, protégé par la présence d’un soldat qui empêche le journaliste de le suivre. Quand Léo intègre le Sentier Lumineux, sa récupération et les discussions qui s’ensuivent prennent une forme implicite ou inachevée, évoquant seulement à mots couverts des « missions » et des « réunions ». Que ce soit du côté du pouvoir ou de la dissidence, tout s’exprime à demi-mot et semble flotter dans une imprécision et une absurdité kafkaïennes.
Dans sa simplicité et son refus du pathos, Canción sin nombre s’approche finalement davantage de la fable ou de la parabole que du film-dossier ou du mélo démonstratif. La parole qui se déploie et qui subsiste, à la fin du film, n’est pas un cri de rage, mais une simple berceuse, chantée à voix basse par une Georgina qui, pour la première fois, surplombe le décor. Une berceuse adressée à un enfant sans nom, chantée face à un océan dont le mouvement imperturbable semble à la fois rejouer et mettre à distance les souffrances répétées qu’a subies le personnage. Un rite intime, presque secret, qui résume assez bien ce premier long métrage, sa poésie et sa douceur, mais aussi la puissance politique qui se déploie discrètement dans les interstices d’un quotidien tragiquement banal.
Notes
1. ↑ Le Sentier Lumineux est un parti communiste péruvien d’inspiration maoïste fortement implanté dans les campagnes, dont les actes de contestation ont pris la forme d’une violente guérilla à partir des années 1980. Cette évolution a entraîné une répression tout aussi violente de la part du gouvernement péruvien et a valu au parti d’être classé dans la liste des organisations terroristes par la plupart des pays occidentaux.
Critikat Hugo Mattias