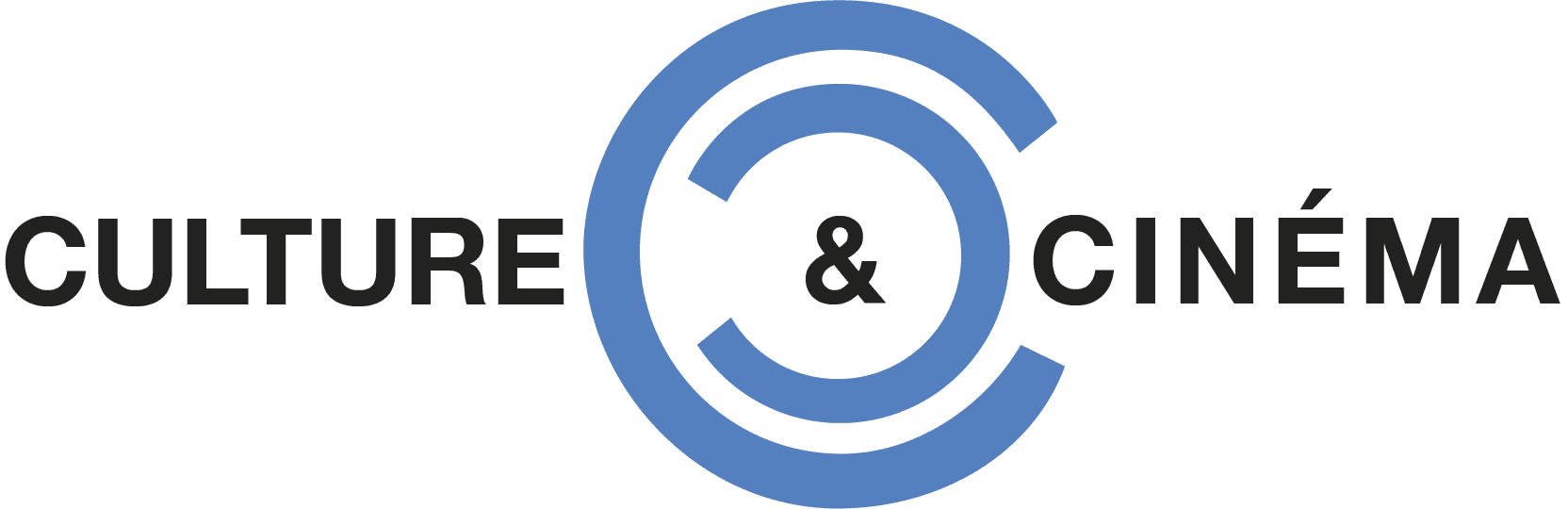Le centre-ville de Kaili en remodelage permanent. Photo Julien Gester
Avec les superbes «Kaili Blues» et «Un grand voyage vers la nuit», le jeune virtuose a inscrit sa ville sur la carte du cinéma chinois puis explosé le box-office. «Libération» lui a rendu visite chez lui, à Kaili, dans la province isolée du Guizhou. D’apparitions en disparitions.
«Welcome to Kaili» clame, en grosses lettres rouges, la colline qui domine l’entrée en gare du TGV arrivé de Guiyang, la capitale provinciale. En contrebas, l’exosquelette d’un immeuble moderne en construction voisine le feuilleté de tuiles noires d’une pagode. Comme dans un film, sur le quai, on se voit offrir une cigarette au parfum de mandarine, une marotte locale, et l’on se trouve soudain rappelé à la première fois que l’on avait entrevu l’existence de cette ville, de cette Chine-là, subtropicale, brumeuse, dentelée de montagnes à la verdure crépue sous une chape d’épais nuages : c’était à l’été 2015 en bordure d’un lac suisse, à la faveur de l’éblouissement du premier film qu’un jeune homme de 26 ans présentait au festival de Locarno – Kaili Blues.
Le prodige inconnu s’appelait Bi Gan. Débarqué de nulle part sur nos cartes du cinéma chinois et épaulé seulement de camarades d’école, tous novices et nés comme lui dans les années 90, il filmait les alentours de sa ville comme un conte mystique où se précipiteraient passé, présent et songes, avec une virtuosité calme, miraculeuse, au climat d’épiphanies multiples. Sur l’écran se révélaient ainsi en même temps un paysage et un arrière-monde, une façon de filmer les multiples épaisseurs du temps dans le pur présent d’un plan-séquence sans fin, et le regard d’un cinéaste-poète, peut-être immense, qui aurait reçu des films de Hou Hsiao-hsien et Wong Kar-wai quelques leçons déjà mûries et fondues dans la géographie particulière de son environnement familier. On était sorti de là ivre comme rarement du sentiment d’avoir reçu une décharge de quelque chose d’inconnu, et de très puissant. Et si un jour d’automne trois ans plus tard on se rend enfin en personne à Kaili, c’est parce que l’on a rendez-vous avec lui.

Un grand voyage vers la nuit de Bi Gan. Photo Dangmai Films
Futuriste et forain
Un saut à l’hôtel, une soupe de nouilles aux tripes d’oie sifflée, le voilà qui nous cueille à bord de sa belle voiture neuve, la première européenne que l’on aura croisée depuis l’atterrissage en Chine. Il porte toujours ce sourire doux et les mêmes petites lunettes rondes qui, au temps de son premier film, lui donnaient un air d’enfant tardif un peu triste. Le revers de sa main affiche une décalcomanie à l’effigie d’un cochon, apposée là par son fils. Mais, les joues rondes de gamin se sont copieusement épaissies et faites celles d’un homme à l’évidence très bien nourri – en Chine, c’est là paraît-il une marque de bonne fortune. A ses basques, la caméra d’une équipe de télévision qui lui consacre un documentaire, et nous suivra jusqu’au soir.
Car entre-temps, Bi Gan a créé sa boîte de production et réalisé cet autre film qui sort en France mercredi : Un grand voyage vers la nuit, également tourné entre Kaili et les environs, mais à mille lieues des conditions d’artisanat du premier, avec moyens financiers plus conséquents, coproducteur français et première très scrutée au Festival de Cannes en mai dernier. Une splendeur déroutante, y compris pour les admirateurs de la première heure, et une folie, qui se mue à nouveau à mi-course en un stupéfiant plan-séquence, planant au possible, d’une durée de 59 minutes. En 3D. Film noir en décomposition, où un homme revient à Kaili en quête des traces et fantômes d’une mère morte, d’une amante disparue et d’un enfant jamais né, le film se scinde ainsi en deux temps distincts : l’un tout de bris d’enluminures au néon, d’éclats dispersés et souvent sibyllins de scènes sublimes, mais un sublime qui sentirait un peu la poussière, la cire et la mort, avant que le deuxième volet du film, en relief, d’un seul tenant, à la fois futuriste et forain, vienne y apposer sa réparation consolatrice, comme les rêves nous cueillent au soir pour raccommoder les insatisfactions décousues de la vie. Et l’on croirait alors, au bout du grand voyage, voir un enfant de la technomodernité illustrer à la lettre le geste que Virginia Woolf prêtait à Emily Brontë, avec cette façon de délivrer en un plan «sa vision d’un monde ravagé par un immense désordre dont [il] aurait retrouvé l’unité».

A Kaili, en octobre. Photo Julien Gester
Lorsque l’on rencontre le cinéaste sur ses terres mi-octobre, le film suscite déjà une fervente excitation tant pour les médias qu’au sein d’une industrie du cinéma national en expansion effrénée, mais nul ne saurait deviner qu’il deviendra en une nuit, celle du 31 décembre, le film d’auteur de loin le plus rentable de l’histoire du pays, avec quelque 38 millions de dollars de recettes empochés le soir de sa sortie (soit 33,5 millions d’euros et plus de 7,3 millions de spectateurs quand Kaili Blues en avait rassemblé moins de 200 000 en dix jours), très loin devant sa concurrence de blockbusters américains. Et les entrées auront beau chuter dès le lendemain – une campagne marketing en forme de malentendu sublime, axée sur le romantisme du film, avait attiré dans les salles un très grand public pas préparé au voyage, au risque de bousculer les habitudes et de changer quelques vies – , cet invraisemblable casse assurera à Bi Gan, 29 ans, de rêver à sa guise aux films qu’il lui plaira de tourner les décennies à venir. Ce qui était initialement loin d’apparaître acquis à ce jeune homme issu de la minorité Miao, né dans le Guizhou – soit une région paysanne et minière, historiquement l’une des plus pauvres du pays, encore peuplée d’une multitude de communautés non officiellement reconnues par Pékin -, et dans une ville alors dépourvue de salle de cinéma. Un garçon dont la plus haute et intouchable ambition, lorsqu’il entama des études à l’école de télévision, consistait à réaliser des films animaliers, mais dont le CV, jusqu’à Kaili Blues, était surtout fleuri de boulots de réalisateur de films de mariage, de coups de main au salon de coiffure de sa mère et de missions d’artificier en charge de dynamiter la roche dans les montagnes alentour.
Bi Gan a beau avoir un père chauffeur de métier, il n’a obtenu son permis que trois mois avant qu’on le retrouve au volant cet automne. «Vous êtes le premier étranger à s’asseoir dans ma voiture», s’enthousiasme-t-il, prenant à l’évidence un plaisir de gosse à piloter la balade automobile du jour, qui sillonne quelques-uns des lieux indissociablement liés à sa vie et ses tournages. Sans les retrouver tous, loin de là. Nombre d’entre eux, logés dans le secret des montagnes, demeurent presque inaccessibles, tel ce village retiré où se perdait la dérive du héros de Kaili Blues (« Im possible à trouver. L ’accès est très difficile et il n’est pas répertorié par les GPS. L a seule personne que je connaisse qui maîtrise la route n’est pas à Kaili ces jours-ci»), ou cet étrange complexe à l’abandon qui servit de théâtre à l’étourdissant plan-séquence d’Un grand voyage vers la nuit : une ex-mine soviétique de «mercure aurifère», disent les villageois voisins, devenue une ex-prison chinoise abandonnée, à plus de deux heures de la ville, via une route rendue dangereuse par les coulées de boue. D’après le recensement d’une ONG américaine qui documente les laogai, ces équivalents maoïstes du goulag par lesquels seraient passés plus de 50 millions de Chinois depuis 1949, plusieurs usines et mines de la région de Kaili ont pu remplir ce terrible usage.
Hallucinations
Cao Shanshan, jeune collaboratrice du cinéaste, qui assure la traduction des échanges entre le mandarin et l’anglais, évoque depuis la banquette arrière, amusée, «ces cinéphiles chinois obsédés par Kaili Blues qui viennent ici sur les traces du film. Ils repartent souvent déçus car beaucoup d’endroits ne sont pas en ville et très difficiles d’accès». D’autres, comme le quartier où Bi Gan a grandi, se sont tout simplement évanouis, effacés au gré d’une politique de développement urbain enragée, s’ingéniant à muer la plupart des villes chinoises petites et grandes en d’immenses chantiers et champs de bataille pour pelleteuses et grues qui s’y livrent à un roulement incessant. Entre les avenues du centre qui sentent le neuf, soulignées par la litanie de tours sans qualité, on discerne partout des trous, crevasses, dont sortiront d’autres tours.

A Shiqiao, village de la minorité Miao, en périphérie de Kaili. Photo Julien Gester
«Notre société de production est installée à Pékin, après avoir été basée à Shanghai – je déteste Pékin, ville beaucoup trop virile ; alors que Kaili est comme une femme mystérieuse. Mais tout est là-bas, à part la finance, ancrée à Shanghai, déplore Bi Gan, avec ce mélange de rondeur calme et de douceur un peu voilée qui enrobe ses paroles. A chaque fois que je vais à Pékin pour travailler, je reviens une semaine plus tard et je constate que quelque chose a changé : parfois il y a une rue que je ne reconnais pas. Tout bouge constamment dans ces villes de quatrième ou cinquième catégorie
. On ne peut pas nier que les transformations apportent un gain de confort aux gens, mais le passé disparaît et il est impossible de ne pas être nostalgique.» La visite se trouvera scandée souvent de cette annonce un brin fataliste, devançant la possible volatilisation de l’étape suivante du parcours : «Venez, allons voir si cet endroit existe encore.»
Tandis que la voiture traverse l’un des principaux carrefours du centre-ville, il désigne le terre-plein central, coiffé d’imposants tambours de bronze : «C’étaient les instruments traditionnels des Miao. Aujourd’hui c’est un monument coincé entre deux centres commerciaux. Kaili est une combinaison de choses très neuves et de vieilles beautés raréfiées.»

A Kaili. Photo Julien Gester
Plus loin, en bordure d’une quatre-voies, il pointe une petite chute d’eau cernée de verdure qu’il a filmée dans Kaili Blues («C’est rare de trouver une cascade à l’intérieur de la ville. Elle alimentait une centrale électrique.»). A quelques minutes se trouve l’imposant double tunnel de béton où il a tourné l’une de ces très belles séquences d’Un grand voyage vers la nuit qui fait tanguer le régime de réalité du récit pour en exposer l’envers de hantise, d’hallucinations et de désir fulminants. «J’avais d’abord envisagé de trouver un lieu pour chaque face de la séquence, réelle puis irréelle, mais c’est la découverte de celui-ci qui m’a donné l’idée de mise en scène et convaincu de tout tourner au même endroit, en empruntant un tunnel pour la réalité, l’autre pour l’apparition de la femme à la robe verte.» La robe, il nous soufflera plus tard l’avoir directement prélevée dans une autre histoire d’homme errant éperdument en quête d’une femme évaporée : Vertigo. Un film qu’il avait d’abord découvert étudiant, à l’époque où, quasi étranger au cinéma et à son histoire, il s’éprouvait aux classiques et, faute d’avoir déjà aiguisé son regard, les trouvait souvent «horribles» ou «atrocement ennuyeux». Comme alors le film d’Hitchcock, qu’il revit des années plus tard, en préparation d’Un long voyage vers la nuit, pour s’en trouver cette fois bouleversé. «C’est peu dire que ça ne m’a pas fait le même effet…»sourit-il. A l’autre extrémité du passage, le ruisseau issu de la cascade se déverse dans un petit lac bordé d’une végétation désordonnée et de maisons grises, comme posées au hasard du relief, au creux des collines. Un peu plus avant, la voiture s’engage sur un pont étroit et délabré, dont les embouchures ont été partiellement murées pour empêcher le passage des camions. Il faut rouler au pas sous peine de rayer les portières de la berline neuve. «C’est là que s’est tournée la scène après le passage en prison, où le héros rencontre le policier qui lui remet la première page du livre. Maintenant, essayons de trouver l’endroit où j’ai installé le décor du restaurant, je ne sais pas s’il est toujours là.»
Chignon complexe
Il conduit jusqu’en haut d’un talus, où une petite épicerie tenue par un couple surplombe une voie ferrée. Les propriétaires ne paraissent pas reconnaître Bi Gan, mais tout contents de la présence de la caméra de télé, l’invitent à rester pour «dîner» – il est 13 heures. Il secoue la tête en souriant, puis explique : «Ici, nous avions installé le décor du restaurant de la mère du héros. J’ai d’abord trouvé les rails, sur lesquels passerait le train, ce qui m’a conduit ici. Je voulais dépeindre une atmosphère de fin du monde, de tremblement du réel, c’est pourquoi il y a ce verre d’eau qui se met à vibrer. Ce n’est pas un hommage à Tarkovski, mais à cause du train passant sur la voie en dessous. Je voulais montrer que les deux amants aspiraient à échapper à leur réalité et c’est pour ça que j’ai inséré ce détail, pour ne pas le figurer de manière littérale, avec ce train qui va dans un sens puis dans l’autre, combinant la réalité et le rêve.»
Dans l’escalier qui conduit aux rails, flanqué des mandariniers poussant sur les pentes, on croise le passage d’une vieille porteuse de palanche, aux paniers lestés de riz et de poivre. L’éruption d’un souvenir colore le visage du cinéaste : «Les gens d’ici construisent de manière très traditionnelle du fait de la topographie, et ils utilisent parfois des animaux pour descendre du sable jusqu’à leur chantier. Quand on a tourné ici, un cheval est soudain apparu et a commencé à descendre l’escalier vers la voie, seul. Mais le temps de penser à l’insérer dans le plan, il avait disparu. Etait-il vraiment là ?»
On reprend la route. Sa playlist joue Goodbye to Romance d’Ozzy Osbourne dans l’autoradio. Bi Gan expose quelle place prépondérante l’ancrage de son cinéma dans sa ville et sa région tient jusque dans l’écriture de ses films : « J’ai l’habitude d’imaginer et écrire les scènes à partir des endroits que je trouve. A l’époque de Kaili Blues, je roulais beaucoup à moto et je m’arrêtais quand je trouvais un lieu intéressant pour prendre des notes pour le scénario. Les décors apportent par leur géographie et leur atmosphère une réponse à l’histoire que je veux raconter, puis ils dictent la mise en scène. Mais le fait d’avoir de l’argent cette fois a permis de ne plus être dépendant des lieux que pouvaient me prêter mes proches, ou dont je pouvais disposer gratuitement. On a pu construire, créer.» D’où, avance-t-on, ce sentiment que quelque chose de la dimension presque documentaire, organique, qui s’engouffrait dans Kaili Blues malgré la stylisation, a pu s’estomper sous un vernis d’embourgeoisement, du moins dans la première partie. Lui rétorque : «Un grand voyage vers la nuit s’est fait dans des conditions simplement normales, avec des méthodes à peine moins artisanales – je ne sais toujours pas vraiment utiliser un combo de retour image, par exemple. Malgré les neuf mois de tournage, on a obtenu énormément avec un budget tout à fait standard. J’y montre moins la ville telle qu’elle est parce qu’elle se transforme et se développe à une telle vitesse depuis trois ans qu’il nous était devenu presque impossible de l’enregistrer. Regardez par la fenêtre : juste devant vous, il y avait il n’y a pas si longtemps une colline. Aujourd’hui, un immeuble a poussé à la place.»
«Je suis peut-être voué à faire des films de plus en plus étouffants, médite-t-il. Et cela tient aux transformations et au développement urbains, avec ces horribles grands et gros édifices modernes, que je n’ai pas très envie de montrer. J’imagine que moins la ville sera présente dans mes films, plus je serai obligé de filmer en intérieurs. Au départ, je filmais des gens assis au milieu des terrains vagues. A présent, ils sont assis dans une pièce avec une fenêtre. Dans mon prochain film, il ne restera peut-être que quatre murs étroits.» S’éloignant du centre, la voiture longe une décharge. Il roule très lentement. Puis l’on traverse une zone en bordure de Kaili, marge urbaine dont l’aménagement se fait très brut, aux reliefs et contours indécis, comme si campagne et ville y entraient dans une collision dont toutes deux sortent pantelantes. Une population manifestement démunie y vend des légumes terreux à même le bord de la chaussée, qui ne fait pas toujours l’effort de ressembler à un trottoir. Des femmes portent l’habit et ce chignon complexe piqué d’une grosse fleur qui les identifient comme de la minorité Miao.
Marmite écarlate
Le tournage, qui ne s’est achevé que trois mois avant le Festival de Cannes, en a duré neuf, sur courant alternatif, haché par le cortège de «difficultés». Parfois les décors prévus n’existaient plus, ou n’avaient pas été construits à temps. Avant d’être émietté et rapiécé sur la table de montage en un iridescent collage de souvenirs et fantasmes douloureux, le récit a beaucoup muté au gré de ces aléas. L’équipe aussi : «Le tout premier jour du tournage, je me tenais au milieu des voies et j’ai songé que rien n’allait, qu’il fallait tout arrêter. Le chef déco est parti avec ses assistants, ce qui nous a mis à l’arrêt. Lui ne venait pas de Chine continentale mais de Taiwan, et il ne comprenait pas comment négocier avec ce type d’environnement, comment ça se passe ici. C’est eux qui avaient fait tous les repérages. Quand son remplaçant est arrivé, il lui a fallu du temps pour s’adapter aux lieux et comprendre ce que je projetais. Ce qui nous a aussi ralentis.» Bi Gan a aussi usé quelques chefs opérateurs, avant de finir le travail avec le Français David Chizallet (Mustang, le Sens de la fête) aux manettes du fameux plan-séquence final, prouesse poétique autant que technique, tourné dans l’environnement reculé de l’ancienne mine-prison.
Il se gare devant un salon de coiffure bardé de couleurs et de panneaux LED clignotants : «C’est celui de mon oncle, qui joue le vendeur de feux de Bengale dans le film.» Un autre tonton, vigile de son état, tenait le premier rôle magnétique et banal de Kaili Blues – Bi Gan lui avait décelé une fibre artistique en le surprenant un jour en train de regarder un DVD pirate du Peuple migrateur – et en a conçu depuis une petite carrière d’acteur. On gravit un chemin bétonné qui surplombe de petites baraques de briques et de tôle. «Attention, même s’il ne pleut pas souvent, il y a souvent des coulées de boue», prévient Shanshan, la collaboratrice du cinéaste, tandis que l’on enjambe un amas de haricots plats noircis qui pourrissent au sol. De câbles métalliques tendus entre les arbres que l’on longe pendent des cages rondes où tournicotent de jolis oiselets cendrés – «les gens d’ici ont l’habitude d’en élever de très beaux»,commente Bi Gan.
On parvient à un terre-plein, cour où sèche le linge devant une maison en briques traditionnelle, typique du sud de la Chine et donc grande ouverte sur le dehors, si bien que l’on en devine les deux pièces : une cuisine très sommaire et une chambre-salon où l’électroménager jouxte un imposant autel au bois gravé d’inscriptions jaunes, décoré d’encensoirs, d’ancestrales photos de famille et de bougies électriques. «Ma grand-mère habite ici, explique Bi Gan, et c’est l’un des seuls endroits en ville qui n’a pas tellement changé depuis mon enfance. Parce qu’il est à flanc de montagne. J’y ai filmé plusieurs scènes de Kaili Blues.» «J’ai aussi tourné sur la plateforme, là-bas, poursuit-il en pointant l’étendue dallée d’un toit plus bas. Mais je ne le referais plus aujourd’hui. A l’époque, les deux immeubles modernes que vous voyez à côté n’existaient pas.» Tandis que l’on prépare le repas qui mijote sur la braise incandescente («Ça va être très épicé», nous prévient-on, dans un mélange de gravité inquiète et de malice), on prolonge notre exploration de l’arbre généalogique du cinéaste : grands-parents, tante, oncle, cousin qui déboule à scooter et arrose tout le monde de clopes parfumées. On sert du thé et des fruits du cru : prunes, jaques, graines de melons séchées, pomelos et mystérieux branchages dont s’extrait une pulpe sucrée. On se voit même offrir du vin, que l’on décline poliment, non sans apprécier l’étiquette dorée du producteur de ce bordeaux, la «Château Margot Winery Ltd.», manifestement sise à Yantai, dans le Shandong.
A table, des jeunes du coin s’agrègent au cercle autour du cinéaste, buvant le thé en silence. Des pieds de porcs fument dans une marmite écarlate, accompagnés d’une préparation de «nerfs de bœuf» et de riz, et le réalisateur dont l’équipe suit Bi Gan depuis le matin expose l’objet de son documentaire pour la principale chaîne publique nationale, consacré aux transformations du cinéma chinois depuis l’ouverture du pays : «Bi Gan est le symbole de la nouvelle génération, même s’il est très spécial. Sa relation à sa ville, qui imprègne tans ses deux films, intrigue beaucoup. Jia Zhangke, lui, incarne la génération précédente.» De cet aîné,Bi Gan admire le premier film, Xiao Wu : «Je crois que, comme Kaili Blues, c’est un film plastiquement assez grossier, brut, mais doté d’une force de vie, une énergie telle que vous ne pouvez l’ignorer.»
«Bain public»
Mais s’il est un maître que les voyages – qu’il n’apprécie guère – et les festivals lui ont permis d’approcher, c’est Hou Hsiao-hsien. «Goodbye South Goodbye est son film qui m’a le plus marqué, par sa liberté, évoque-t-il d’une voix lente, presque atone. J’étais très ému de retrouver le décor du film quand je suis allé à Taiwan pour les Golden Horse Awards [équivalents chinois des oscars, ndlr], et cela a beaucoup compté d’avoir pu lui parler. Pour moi, la pratique du cinéma a à voir avec celle du kung-fu, on s’exerce sans savoir si l’on fait les choses bien ou mal, si l’on va dans la bonne direction. Et quand j’ai pu échanger avec Hou, c’était comme me confronter à un grand maître kung-fu, qui l’exerce au plus haut niveau imaginable. Je suis d’ordinaire très calme, maître de mes émotions, mais cela m’a mis dans un état d’anxiété pas possible tant je l’admire. Il m’a conforté dans l’idée que j’étais sur la bonne voie, que ma façon de faire du cinéma était bonne. C’était un vrai soulagement : je ne faisais pas n’importe quoi.»
Lorsqu’on l’invite à y méditer, l’inspiration de ses films révèle des canaux plus secrets et intimement ancrés que le lien à Kaili ou le registre de ses admirations. Après avoir pris congé des grands-parents, on effectue un crochet par le salon de coiffure de la mère, toute d’extensions rouges et de jean vêtue – elle pourrait sans mal se faire passer pour sa grande sœur. Avachi dans l’un des fauteuils, un autre cousin s’y fait faire onduler les cheveux. L’échoppe a été fraîchement redécorée du sol au plafond à coups de lino gris imitant la brique, une fois l’assurance prise que le quartier ne serait pas démoli sous peu. Rivé à son téléphone, où un personnage replet lui sert d’avatar dans l’univers du très populaire jeu vidéo Honor of Kings, Bi Gan évoque ces dessins animés, vus gosse, qui colorent ses films de visions tout droit sorties d’«un univers de cartoon». Il se compare d’ailleurs souvent lui-même à un enfant, s’excusant de sa «naïveté». « Et puis il y a aussi cette moiteur qui imprègne la plupart des scènes. On m’en fait souvent la remarque mais je n’aurais su dire d’où ça me venait, jusqu’à ce que j’en parle à ma mère, qui m’a dit : « Tu te souviens de là où tu habitais enfant ? Non ? On vivait dans cette maison voisine d’un bain public, où toutes les pièces étaient très humides. » Et c’est peut-être pourquoi le monde, les intérieurs, les acteurs se doivent d’être ruisselants, c’est ce qui évoque à mon esprit et à mon cœur une forme de cocon sécurisant.»
Le tour de Kaili s’achève par un long entretien – qui accompagnera la critique du film dans nos pages mercredi – chez lui. Un vaste appartement moderne, avec vue sur les montagnes hérissées de grues. Dans la chambre se repose sa femme, enceinte de leur deuxième enfant, tandis qu’une tante prépare le dîner. Au pied du canapé gazouille le fils aîné, 2 ans, que Bi Gan a prénommé Carno. En tribut à Locarno, cette lointaine bourgade suisse dont il aurait pu ne jamais deviner l’existence, si le surgissement d’un film sur un écran n’y avait à jamais changé sa vie.
Julien Gester Libération. 26.01.19