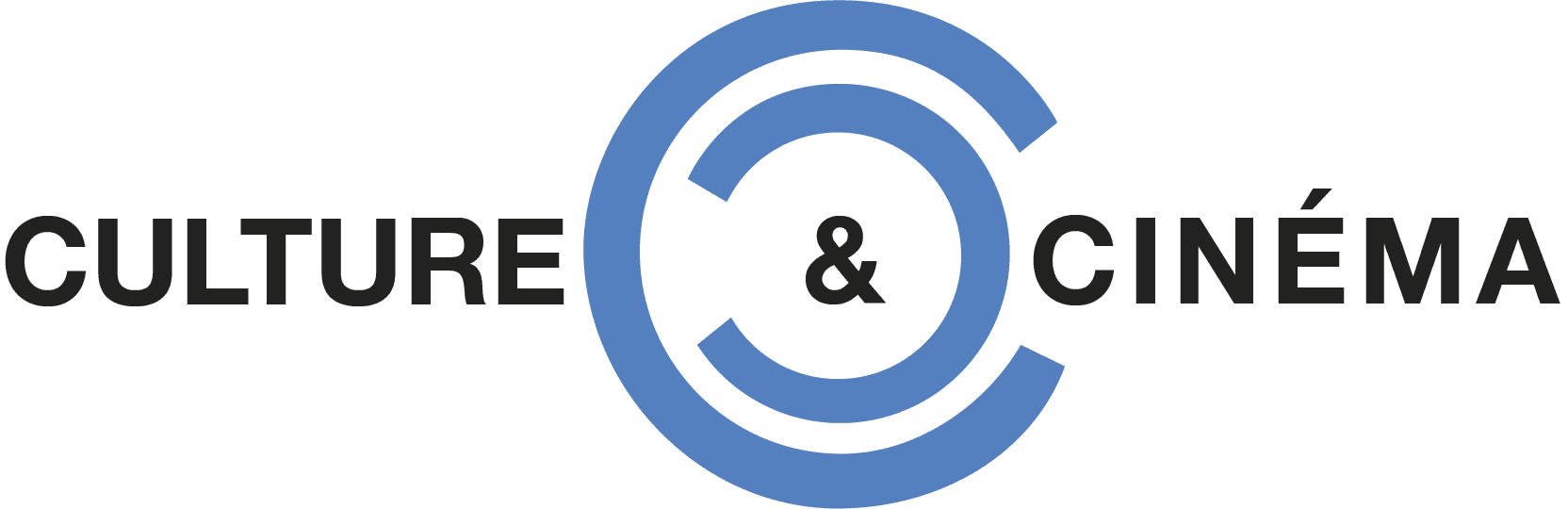Monument secret de l’animation japonaise, le film de Eiichi Yamamoto, arrive en salles dans une version restaurée, quarante-trois ans après sa sortie sulfureuse.
«Belladonna», de Eiichi Yamamoto. Photos Eurozoom
«Bien loin que la foudre infernale l’épuisât, la fit languissante, elle se releva redoutable et les yeux étincelants. La lune qui, chastement, s’était un moment voilée, eut peur en la revoyant. Epouvantablement gonflée de la vapeur infernale, de feu, de fureur et (chose nouvelle) de je ne sais quel désir, elle fut un moment énorme par cet excès de plénitude et d’une beauté horrible.» C’est dans ces mots de la Sorcière, curiosité littéraire entre essai et roman de l’historien Jules Michelet, que se niche l’origine de Belladonna, monument damné de l’animation japonaise créé par Eiichi Yamamoto – le plus beau film du genre resté largement inconnu, si ce n’est d’une frange de passionnés écumant les festivals, qui ressort en salles aujourd’hui dans une version restaurée.
L’histoire est celle de Jeanne et Jean, deux serfs de la France du XVe siècle. Ils s’aiment, s’unissent et la nature semble fleurir à leur passage. Cherchant la bénédiction du seigneur local pour convoler en justes noces, ils se rendent au château avec une maigre offrande, mais, moqué par la cour, le couple est séparé. Jean est jeté hors les murs et Jeanne prise de force par le despote. Ecrasé par la culpabilité, le jouvenceau vire alcoolique tandis que Jeanne, catatonique, est contactée par un démon, sorte de lutin-phallus. Il lui propose de lui donner la force, et plus encore, pour surmonter cette épreuve. Elle succombe. Jeanne retrouve son assurance et s’impose comme une femme respectée. Au point de faire de l’ombre au château, qui la chasse du village. La paysanne qui tentait de faire bonne figure embrasse alors son destin de sorcière. Sa revanche, orgiaque, prendra des allures de dernier sabbat.
Ce qui tient lieu de scénario à Belladonna ressemble de loin à un pitch de film d’exploitation façon revenge porn. Rien n’est pourtant moins vrai. Chez Michelet, Yamamoto est allé chercher une histoire romantique de la sorcière, «celle que l’on nommait « Belle Dame » (bella donna)». Le Japonais en tire un manifeste féministe, bien qu’il affirme que telle n’était pas son intention. L’éveil de Jeanne à la sorcellerie n’est pas une aliénation ou une allégeance à quelque force supérieure, mais une libération. L’érotisme capiteux des scènes de visitation du démon montre une femme qui reconquiert son corps, d’une chair asservie par les autorités morales et spirituelles. Jeanne inquiète parce qu’elle travaille. Et à une époque où le seul mot de «sorcière» vaut condamnation à mort, elle porte fièrement son statut de monstre et tourne le dos à la société pour ne faire qu’un avec la nature, son corps d’albâtre se confondant avec la montagne blanche qui tance le village. La sorcière incarne aussi une quête de droits dans une société où la liberté est réservée aux gens bien nés. Jeanne est dangereuse car elle peut entraîner le peuple dans son entreprise sauvage. Ainsi, un jeune homme de la cour lui assène : «C’est Dieu qui décide de l’ordre des classes. Essayer d’outrepasser cet ordre serait une trahison contre Dieu, une tentative diabolique.» Chez Yamamoto, le Diable n’est pas le mal mais la contestation, la corruption du statu quo et des convenances. Incarnation d’un esprit de révolte, Jeanne est tout à la fois Jeanne d’Arc, la Liberté guidant le peuple (apparition qui clôt le film), toutes les femmes et, au-delà, tous ceux qui tentent d’échapper à la condition dans laquelle on les confine.

Au-delà de ce discours séditieux, la Belladone de la tristesse (le premier nom du film) émerveille par son audace visuelle. A elle seule, la scène de viol stupéfait par son insoutenable violence symbolique. En champ-contrechamp s’affrontent deux entités irréconciliables dans le même plan. D’un côté, une foule de visages grimaçants s’étale sur les murs noirs du château. De l’autre, la peau d’albâtre de Jeanne, écartelée, jetée à même le sol. Son corps se déchire de l’entrejambe jusqu’au cou pour laisser s’échapper une nuée de chauves-souris écarlates. Seul le corps de la paysanne est donné à voir, les pulsations de ses plaies représentant les outrages qu’elle subit. Le supplice vire à la furie, un corbeau piétine le carrelage en hurlant, un jeune page sautille frénétiquement sur place comme un diable en boîte tandis que résonne une trompette frénétique. Balayée, l’image de Jean et Jeanne enlacés tendrement qui s’affichait plus tôt. A l’écran, il ne reste que terreur – l’usage restreint du rouge, du blanc et du noir accentuant la puissance de ce ballet des profanations.
Belladonna s’épanouit dans un appétit des extrêmes, un mariage entre la modestie d’une animation recourant à l’image fixe et le flamboyant de l’expérimentation. En charge de donner chair à cette fresque érotico-psyché-art nouveau, le peintre Kuni Fukai passe de l’aquarelle à la gouache, ajoute des collages. Son univers sensuel emprunte à Egon Schiele le sublime de corps osseux composés en un trait. A Klimt, il dérobe ses enchevêtrements charnels, peaux dont on perd les contours et dont on ne saurait dire si elles sont homme ou femme. Le mélange des techniques d’animation participe aussi de ce tumulte sensoriel où chaque plan devient une expédition. Quand Yamamoto se contente de promener sa caméra le long des peintures de Fukai, dans un dépouillement d’artifice qui rappelle les Carnets secrets des ninjas où Nagisa Oshima sublimait avec minimalisme un manga de Shirato Sanpei, l’œil se pose, s’attache calmement aux détails. L’instant d’après, les personnages se dotent du mouvement et l’image se met à onduler, se charge parfois de filtres aqueux, de flou. Les décors disparaissent pour faire place aux seuls corps, donnés à voir comme des territoires symboliques et érotiques, hachés en gros plan, hésitant entre rage et volupté.
Inlassablement, Belladonna en revient toujours au motif de la pénétration, de l’intériorité enflammée de Jeanne. Lors d’une visite nocturne du démon, le film dérape le temps d’une envolée psyché qui semble sortie du film Yellow Submarine, des apparitions de Big Ben, de banquiers et de l’ISS venant se coller sur l’écran dans un joyeux bordel flashy. A ce stade, pas besoin de drogue. Par sa radicalité, Belladonna échappe au monde de l’animation japonaise pour parler une langue finalement plus proche de celle de René Laloux et Roland Topor dans la Planète sauvage (également sorti en 1973).
Spectateurs outrés
Œuvre maudite avant même sa sortie, le film fut le chant du cygne de Mushi Production, le studio fondé par le géant du manga Osamu Tezuka. Soucieux d’élargir son audience, le studio lance à la fin des années 60 la collection Animera qui ambitionne d’utiliser le médium dessin animé pour s’adresser aux adultes. S’aventurant sur le terrain de l’érotisme, la collection va à contre-courant de l’époque, le marché de l’animation japonaise se structurant alors autour de deux credos : des séries télé au long cours et des films calqués sur le modèle Disney. Eiichi Yamamoto réalisera les trois longs d’Animera : les Mille et Une Nuits, Cléopâtre (où l’on ressent encore l’influence très importante de Tezuka) et Belladonna.Des échecs commerciaux. A peine Belladonna sorti (le 30 juin 1973), Mushi Production fait faillite. Au Japon, le film ne reste en salles qu’une dizaine de jours. Présenté au Festival de Berlin, il aurait outré des spectateurs qui ne s’attendaient pas à ce qu’un dessin animé puisse se montrer aussi cru. Incompris, condamné à une existence confidentielle d’un festival à l’autre, Belladonna ne cède pourtant jamais au graveleux qui deviendra la norme dans l’industrie du hentai qui lui fera suite. Restaurée en 4K par le distributeur américain Cinelicious à partir de copies retrouvées dans les archives de Mushi Production (et huit minutes miraculeusement dénichées dans un cinéma belge), l’audacieuseBelladonna a enfin droit à une seconde vie.
Marius Chapuis Libération 14 juin 2016