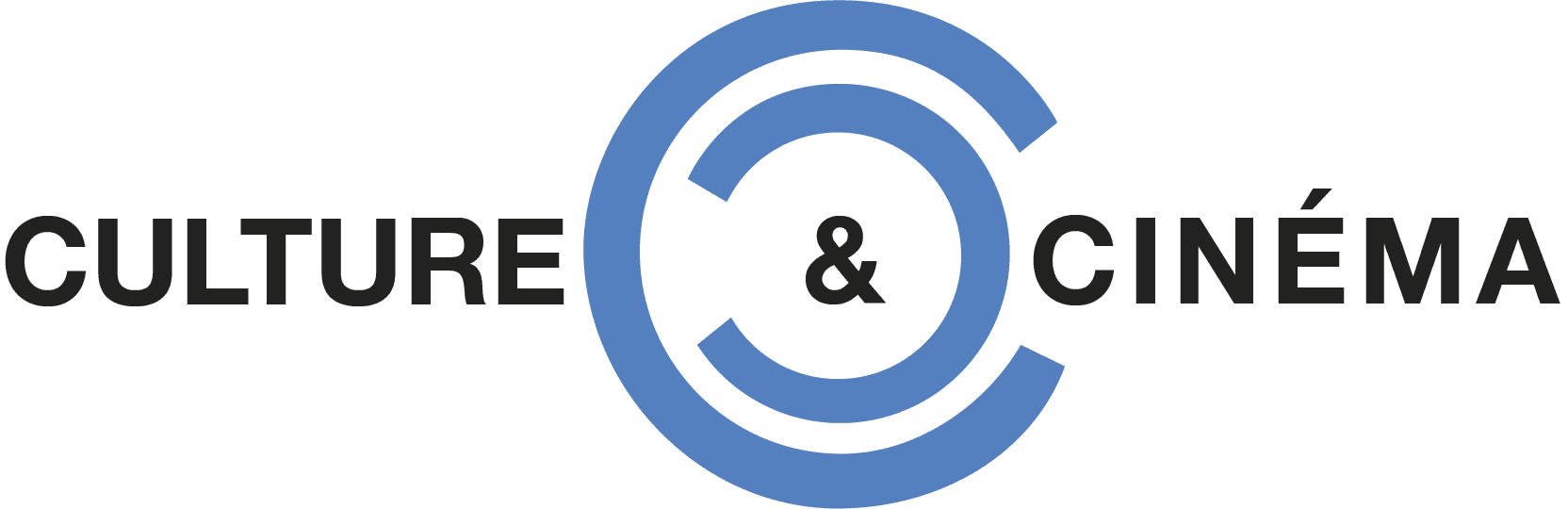Invité à tourner en Ouzbékistan, le Japonais Kiyoshi Kurosawa se livre à une mise en abyme belle et inattendue en filmant les pérégrinations de la pop star Atsuko Maeda, impressionnante en animatrice télé larguée dans des paysages inconnus.
Comme Yoko, son héroïne, le cinéaste est loin de la zone de confort où il vit et travaille le plus souvent, la métropole tokyoïte
«C’est super violent.» Simple remarque en passant de Yoko, journaliste et animatrice d’une émission touristique pour la télévision japonaise sur les richesses cachées de l’Ouzbékistan, au sortir d’un tour de manège forain en forme d’instrument de torture planté dans un jardin de Samarcande. On l’a vue au supplice sur la monstrueuse machine le temps d’un impressionnant plan-séquence, avant, pendant, après – on la suit, on la comprend. Mais Yoko (et avec elle Atsuko Maeda, qui l’interprète) y retourne, sans broncher, contre son corps même, très éprouvé. Comme elle s’inflige un plat de riz cru, se change, de femme moderne, en Dora l’exploratrice dans une camionnette de fortune, au vu des passants, reste impassible face aux humiliations sexistes d’un pêcheur ouzbek qui explique à son équipe de tournage – tous des hommes – qu’elle fait fuir les poissons : Yoko est pro et courageuse, n’en déplaise à ceux qui penseraient le contraire – dont elle-même, s’il faut en croire sa mine défaite presque constamment, sauf quand elle est en train de performer, sourire jusqu’aux oreilles, devant la caméra. Kiyoshi Kurosawa la filme partout et tout le temps, hors champ, en pleine performance, et surtout au moment du clap, où elle passe de femme japonaise en mission difficile à créature de télévision.
Chèvre solitaire
Comme elle, le cinéaste est loin de la zone de confort où il vit et travaille le plus souvent, la métropole tokyoïte. Il a été invité par le gouvernement ouzbek à venir réaliser un film et planter son grain de folie créative à l’occasion de l’anniversaire des relations diplomatiques avec le Japon. Il a imaginé ce dispositif, mise en abyme évidente, façon Nuit américaine sur la route de la soie, qui lui permet d’embrasser d’un même geste sa condition d’homme japonais et de cinéaste en territoire inconnu, et le territoire inconnu lui-même, hostile et grisant, de ses montagnes asséchées à son urbanisme apparemment dément. Sauf que Yoko n’est que très partiellement son double à l’écran.
Heureusement pour Au bout du monde, l’un des très beaux et plus inattendus films de Kurosawa depuis Real (2013), elle est plutôt un vrai personnage, qui doit beaucoup à celle qui l’interprète, pop star au Japon qui est comme son double inversé (Yoko voudrait devenir chanteuse quand Atsuko Maeda, à l’époque où son «groupe», AKB48, battait tous les records de vente au Japon, rêvait de devenir comédienne «sérieuse»). Au bout du monde lui doit énormément, qui suit son corps et son regard épuisés se fondre et se reformer incessamment dans l’étrange décor des villes d’Ouzbékistan si rarement vues au cinéma, à la fois fragile et inquiète (elle ne parle pas anglais) et formidablement intrépide, montant à bord des bus, traversant les voies autoroutières, défiant la police ou une famille d’agriculteurs, pour la cause absurde d’une pauvre chèvre solitaire qui filait des jours paisibles dans une ruelle de Samarcande.
Jeu de dupes
Et puis il y a cette scène de comédie musicale, dont on voudrait dire le moins possible, qui donne son titre au film et revient deux fois, tel un coup de tonnerre doublé de son écho, et dont la magie en appelle tout autant à Stanley Donen qu’au Jeanne de Bruno Dumont. S’y concentre sans doute toute l’originalité de ce projet à l’étrangeté insoupçonnable au vu de son titre et de la facture de ses images, sèches et sévères comme les steppes qui tapissent le fond de l’écran. Formidable jeu de dupes de la part de Kurosawa, grand cinéaste de l’image à double fond, du féerique réaliste, du fantastique tapi sous une mèche de cheveux ou dans le coin de l’écran. Si Au bout du monde est un film de voyage, il tient beaucoup d’un Pessoa contresignant son refus de voyager «là où il y a un risque» parce qu’il craint «de devenir blasé des dangers eux-mêmes». Kurosawa est infiniment lui-même quand il tourne en Ouzbékistan, mais il n’aurait pu concevoir ce film, sa beauté, sa folie, ses délires, nulle part ailleurs.
Olivier Lamm (Libération)