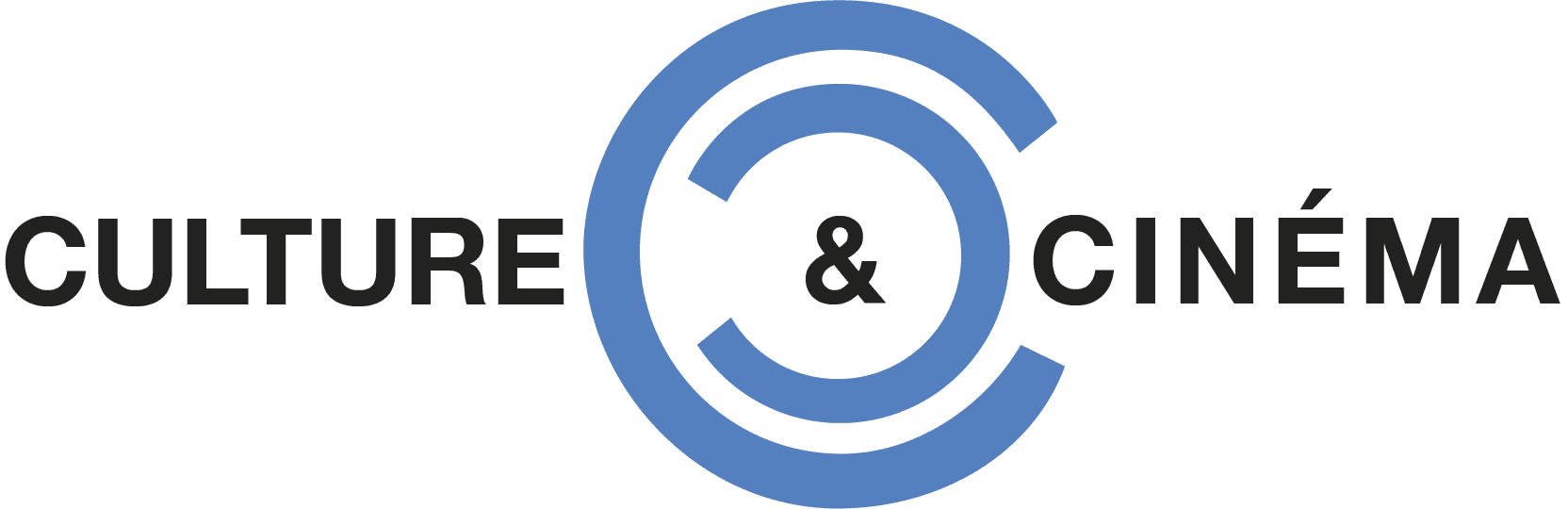Entretien avec le réalisateur Steve FAIGENBAUM :
Comment est née l’idée de ce documentaire ?
J’ai quitté Détroit il y a 25 ans. C’est la mort de mon père qui m’a ramené dans ma ville natale. J’avais des souvenirs, je savais que l’industrie automobile était en difficulté, j’avais vu des images de maisons en ruine, mais rien ne m’avait préparé à la vision apocalyptique que j’ai découverte : des milliers de logements calcinés envahissaient le paysage. Des immeubles jadis majestueux étaient en ruine. Des meutes de chiens errants traînaient dans le centre ville. Ma propre maison avait disparu. La nature avait réinvesti des espaces vides d’une superficie trois fois plus grande que Manhattan. Que s’était‐il passé ? Le film était pour moi l’opportunité de comprendre et rendre compte de l’histoire de Détroit à travers ma propre histoire.
La dimension intime est très présente dans le film …
L’élément central du film est la découverte de l’imbrication de mon histoire familiale avec l’histoire de la ville. Ma voix mène le récit, elle nous fait voyager dans mon histoire mais aussi dans les détails du quotidien familial qui, de manière insignifiante, révèlent les conflits raciaux et sociaux qui ont décimé la ville et ses habitants.
Vous imbriquez d’ailleurs images intimes et archives publiques, dont certaines inédites
Ce n’était effectivement pas un problème de mêler des archives de familles avec des archives historiques. La petite histoire rejoignait la grande… J’ai découvert des archives télévisées de chaînes locales qui n’avaient pas été visionnées depuis cinquante ans. Ces archives embrassent tous les aspects de la vie publique ainsi que de nombreux aspects de la vie quotidienne. Elles permettent de contextualiser la violence et les conflits sociaux qui la rythmaient, mais aussi l’avènement du consumérisme. J’ai également utilisé des extraits de publicités, de films institutionnels, pour restituer la construction mentale du rêve américain. Les archives donnent à voir parfois de manière inattendue à quel point ces valeurs de prospérité étaient nos valeurs, de quelle manière elles nous constituaient. Lorsqu’on regarde de près les images des émeutes de 1967, on y voit des manifestants qui volent non pas de la nourriture mais des téléviseurs, des réfrigérateurs et des canapés, c’est à dire les articles qui définissaient le standing social. People stole not just food, but televisions, refrigerators and furniture, the symbols of success and social standing.
Que représentaient ces valeurs pour votre famille ?
Mes grands‐parents m’ont transmis l’idée que Détroit était l’incarnation d’une ville d’espoir. Dès l’école primaire, on nous montrait des films produits par des sociétés comme General Motors qui louaient les vertus de la croissance illimitée et promettaient des lendemains heureux. La tradition américaine libérée des privilèges de classe permettait une nouvelle vision de l’égalité basée sur le matérialisme. Mon oncle était gérant de parking et quand il a eu les moyens ‐ou le crédit !‐, il s’est acheté une Cadillac qu’il sortait comme un trophée. L’économie prévalait sur tout.
C’est pourtant au même moment que le centre de Détroit se paupérise…
Le déclin a en fait commencé dès 1950 quand les premières usines ont été automatisées. C’était le progrès, et cela signifiait que tout serait mieux et moins cher. En réalité, tout était en place pour que le chômage ne cesse d’augmenter dans les décennies suivantes. A partir des années 50, la croissance économique frénétique de l’automobile a étendu le rêve américain aux habitants noirs de la ville qui ont lutté pour leurs droits civiques. Les blancs n’ont pas supporté que les noirs profitent eux aussi de cette croissance, travaillent comme eux, acquièrent une maison dans les mêmes quartiers qu’eux… A la fin des années 60, la vision progressiste du maire Cavanagh et de Kennedy est mise à mal. Des émeutes urbaines meurtrières et le militantisme noir accélèrent l’exode des blancs vers la banlieue. La classe moyenne blanche emporte avec elle son revenu fiscal. Les sociétés déplacent leurs usines dans des locaux moins onéreux.
Tandis que la ville se vide de sa substance humaine, économique et culturelle, elle n’a plus qu’à s’écrouler sur elle‐même.
Votre famille aussi a choisi de quitter le centre…
Lorsque Henri Ford créa l’automobile, il créa le moyen de s’échapper. L’idée de la liberté accéléra la création des banlieues à Détroit. Les autoroutes qui étaient le symbole de la liberté et du progrès, ont ouvert les routes de la fuite. La politique raciale a bouleversé la carte scolaire. Mes parents étaient des progressistes, pourtant nous avons fait le choix de partir. J’ai dû changé d’école, perdre mes habitudes, perdre mes amis… Je n’ai pas vraiment compris ce qui se passait à l’époque.
Pourquoi n’avez‐vous pas fait le choix d’un récit linéaire pour raconter l’histoire de Détroit ?
Je voulais bousculer la frontière entre passé et présent, privilégier une logique émotionnelle plutôt qu’une logique chronologique… En tant que cinéaste, je pense que raconter l’histoire, ce n’est pas raconter de simples faits mais raconter des trajectoires, des émotions… Structurellement, le film avance et remonte le temps en mélangeant des éléments, une bribe de souvenir ou un lieu géographique peut déclencher un saut temporel, le récit d’un fait divers ou d’un événement politique. Le mélange de ces éléments a pour effet de condenser la distance émotionnelle créée par le temps et de souligner clairement que le présent est le fruit du passé, de l’histoire américaine, de son acharnement à écarter la responsabilité individuelle et collective. On a souvent voulu croire que le récent ralentissement économique était l’unique cause de l’extinction de la ville. Alors que certains de nos problèmes étaient inhérents à nos valeurs. On a minimisé d’autres facteurs comme des conflits raciaux et sociaux enracinés dans l’histoire de l’Amérique. C’est ce que je me suis appliqué à démontrer dans ce film.
Jim Jarmush choisit Détroit comme ville symbole de la musique dans son dernier film. Comment avez‐vous envisagé la musique de City of Dreams ?
Je n’ai pas voulu abuser de l’utilisation d’une musique si connue, si adulée dans le monde entier. Pour moi, Détroit, c’était la Black Music… Ce rythme joyeux, c’était un écho à une réalité pourtant crue et difficile. C’était le rythme incessant des machines, mais c’était aussi une musique libre où on pouvait parler d’amour, de sexe, de blues. Une vision de la réalité plus libre comparée au puritanisme qui innervait les communautés blanches. Cette musique incarnait pour moi la liberté. Mais notre liberté a consisté à tout laisser derrière nous. Dans le film, la musique vient avant tout illustrer cette contradiction.
Comment voyez‐vous l’avenir de Détroit ?
L’industrie ne fournira plus jamais les mêmes bénéfices économiques à Détroit. Le monde a changé. La mondialisation a rendu cela impossible. Aujourd’hui la ville attire des jeunes du monde entier qui viennent acheter une maison pour 1000 euros. Ils projettent leurs idéaux, certains imaginent une nouvelle ville parsemée de jardins urbains. Mais il y a encore beaucoup de violence à Détroit, qui reste la capitale du meurtre en Amérique. Cette violence n’a jamais quitté Détroit même pendant la période de grande croissance. Le racisme ne fait que se délocaliser mais ne disparaît jamais. Détroit pose la question du vivre ensemble, une question qui va se poser partout à l’ère de la mondialisation…
Vous voulez dire que le film résonne comme un avertissement pour d’autres villes ?
Certainement. J’habite en France depuis les années 90 et je vois qu’il y a des peurs qui se sont installées. Oui, on peut se demander ce que peut devenir une société dans un contexte social aussi clivé… Le seul moyen pour moi de répondre à cette question a été de faire ce film et de témoigner.»