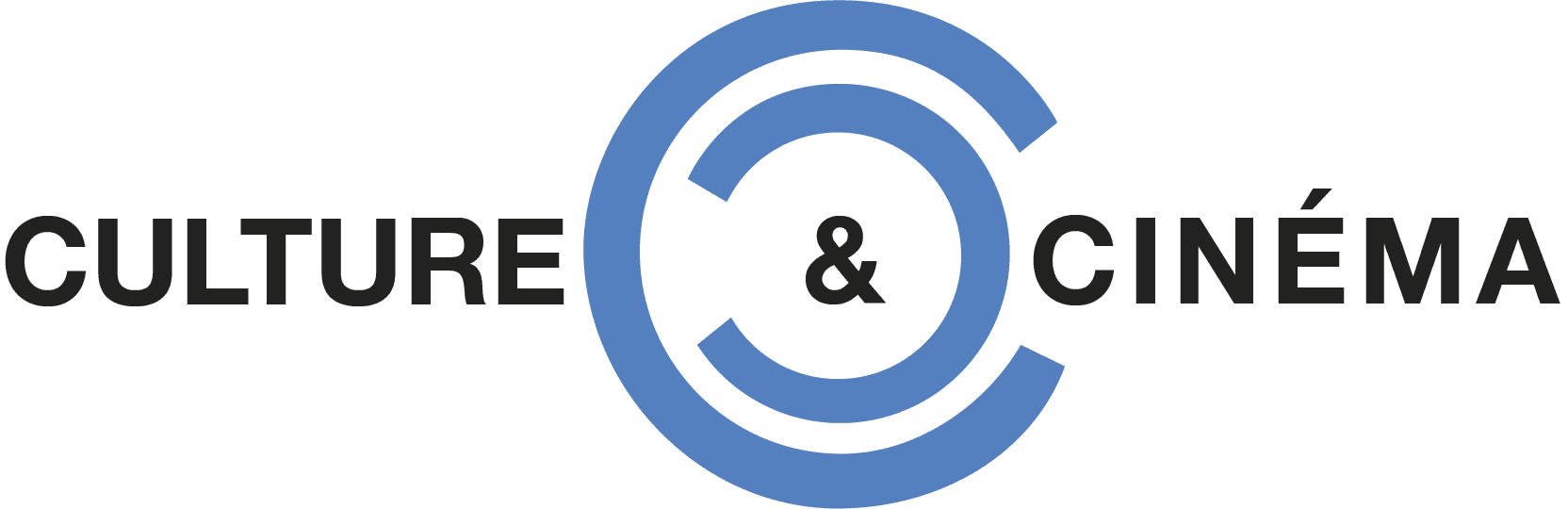Le Groupement National des Cinémas de Recherche et la Société des Réalisateurs de Films présentent la 9ème édition "Le Meilleur de la Quinzaine" du 12 au 25 septembre 2018. Durant 15 jours, des salles de cinéma en France, adhérentes au GNCR, proposent un choix de films que la Quinzaine des Réalisateurs a mis en avant lors du Festival de Cannes 2018. Ces salles organisent également des rencontres et des débats autour de ces films. Elles vous invitent à venir découvrir des œuvres d’auteurs, singulières, inventives, parfois dérangeantes. Les films des différentes éditions de la Quinzaine des Réalisateurs sont régulièrement présentés dans les salles adhérentes, depuis de nombreuses années. Par cette manifestation, nous désirons une nouvelle fois souligner nos affinités cinématographiques, l’intérêt commun porté à la découverte de nouveaux talents et le voisinage de nos lignes éditoriales.
LES FILMS RESERVES PAR CULTURE ET CINEMA
Samouni Road de Stefano Savona (dimanche 16/09 à 19h)
une famille de Gaza entre documentaire et animation. Mêlant prises de vues réelles et scènes animées, le film de Stefano Savona, projeté à la Quinzaine, est une œuvre indispensable.
Après l’extraordinaire Tahrir, place de la libération (2011), sur la révolution égyptienne, le Palermitain Stefano Savona, archéologue de formation, continue de documenter la situation du Moyen-Orient (où l’avaient d’abord conduit ses fouilles), puisque Samouni Road, à l’affiche de la Quinzaine des réalisateurs, se déroule à Gaza. Le film remonte à un moment particulier de la guerre : l’opération « Plomb durci », frappes de l’armée israélienne qui causèrent des pertes humaines et matérielles massives parmi les civils palestiniens. Il s’attache plus particulièrement à une famille des faubourgs de Gaza, les Samouni, qu’il filme d’abord peu après l’attaque, puis un an plus tard, pendant la préparation d’un mariage. Ce faisant, la question qu’il pose est essentielle : comment, après une telle déflagration, reconstituer la trame pulvérisée du temps et l’idée même de « continuité » que toute famille incarne ?La particularité du film est de ponctuer les prises de vues réelles par des scènes d’animation, de style crayonné en traits blancs sur fond noir, conçues par l’animateur Simone Massi, qui consistent à recréer les souvenirs des survivants avant l’attaque, traces d’un monde désormais détruit. les passages filmés, incroyablement forts, se suffisent à eux-mêmes. On y voit tout : les vies ravagées (les Samouni ont perdu une trentaine de parents pendant le conflit), les existences suspendues, le désespoir, les bâtiments rasés, les pénuries de vivres..
L’IMAGE DOCUMENTAIRE CONFRONTE, PAR LE MONTAGE, CES DIFFÉRENTES FACETTES D’UNE RÉALITÉ INFINIMENT COMPLEXE
L’image documentaire confronte dialectiquement, par le montage, ces différentes facettes d’une réalité infiniment complexe. L’animation, en revanche, lui substitue un registre strictement illustratif, trop univoque et non sans lourdeur quand il s’agit, par exemple, de reconstituer la visée d’un drone bombardier. Elle indique, en tout cas, un certain manque de confiance de la part de Savona, en la capacité du pur documentaire, non seulement à susciter l’imagination du spectateur, mais à capter toujours bien plus qu’il ne s’en trouve devant l’objectif. Samouni Road n’en demeure pas moins, pour son travail de première importance, une œuvre indispensable.
M Macheret Le Monde
Amin de Philippe Faucon (vendredi 21/09 à 19h)
Un regard à hauteur d’humanité. A la Quinzaine, le cinéaste Philippe Faucon s’attache à des personnages en déshérence affective qui vont se rapprocher et s’aimer.
C’est le titre le plus court d’une carrière qui n’en manque pourtant pas : Amin, quatre lettres qui ornent avec sobriété, comme un cartel au bas d’un tableau, le dernier long-métrage de Philippe Faucon, venu illuminer la dernière ligne droite de cette 50e Quinzaine des réalisateurs. Des titres qui se résument souvent à un prénom, nu et isolé, nous rappelant que l’art du cinéaste est avant tout celui du portrait – des portraits qui ouvrent une fenêtre de représentation aux « invisibles » de la société française, qu’il s’agisse des jeunes marginaux (Sabine, 1992) ou de figures issues de l’immigration (Samia, 2000 ; Fatima, 2015). Mais ces titres nous disent autre chose, plus essentiel : qu’un film, avant de « raconter » une histoire ou de « traiter » un sujet, peut s’attacher à la personne et chercher à en restituer la présence particulière.
Amin (Moustapha Mbengue), ouvrier journalier sur les chantiers de construction, vit en France, à Saint-Denis, dans un foyer de trvailleurs immigrés. Il vient du Sénégal et s’apprête à y retourner pour un bref séjour, afin d’y acheminer le fruit d’une collecte qui doit financer l’école du village. Sur place, il retrouve sa femme Aïcha (Marème N’Diaye) et ses trois enfants, qui disent tous souffrir de son absence. De retour à Paris, Amin est employé pour des travaux d’aménagement dans la maison de banlieue d’une infirmière, Gabrielle (Emmanuelle Devos). Celle-ci, divorcée, partage la garde d’une petite fille avec un ex-mari acariâtre et querelleur. Amin et Gabrielle, en déshérence affective, vont se rapprocher, s’aimer. Ce ne sera ni une relation amoureuse planifiée, ni une simple histoire de sexe : un accueil mutuel total.
Un érotisme franc et pudique
Approche qui réunit toujours les mêmes facultés saisissantes : un regard à hauteur d’humanité, prêtant attention aux visages, à la musicalité des voix, à la vérité des accents, aux faits et gestes quotidiens, mais aussi une temporalité imperturbable, sertissant l’apparition de chaque personnage. Toutes choses qui n’avaient pourtant jamais atteint, jusqu’alors, un tel degré de sensualité : la douche d’Aïcha, les scènes de lit, l’union des corps blanc et noir, l’entrevue d’un ouvrier avec une prostituée marquent autant de touches d’un érotisme à la fois franc et pudique, qui célèbre la beauté frémissante de ses personnages.
La grande force du film réside dans son ouverture à tous les parcours, à toutes les trajectoires, aux seconds rôles qui jouxtent celui du protagoniste. Les déboires d’un ouvrier algérien, les abus répétés des employeurs, les affres d’un divorce, le voisinage du village sénégalais enrichissent par touches pointillistes la sphère d’existence d’Amin. L’art du portrait selon Faucon ne consiste pas tant à hausser un personnage par-dessus les autres qu’à le replacer dans le faisceau complexe des dimensions qui composent son quotidien. Car, ici, l’être n’est rien s’il n’est aussi rempli des autres.
M Macheret Le Monde
Les confins du monde de Guillaume Nicloux (dimanche 23/09 à 19h)
Guillaume Nicloux poursuit une œuvre protéiforme et toute en zigzags, où chaque film semble obstinément ne vouloir ressembler en rien à celui qui le précède. Si ce n’est par une inclination, depuis Valley of Love (2015), pour les dérives existentielles, les expéditions autant extérieures qu’intérieures de personnages itinérants. Les Confins du monde, son dernier film présenté à la Quinzaine des réalisateurs, ne déroge pas à la tendance, puisqu’il décrit, pendant la guerre d’Indochine, la longue marche à travers la jungle de Robert Tassen (Gaspard Ulliel), soldat de l’infanterie française, en même temps que son enlisement dans une obsession de plus en plus déliquescente.
Le film s’attache à la période trouble de 1945-1946, à la sortie de la seconde guerre mondiale, marquée par l’occupation momentanée du Tonkin par les forces japonaises et l’émergence de la résistance indépendantiste. Tassen est l’unique rescapé d’un massacre lié au « coup de force » du 9 mars 1945, riposte japonaise à la reprise en main du territoire par les Français.
LE PREMIER INTÉRÊT DU FILM EST DE SE PENCHER SUR UN ÉPISODE DE L’HISTOIRE COLONIALE ASSEZ PEU VISITÉ PAR LE CINÉMA FRANÇAIS
Au début du film, le soldat se relève d’un épais charnier, où gisent à la fois son unité décimée ainsi que des parents. Recueilli et soigné par des villageois, il rejoint l’armée française, obnubilé par l’idée de se venger, notamment sur la personne de Vo Binh, un lieutenant d’Ho Chi Minh. Trois rencontres jalonnent sa quête : celles de l’écrivain Saintonge (Gérard Depardieu), du soldat Cavagna (Guillaume Gouix), qui rejoint son bataillon, et de la prostituée Maï (Lang-Khê Tran), dont il tombe amoureux.
Le premier intérêt du film est ainsi de se pencher sur un épisode de l’histoire coloniale finalement assez peu visité par le cinéma français, à l’exception de la mémorable 317e section (1965), de Pierre Schoendoerffer, référence explicite. Difficile de ne pas l’inscrire également dans tout un réseau d’influences contiguës, qui iraient des récits de Joseph Conrad à l’iconographie de la guerre du Vietnam dans le cinéma américain (Apocalypse Now au premier chef), en passant par les films de patrouille de Samuel Fuller (Les maraudeurs attaquent, 1962).
La mise en scène de Nicloux frappe ici par sa sécheresse, mais surtout par son impudicité. Le corps y est exposé sans ménagement, qu’il s’agisse des cadavres mutilés par la guerre (têtes coupées, membres sectionnés) ou de la sensualité des soldats eux-mêmes, rendue âpre et brutale par les souffrances qu’ils endurent. Au motif de la vengeance, s’adosse bientôt celui de la sexualité maladive.
La guerre apparaît non seulement comme une névrose sexuelle, par la virilité convulsive qu’elle mobilise, mais surtout comme une permanente angoisse de la castration. Les amputations du Vietminh, la sangsue qui s’immisce dans le pénis d’un soldat, la morsure des serpents (symbole phallique explicite), ne racontent pas d’autre histoire. Celle d’hommes qui, progressivement désertés par la vie, regardent leurs sexes tomber.
M Macheret Le Monde.